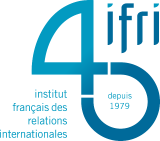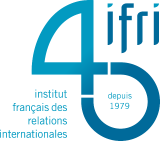Kurdes de Syrie : jeu d’échecs entre Moscou, Ankara, Damas et Washington
Un deal «secret» sur la question kurde aurait été conclu entre la Russie, la Turquie et le régime syrien tandis que les États-Unis tentent de ménager la chèvre et le chou et d’éviter le piège moscovite.

La chute de l’enclave kurde d’Afrin le mois dernier a révélé, au-delà de la menace que représente l’émergence d’un éventuel Kurdistan syrien pour la Turquie, l’existence d’un pacte tripartite entre Ankara, Moscou et Damas sur la question kurde.
Si l’hostilité de la Turquie à l’égard des Kurdes est incontestable, pour des raisons à la fois historiques et conjoncturelles, Moscou aurait également joué le jeu d’Ankara, après avoir soutenu cette minorité ethnique en quête d’autonomie.
Vladimir Poutine aurait même accordé le feu vert à Recep Tayyip Erdogan pour intervenir contre les YPG, la principale milice kurde qui fait office d’armée dans la zone semi-autonome auto-proclamée par le parti de l’Union démocratique (PYD).
La Russie, première puissance dans ce conflit
Retour aux faits: le 20 janvier dernier, Ankara annonce le début de son opération «Rameau d’olivier» contre les YPG dans la région d’Afrin, un des trois cantons de la zone semi-autonome kurde. Les soldats russes, stationnés jusque-là dans l’enclave, se retirent subitement et concomitamment avec le début des frappes pour laisser la voie libre à l’armée turque et aux groupes armés syriens qui lui sont alliés.
«Pour la Russie le choix des Kurdes de se tourner vers Washington, plutôt que de bénéficier de son parapluie à Afrin, est une des raisons de son non-engagement», explique Emmanuel Dupuy, président de l'Institut prospective et sécurité en Europe.
Alliés des États-Unis dans leur guerre contre l’organisation l’État islamique (EI), les Kurdes avaient, en effet, pris leur distance vis-à-vis de Moscou au cours des dernières années, en misant davantage sur un appui occidental, et américain en particulier, à leur projet politique de création d’une zone autonome dans le nord syrien, à l’instar du Kurdistan irakien.
Ils ont ainsi boycotté, parmi d’autres, les négociations tenues par la Russie en janvier dernier à Sotchi, en dépit des efforts menés par Moscou «pour les ramener à la table des négociations», ajoute Emmanuel Dupuy.
À travers l’abandon d’Afrin, la Russie visait ainsi à prendre sa revanche mais surtout à faire d’une pierre trois coups: affaiblir les États-Unis dans cette région de Syrie, en affligeant un coup à son principal allié, pousser les Kurdes à négocier avec Damas et consolider enfin son rapprochement avec la Turquie.
Moscou cherche surtout à conforter son statut de première puissance dans ce conflit en dirigeant une «triple alliance» formée par Ankara et Téhéran qui satisferait les intérêts de chacun des trois pays et exclurait les Occidentaux d’un éventuel «Yalta» syrien.
En janvier 2017, la Russie, l’Iran et la Turquie avaient déjà lancé le processus de négociations à Astana, la capitale du Kazakhstan. Celui-ci avait abouti à un accord sur la création en Syrie de quatre «zones de désescalade», dont l’enclave d’Afrine faisait partie, en vue d’un cessez-le-feu durable en Syrie.
Ce rapprochement progressif a été couronné par le sommet d’Ankara tenu au début de ce mois en présence des chefs d’État des trois pays. La Turquie et la Russie, à couteaux tirés durant les premières années du conflit syrien, ont même consolidé à cette occasion leur partenariat économique, énergétique et militaire en lançant la construction de la centrale nucléaire d'Akkuyu, l'un des projets stratégiques entre les deux pays, tandis que le président turc a une fois de plus confirmé l'achat par la Turquie des systèmes russes de défense antiaérienne et antimissile S-400 Triumph.
Rapprochement Damas-Ankara?
Quant au régime syrien, il semblerait être dans la boucle de ce deal «secret». Un retour aux fait s’impose également: à l’appel des Kurdes, celui-ci avait déployé vers la fin de l’offensive turque contre Afrin un nombre symbolique de quelques centaines de miliciens sous la bannière «forces populaires» pour soutenir les YPG et «défendre la souveraineté nationale contre l’agression turque». Mais ni l’armée officielle n’a été mobilisée ni les gros moyens utilisés, notamment la défense anti-aérienne dont les Kurdes avaient pourtant principalement besoin.
Le déploiement du régime a été précédé par de longues tractations avec les autorités kurdes, durant lesquelles Damas a tenté d’imposer son aide en contrepartie d’un retour de la région sous son autorité militaire et politique, ce que les Kurdes avaient refusé.
Face à cette fin de non recevoir, «le régime syrien a négocié un marché en vertu duquel il apporte un soutien militaire a minima en contrepartie de l’abandon par les YPG de localités kurdes dans la province d’Alep» proches d’Afrine, indique Joost Hiltermann, analyste à l’International Crisis Group.
Ce double jeu de Damas aurait été orchestré par Moscou dans le double objectif de remettre, d’une part, un pied dans une zone qui échappe au contrôle du pouvoir central depuis 2012 –dans le cadre d’une stratégie de reconquête de l’ensemble du territoire au forceps ou de manière détournée– et d’exploiter, d’autre part, le bras de fer entre Kurdes et Turcs pour se rapprocher d’Ankara, longtemps bête noire du régime.
Sur le premier volet, un soutien efficace du régime aux YPG aurait indirectement renforcé la présence américaine dans l’est de la Syrie, et compromis ainsi la reconquête du territoire. Quant au second, Bachar el-Assad semble avoir compris que l’objectif d’Ankara n’est plus sa destitution, mais l’élimination des YPG. Là aussi un pacte aurait été conclu: en contrepartie de la faible mobilisation militaire syrienne à Afrin, la Turquie, parrain traditionnel des rebelles, aurait fermé l’œil sur l’offensive meurtrière contre la Ghouta orientale, désormais tombée dans l’escarcelle de Damas.
Cette alliance de fait reste toutefois fragile, estiment les observateurs.
«Si deal il y a entre Moscou, Ankara et Damas –et je n’en suis pas sûr– il serait bien frêle, car la Turquie et la Syrie n'ont pas du tout la même idée vis-à-vis du nord syrien: Ankara veut une zone tampon sous leur contrôle et Damas cherche à restaurer son autorité à partir de Qamishli et Hassaké», souligne ainsi le spécialiste en géopolitique Julien Théron.
Washington, les Kurdes et l’Otan
Dans ce concert d’intérêts et d’alliances, Washington, qui a exploité, selon certains, les forces démocratiques syriennes (FDS) –dont les YPG constituent l’épine dorsale– dans leur guerre contre l’EI, fait également preuve d’indulgence à l’égard de la Turquie, comme en témoigne l’absence de toute intervention en faveur des Kurdes à Afrin.
Preuve d’une position ambiguë, les autorités politiques et militaires du Rojava –nom donné à la région sous domination kurde en Syrie– n’ont pas tardé à réagir au lendemain de la chute de leur enclave, affirmant avoir été «abandonnés», voire même «trahis» par leur allié américain, alors que Trump annonçait, en parallèle, sa volonté de retirer ses troupes de Syrie «le plus tôt» possible. Les milices kurdes, fer de lance des batailles menées contre l’EI aussi bien à Kobané qu’à Raqqa, espéraient du moins que les Américains imposent une zone d’interdiction de survol pour empêcher les raids de l’aviation turque.
Washington est visiblement tiraillée entre deux impératifs difficilement conciliables: le maintien de leur alliance avec les Kurdes et l’apaisement avec la Turquie, longtemps alliée stratégique dans la région et membre de l’Otan.
La Turquie, qui voit d’un mauvais œil la coopération depuis 2014 entre Washington et les milices kurdes, n’a eu de cesse de fustiger les États-Unis.
«D’un côté, vous dites à la Turquie “Vous être notre allié stratégique”, de l’autre vous scellez une alliance avec une organisation terroriste. Voilà la réalité», a ainsi martelé Recep Tayyip Erdogan lors d’un discours en mars dernier.
-
La Russie et l’Iran «veulent s'assurer du maintien voire de l'accroissement des tensions entre les États-Unis et la Turquie, pour perturber davantage l'Alliance atlantique». Julien Nocetti, spécialiste de la politique russe au Moyen-Orient
-
Dans ce jeu d’échecs, la Russie et l’Iran «veulent s'assurer du maintien voire de l'accroissement des tensions entre les États-Unis et la Turquie, pour perturber davantage l'Alliance atlantique. En effet, il est très probable que Moscou accroisse son soutien à Ankara afin d'attiser les tensions américano-turques», explique Julien Nocetti, spécialiste de la politique russe au Moyen-Orient à l’institut français des relations internationales (IFRI).
Ce piège, les États-Unis cherchent à l’éviter. Mais ils sont contraints par la volonté d’Ankara de poursuivre l’opération «Rameau d’olivier», avec en ligne de mire la ville de Manbij, un point stratégique où sont stationnées des forces américaines aux côtés de soldats français. Appliquer la même stratégie de non-intervention à Manbij qu’à Afrine semble bien difficile pour les Américains.
Pour échapper à cette position «d'échec et mat», Washington tente ainsi de trouver un accord avec Ankara qui sauve la face des deux côtés. C’est dans ce contexte que l’ancien secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, s’était rendu à Ankara à la mi-février, pour rassurer les Turcs, tandis qu’un groupe de travail américano-turc a été mis en place pour traiter le dossier de Manbij «en priorité».
«Mais pour l'heure Washington n'a pas lâché les Kurdes, assure Julien Théron. Certes l'alliance est fragile, du fait notamment de la politique américaine et de la position du président Trump, qui trouve coûteux le maintien de forces US en Syrie.»
«Elle est fragile, mais elle tient. Hors partenariats interétatiques, c'est le meilleur atout dont dispose Washington aujourd'hui dans la region», conclut l’analyste.
Relire l'article sur le site de Slate.fr