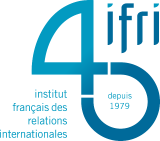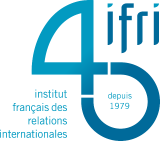L'aura présidentielle Chroniques électorales américaines, n° 14, février 2009

Le symbole du pouvoir présidentiel américain est le "bully pulpit", une expression difficile à traduire: le pulpit désigne la chaire d'où l'on prêche, et bully vient de bull, le taureau, une force intimidante. Le "bully pulpit" est donc, en quelque sorte, la tribune à partir de laquelle le président pousse ses partenaires politiques là ou ils ne veulent pas aller, en s'adressant par-dessus leur tête au peuple américain.
La formule a été inventée par Theodore Roosevelt qui a passé son double mandat à batailler avec le Congrès… comme tous les présidents américains pourrait-on dire. La Constitution américaine a en effet pris soin de diviser les pouvoirs dans ce que l'on appelle le "check and balance", système qui permet aux branches exécutive, parlementaire et judiciaire de se contrôler mutuellement. Pour être au sommet du triangle, le président doit donc constamment user de son véritable privilège: il est une figure unique et élue par l'ensemble du peuple américain alors que les parlementaires et les juges sont dilués dans leurs institutions respectives. Les pouvoirs constitutionnels du président
Il est significatif que la Constitution ne parle du président qu'à l'article II. L'article I, deux fois plus long, détaille les attributions du Congrès. Celui-ci a préséance en tous domaines, puisqu'il intervient aussi dans l'élection présidentielle: les voix des grands électeurs sont en effet décomptées par le Sénat. L'élection du Congrès donc précède toujours chronologiquement celle du président. Le Congrès a également le pouvoir de démettre le président par la procédure d'impeachment, mais celle-ci n'a jamais abouti au départ d'un président, du moins directement. Richard Nixon a démissionné lorsqu'il a appris qu'il y avait suffisamment de voix pour le dépouiller de sa fonction. Les deux autres procédures d'impeachment, contre Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998 sont restées lettres mortes car elles n'ont pas été ratifiées par le Sénat.
La Constitution américaine s'inscrit dans la ligne d'une révolution contre le pouvoir absolu du roi d'Angleterre. Elle a donc veillé à limiter les privilèges de ses dirigeants. Elle confère néanmoins des pouvoirs régaliens au président comme le droit de grâce, qu'il peut exercer a sa guise, sans autre contrôle que celui de l'opinion publique. La fin de la présidence de B. Clinton a ainsi été perturbée par une grâce accordée à un financier véreux en fuite, dont la femme avait largement contribué au financement de ses campagnes.
Le président peut gouverner par executive orders, décrets présidentiels, privilège dérivé de l'interprétation d'un passage de la Constitution: "le président veillera à ce que les lois soient dûment mises en œuvre". Il dispose d'un droit de veto sur les lois votées par le Congrès, mais celui-ci peut être annulé par un vote des deux tiers des deux chambres.
Le président est le chef des armées. La Constitution donne au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre mais, sur le plan pratique, c'est le président qui détient les leviers de l'usage de la force. Il peut mobiliser les troupes, menacer un autre pays d'une action militaire et même envoyer des forces sans accord du Congrès. Celui-ci a en revanche le pouvoir de voter ou non le financement des opérations militaires.
La politique étrangère est le domaine où le président a le plus de pouvoirs. Il a l'initiative des contacts avec les pays étrangers, et la Constitution lui donne le droit de négocier des traités, ceux-ci devant être ratifiés par le Sénat à la majorité des deux tiers. Il peut néanmoins conclure des "accords", procédure souvent utilisée pour contourner le contrôle du Congrès.
Le président procède à la nomination des membres de son gouvernement, des directeurs des grandes agences gouvernementales, des juges et d'une série de fonctionnaires. Cela représente plus de 2500 personnes. Toutes ces nominations doivent être ratifiées par un vote à la majorité simple du Sénat. Mais s'il n'y a pas une majorité de 60 voix pour la mettre à l'ordre du jour, une nomination peut être indéfiniment différée.
La nomination des juges est sans doute le domaine où l'influence du président s'exerce de la manière la plus durable et la plus subtile. Sa manifestation la plus spectaculaire est la désignation des juges à la Cour suprême. Ils sont neuf et sont chargés de veiller au respect de la Constitution. Ils peuvent à ce titre annuler des décisions du président, du Congrès ou d'autres tribunaux. Ils tranchent sur les grands problèmes de la société américaine: la peine de mort, l'avortement, le droit du travail etc. Les juges à la Cour suprême sont nommés à vie: ils démissionnent ou meurent à la tâche. Le doyen de la Cour suprême, John Paul Stevens, nommé par Gerald Ford, va sur ses 89 ans !
Un président peut compter en moyenne sur deux sièges vacants à la Cour pendant son mandat. Il peut ainsi espérer faire pencher la balance de la Cour vers les idées dont il se réclame. Mais il ne peut compter pour cela que sur la mort de l'un des titulaires: sauf en cas de force majeure, un juge ne démissionne pas s'il ne se sent pas un minimum d'affinité avec celui qui va nommer son successeur. On peut même se demander si la présence d'un président adverse n'a pas des vertus roboratives. On a vu des juges s'accrocher à la vie pendant tout un mandat présidentiel…
Les juges à la Cour suprême ont un tel pouvoir qu'ils échappent souvent à la mouvance politique du président qui les a nommés et la Cour à tendance à trouver un équilibre naturel. En revanche, les juges fédéraux -nommés également à vie par le président- ont tendance à rester plus fidèles à l'idéologie qui leur a valu leur poste. Ils ont, à un cran inférieur, le même type d'influence que les juges de la Cour suprême. Ils statuent sur les conflits du travail, les problèmes électoraux, les dédommagements, les droits civiques, etc. Leur pouvoir est énorme et marque durablement l'empreinte du président qui les a choisis.
Les champions du "bully pulpit"
Si l'expression "bully pulpit" a été inventée par le républicain Th. Roosevelt, nul n'en a fait autant usage que son homonyme et cousin, le démocrate Franklin D. Roosevelt. Il prend ses fonctions le 4 mars 1933 au plus fort de la grande dépression et, au lieu de passer la première journée entre parades et bals, se met au travail l'après-midi même. Son gouvernement prête serment et le Congrès est rappelé en session le 9 mars. Entre-temps les banques ont été fermées pendant 5 jours pour éviter un mouvement de panique avant l'adoption de nouvelles règles financières. En fait c'est le Congrès qui semble avoir été frappé de panique, car pendant la période qui suit, connue sous le nom des 100 jours, les deux chambres ont voté un nombre de lois sans précédent, et sans égal dans l'histoire des États-Unis. Elles constituent ce que l'on a appelé le New Deal. Profitant du sursaut populaire qui l'avait porté au pouvoir, F. D. Roosevelt n'a pas laissé aux parlementaires une seconde pour se retourner. Entre mars et juin il a adressé 15 messages au Congrès et 10 messages à la nation. Il a inventé l'allocution radiodiffusée hebdomadaire du président, tradition qui dure encore et qui franchit un cap avec Barack Obama par l'enregistrement télévisuel et la diffusion le site Internet Youtube.
Franklin D. Roosevelt a ainsi jeté les bases d'un rôle qui s'est amplifié de présidence en présidence: celui de grand communicateur. Non seulement il s'est adressé sans cesse directement à la population, mais il a su la ragaillardir par des mesures symboliques, comme l'abolition de la prohibition. Dans la période sombre de la Dépression il a ainsi institué ce que la présidence a appelé les "happy days", les jours heureux, qui consistaient essentiellement à mettre en perce des tonneaux de bière.
Franklin D. Roosevelt a ainsi pu faire passer une série de lois, du premier au second New Deal, qui, si elles n'ont pu venir à bout d'une crise économique qu'avec la Seconde Guerre mondiale, ont profondément transformé la société américaine.
En fait, les ennuis du président ont commencé quand il a voulu s'attaquer aux institutions. Lorsqu'en 1935 la Cour suprême a décrété que certaines parties du New Deal étaient inconstitutionnelles, le président a essayé de modifier les règles de nomination à la Cour, et d'en augmenter les membres pour y installer des juges qui lui seraient favorables. Cette tentative de manipulation de l'une des institutions les plus sacrées du pays a soulevé un vent d'indignation dans la classe politique. Franklin D. Roosevelt a finalement renoncé. La lune de miel avec le Congrès était terminée, mais le président allait encore remporter une épreuve de force, celle de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.
Sous ses deux premiers mandats, le Congrès avait passé deux lois illustrant l'isolationnisme ambiant: le Johnson Act, qui interdisait de prêter de l'argent aux pays qui n'avaient pas remboursé leurs dettes de la guerre précédente, et le Neutrality Act qui, comme son nom l'indique, interdisait de prêter assistance à des pays en guerre. Conscient des dangers de la montée du nazisme, F.D. Roosevelt ne pouvait cette fois s'appuyer ni sur son parti, ni sur l'opinion publique. Il a donc mis en œuvre ce que l'on pourrait appeler la ruse présidentielle. Il a exploité la prérogative de l'exécutif de négocier secrètement avec les puissances étrangères, et monté un plan d'aide aux pays qui entrés les premiers dans le conflit, avec des solutions créatives pour tourner les lois isolationnistes, comme le cash and carry -qui permettait de livrer de l'équipement aux pays endettés à condition qu'ils le payent cash- et le lend-lease -qui consistait à louer de l'équipement qui serait "racheté" après la guerre.
Franklin D. Roosevelt s'est appuyé à cette période sur des républicains qui partageaient sa ligne interventionniste. L'exemple de George W. Bush peut être présenté en effet miroir: c'est un président qui a acquis une extrême autorité à cause d'une guerre, celle contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre. Le fait que ces attaques se soient déroulées sur le territoire américain, contre des civils et de façon totalement arbitraire, a poussé la population à se regrouper derrière un président qui jusqu'à ce moment ne bénéficiait ni d'un grand charisme ni même d'une réelle autorité politique.
Le "bully pulpit" de G.W. Bush a été le mégaphone dont il s'est saisi à New York pour haranguer les sauveteurs. "Je vous entends, a-t-il dit, et le monde entier vous entend aussi". L'image du président, le bras sur l'épaule d'un sauveteur, devant les ruines fumantes du World Trade Center, a fait le tour du monde. Les jours suivants la popularité de G.W. Bush a atteint 90%, cote record depuis que les sondages existent.
George W. Bush a alors mis en place un arsenal juridique de lutte contre le terrorisme, qui allait à l'encontre de l'extrême protection des libertés individuelles chère à la population américaine. À la fin du mois d'octobre a été voté le Patriot Act, ensemble de lois sécuritaires. Ceux-là mêmes qui les dénoncent aujourd'hui, comme le sénateur Patrick Leahy, président de la Commission des affaires judiciaires, les ont votées -on serait tenté de dire comme tout le monde, c'est-à-dire 98 sénateurs sur 100, et 357 représentants sur 423.
Il faut d'ailleurs noter que les présidents américains n'hésitent pas en temps de guerre à s'attribuer des pouvoirs exceptionnels. L'exemple le plus criant est celui d'Abraham Lincoln, qui au début de sa présidence, coïncidant avec celui de la guerre civile, a pris des mesures extraordinaires contre les libertés individuelles: suppression de l'Habeas Corpus, arrestations arbitraires, civils jugés devant des tribunaux militaires, fermeture de journaux d'opposition. Il s'en est expliqué en disant que la fin justifiait les moyens et l'histoire semble s'en satisfaire. George W. Bush tant que Barack Obama (qui a choisi de prêter serment sur la Bible d'Abraham Lincoln) le citent comme une référence. Lincoln a justifié ses actions par le passage de la Constitution cité plus haut: "[…] le président veillera à ce que les lois soient dûment mises en œuvre". Au nom du même principe, Woodrow Wilson a suspendu les libertés de la presse pendant la Première Guerre mondiale et F.D. Roosevelt a fait emprisonner 100 000 Japonais sans jugement pendant la seconde…
En 2002, un an après le Partiot Act, un texte autorisant l'usage de la force en Irak est passé avec un large appoint de voix démocrates. De même, année après année et alors que la guerre devenait de plus en plus impopulaire, G.W. Bush a réussi à faire voter des budgets toujours croissants pour financer ses opérations militaires. L'initiation accélérée de Barack Obama
De 2001 jusqu'aux deux dernières années de sa présidence, G.W. Bush a tenu le Congrès par la force plus que par la persuasion. L'inverse était vrai de Ronald Reagan, qui avait réussi à imposer sa "révolution" tout en gouvernant avec un Congrès hostile. Il avait en effet réussi à créer une catégorie politique nouvelle: les "Reagan democrats", gauche modérée qui, bien après la disparition politique de Reagan, a constitué un électorat d'appoint au service d'un programme conservateur.
Pendant son premier mois à la Maison-Blanche, Barack Obama a suivi une sorte de formation accélérée sur les mérites comparés de la carotte et du bâton. Il a eu d'emblée à négocier le passage d'un plan de relance de 787 milliards de dollars, déblocage de fonds record dans les annales du Congrès. Le président n'a pas caché qu'il souhaitait un apport substantiel de voix républicaines. Il n'a donc pas ménagé ses bonnes grâces à l'égard de l'opposition. Il a rendu visite à ses représentants au Congrès, et les a invités à la Maison-Blanche, à la fois de façon formelle et mondaine. Ce faisant, il a peut-être oublié le vieil adage: protégez-moi de mes amis…
Car pendant ce temps, les démocrates de la Chambre des représentants, forts de leur victoire électorale, rédigeaient un texte de loi qui représentait le catalogue de leurs volontés politiques, sans concertation avec l'opposition. La Chambre votant à la majorité simple, le texte est passé sans problème, mais sans une seule voix républicaine. L'étape suivante s'annonçait difficile, puisque pour faire passer un texte rapidement au Sénat, une majorité de 60 voix sur 100 est nécessaire, qui suppose donc l'appoint de trois voix républicaines. Le président s'est donc trouvé contraint à un double exercice de persuasion: d'une part il fallait trouver un texte qui attirerait les voix manquantes de l'opposition, d'autre part faire accepter les concessions que cela impliquerait aux démocrates de la Chambre.
Dans la nuit du 13 au 14 février, le texte est passé au Sénat, avec tout juste les 60 voix nécessaires -pas une de plus. Comme il le souhaitait, Barack Obama a pu le signer le mardi 16 février, quatre semaines exactement après son entrée en fonction. Pendant ce court laps de temps le président a expérimenté à la fois la force et les limites du pouvoir présidentiel. Son propre parti a dû être remis en ligne à la force du poignet. Ses adversaires ont trouvé plus d'avantages à s'opposer qu'à se rallier. Au bout du compte, Barack Obama a remporté une victoire significative, en obtenant la législation qu'il souhaitait dans les délais qu'il avait prescrits, mais les tâtonnements initiaux ont abouti à un vote partisan. Comme l'a souligné John McCain, son adversaire dans la course à la présidence, trois voix républicaines sur l'ensemble des deux chambres ne suffisent pas à constituer pas un vote consensuel. Et cela peut à long terme avoir des conséquences. Si le plan de relance ne remplit pas sa fonction, l'entière responsabilité en sera imputée aux démocrates.
La visibilité et l'argent
Lorsque la situation a commencé à lui échapper, deux semaines après son arrivée au pouvoir, Barack Obama a appliqué deux recettes qui ont retourné la situation.
Il est parti faire une tournée dans le pays, pour expliquer les bienfaits du plan de relance et agiter l'épouvantail de ce qui se passerait s'il n'était pas adopté. Puis il a convoqué une conférence de presse, diffusée à une heure de grande écoute sur le réseau national. Le président a ainsi fait la démonstration des moyens matériels qui sont à sa disposition. Il peut disposer d'un temps d'antenne à la télévision quand il le réclame, et il lui suffit de monter à bord d'Air Force One pour sillonner le pays à sa guise. Lorsqu'il a manqué une voix pour au plan de relance au Sénat, parce qu'un sénateur démocrate était parti enterrer sa mère, Barack Obama a dépêché un avion de la présidence pour aller le chercher. Le chef de l'exécutif a tous les moyens matériels pour se faire entendre, et pour agir. La Maison-Blanche dispose d'un budget et d'un personnel auxquels ne peut se mesurer aucune autre institution.
Le président s'appuie également sur la force de son image, amplifiée par l'ère de la communication de masse. F.D. Roosevelt a été le premier à utiliser le pouvoir de la radio, avec des causeries au coin du feu où il expliquait directement ses décisions. Il est heureux que la radio ait été à l'époque le média le plus populaire : F.D. Roosevelt y usait du charme de sa voix et cachait soigneusement son handicap physique, qu'il tenait pour une manifestation de faiblesse. Une attaque de poliomyélite l'avait laissé paralysé des deux jambes, il usait de mille ruses pour toujours se montrer derrière un pupitre ou assis dans un fauteuil. Ses contemporains ne l'ont jamais vu dans un fauteuil roulant.
John F. Kennedy a au contraire joué de son charisme physique, et il a été le premier président qui ait fait téléviser ses conférences de presse, en donnant 64 pendant sa courte présidence. Il devait d'ailleurs être surnommé le "camelot", en référence au royaume magique du Moyen-Âge. Ronald Reagan, un autre magicien de la communication était "The Gipper" -surnom emprunté à un personnage qu'il a interprété dans l'un de ses films, athlète surdoué qui fait gagner son équipe, y compris après sa mort, par la force de son optimisme. Comme lui, Ronald Reagan était assimilé à des "vibrations positives". Un président doit aussi vivre par sa légende…