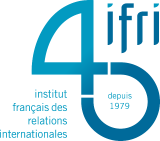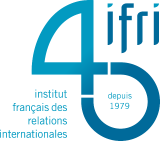Les quatre candidats : What a campagne ! Chroniques électorales américaines, n° 11, octobre 2008

Il est difficile de dire quand la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2008 a commencé: sans doute au lendemain de celle de 2004 ! George W. Bush ayant été réélu, cette fois-ci sans ambiguïté, pour un dernier mandat, la course à sa succession était grand ouverte. La victoire du président a été accompagnée de celle de son parti, dans les deux chambres. Cette conjoncture a suscité de nombreuses vocations dans le Parti républicain. Les démocrates, démoralisés, ont vu leur salut dans l'ex-première dame et sénatrice Hillary Clinton. Barack Obama venait tout juste, à l'époque, de faire son apparition sur la scène nationale, après sa victoire dans l'élection sénatoriale de l'Illinois.
La météorique ascension de Barack Obama…
"I'm in, I'm in to win!" ("je suis dans la course et je suis là pour gagner!"), cette déclaration, qui ne s'est pas avérée prémonitoire, a inauguré le début officiel de la campagne d'Hillary Clinton le 20 janvier 2007, deux ans tout juste avant le jour où elle se voyait prêter serment pour devenir le, ou plutôt la 44e présidente des États-Unis. Ce n'est pas seulement le goût du symbole qui a poussé Hillary Clinton à choisir le 20 janvier: trois jours plus tôt, l'un des deux sénateurs de l'Illinois, Barack Obama, avait envoyé à la commission électorale le dossier qui formalisait son intention d'être candidat. Sa candidature a été annoncée officiellement le 10 février suivant.
Il est difficile aujourd'hui, quand on considère l'adulation mondiale que suscite B. Obama, de se souvenir à quel point il était un inconnu… il y a seulement 4 ans. En 2004, il n'était considéré comme précoce dans aucun domaine. À son âge, John Fitzgerald Kennedy était président, Bill Clinton avait été élu deux fois gouverneur de l'Arkansas et Al Gore avait derrière lui deux mandats de sénateur des États-Unis. Barack Obama ne pouvait se prévaloir que d'une carrière locale: il a été élu en 1996 au Sénat de l'Illinois et n'a jamais occupé de poste de responsabilité dans le secteur privé. Son élection au Sénat des États-Unis doit beaucoup à la chance. Ses deux rivaux, d'abord dans les primaires démocrates, ensuite lors de l'élection générale, ont été mêlés à des affaires de divorce qui ont, dans le premier cas, plombé et, dans le second cas, coulé leur candidature. Des l'été 2004, B. Obama était pratiquement assuré de sa victoire.
Au mois d'août, auréolé de la certitude d'être seulement le troisième Noir en un siècle à siéger au Sénat des États-Unis, il est invité à prendre la parole comme Keynote Speaker à la Convention démocrate qui va designer John F. Kerry. Ce rôle n'attire généralement pas beaucoup d'attention car les orateurs de début de soirée ne sont là que pour faire patienter le public qui s'installe. Mais lorsque B. Obama apparaît, un grand silence se fait dans la salle. Quatre ans plus tard, beaucoup de ceux qui étaient là se souviennent encore de ses mots, lorsqu'il parle de "l'espérance d'un petit garçon maigre, avec un drôle de nom, qui croit que l'Amérique a une place pour lui aussi…".
"Hope", l‘espérance, derrière ce concept il y a un homme qui va porter le destin présidentiel de B. Obama : David Axelrod. Ce nom est déjà connu à Chicago, où il est le consultant politique le plus respecté des politiciens démocrates. Il connaît B. Obama depuis les années 1990 et a déjà flairé chez lui des qualités politiques exceptionnelles. D. Axelrod a travaillé pour de nombreux candidats démocrates, il a aussi étudié les méthodes de ses concurrents et en particulier le travail de Karl Rove pour "vendre" à deux reprises la candidature de George W. Bush. Il en a tiré une théorie: le candidat doit représenter un concept et ce concept doit coïncider avec sa biographie. Barack Obama, fils d'un étudiant kenyan et d'une mère américaine, ancien élève d'Harvard, devenu travailleur social dans les quartiers noirs de Chicago, représente une histoire singulière et il a la magie du verbe pour la raconter.
David Axelrod va en quelque sorte rôder la campagne présidentielle de B. Obama avec celle d'un autre de ses clients : Deval Patrick, élu en 2006 premier gouverneur noir du Massachusetts. Il est de la même génération qu'Obama, il se présente dans un État où la population noire ne représente qu'un peu plus de 6%, soit la moitié de la moyenne nationale, et qui élit alternativement des gouverneurs démocrates et républicains. Deval Patrick parle lui aussi d'espoir et de changement, et l'on entend lors de ses réunions électorales un slogan qui deviendra célèbre pendant les immenses rallyes Obama : "yes, we can!".
Lorsque Barack Obama déclare sa candidature, David Axelrod a préparé la mise en scène de l'événement, devant le Capitole de l'Illinois, à Springfield. Son adjoint, David Plouffe devient directeur de campagne et va déployer dans ce poste une remarquable créativité. La tactique de la campagne Obama figurera sans doute dans les manuels des politologues au chapitre "organisation de terrain". Elle va systématiquement ratisser les États clés des primaires pour recruter des volontaires, qui eux-mêmes recruteront des électeurs. Contrairement à la campagne d'Hillary Clinton, celle de Barack Obama a compris l'importance des caucus, ces assemblées désuètes où le candidat est désigné au cours d'une délibération publique. Quelques agents locaux d'un candidat peuvent retourner un caucus. Encore faut-il, pendant des mois, les avoir repérés et formés dans les moindres recoins de l'État.
C'est ainsi que Barack Obama prend par surprise Hillary Clinton et John Edwards dans l'Iowa, lors de la première épreuve des primaires, le 4 janvier. Mais la première manifestation de la montée en force du sénateur de l'Illinois a eu lieu un mois plus tôt, sans que l'on ait vraiment, sur le coup, pris la mesure de l'événement. Le 3 décembre 2007, une grande réunion électorale est organisée à Columbia, la capitale de la Caroline du Sud. Barack Obama doit se tenir aux côtés d'Oprah Winfrey, une afro-américaine, qui est l'une des plus grandes vedettes de la télévision américaine. Dès le matin une file d'attente fait plusieurs fois le tour du stade où se tient le rassemblement. Lorsque Barack Obama apparaît, vers 15 heures, plus de 20000 personnes, presque toutes noires, sont installées sur les gradins. Cette manifestation prendra tout son sens le 26 janvier suivant, lors des primaires démocrates de Caroline du Sud. Barack Obama devance Hillary Clinton de 25 points, grâce à une mobilisation sans précédent de la communauté noire. Dans les semaines suivantes, il remporte une série de victoires dans les États du Sud, à forte majorité noire. Mais aussi dans l'Ouest. Obama est désormais un candidat qui peut gagner.
La longue agonie d'Hillary
À une journaliste qui lui demandait en 2007: "Est-ce que vous pensez à ce que vous éprouverez si vous n'êtes pas élue présidente ?", Hillary a répondu avec aplomb: "Non, parce que je serai présidente". Elle ne doutait pas, en tout cas, d'être la candidate du Parti démocrate. Les premiers sondages lui donnaient raison, même s'il s'est avéré par la suite qu'ils étaient dus en partie à un phénomène que l'on appelle "name recognition" -les personnes interrogées désignent la personne qu'ils connaissent, et tout le monde connaissait H. Clinton, en bien ou en mal. Cette assurance lui a sans doute été fatale ! La campagne Clinton ne semblait pas avoir envisagé la possibilité d'avoir à se battre… et de perdre. Pendant un moment, elle a été tétanisée par l'incrédulité.
Hillary Clinton a connu deux moments publics de détresse. Pendant les primaires du New Hampshire, au lendemain de sa défaite dans l'Iowa, elle s'est laissée aller à verser quelques larmes qui ont, peut-être, provisoirement sauvé la situation. L'électorat féminin s'est mobilisé pour elle. Le second a eu lieu le 12 février au soir de ce que l'on appelle les "primaires du Potomac". Barack Obama avait gagné les trois compétitions de la région de Washington: le Maryland, la Virginie et le District of Columbia, qui venaient s'ajouter à cinq précédentes victoires consécutives. Une semaine plus tôt, le Super Tuesday, où une vingtaine d'États concourraient en même temps, les avait laissés à égalité. Mais ce soir-là B. Obama venait de prendre l'avantage dans le décompte des délégués nécessaires pour être désigné par la Convention.
Il y avait du verglas à Washington quand Hillary Clinton a embarqué pour l'étape suivante, le Texas, sans même attendre la proclamation des résultats. Les caméras l'ont suivie, grimpant péniblement la passerelle de l'avion, la tête courbée sous les intempéries et la défaite.
Le Texas et l'Ohio ont donné un nouveau souffle à sa candidature, elle a ensuite remporté la Pennsylvanie et une série d'États du centre et du Middle West qui lui ont permis de se présenter comme la championne de l'Amérique rurale et ouvrière.
Les autres candidats démocrates, ils étaient dix au départ, ont abandonné un à un. John Edwards, qui faisait partie du trio de tête, n'a même pas résisté jusqu'au Super Tuesday !
Pendant quatre mois, Hillary Clinton et Barack Obama se sont retrouvés dans un face-à-face qui n'a pas toujours été joli à voir. Ce long affrontement a donné des sueurs froides aux démocrates qui n'ont pas ménagé les critiques contre H. Clinton, lui reprochant de ne pas avoir cédé la place plus tôt. Mais il s'est avéré que cette bataille a été bénéfique à B. Obama, en lui permettant d'affiner la tactique qu'il allait ensuite employer contre le candidat républicain.
L'aspect le plus dommageable des affrontements entre les deux candidats démocrates a sans doute été leur bataille larvée sur la question raciale. Que ce soit lors des primaires démocrates, ou lors de la campagne pour l'élection générale, la question raciale a toujours été un champ de mines, autour duquel ont tourné les candidats, chacun accusant l'autre, périodiquement, de jouer en sourdine sur ce registre. Il y eut moins de retenue sur deux autres tabous, le sexisme, et ce que l'on pourrait appeler l'"âgisme".
Le fait que cette campagne mette en scène, parmi les finalistes, un Noir, deux femmes, et le candidat le plus âgé de l'histoire des États-Unis, a alimenté bien des passions sous-jacentes.
McCain, le revenant
La désignation de John McCain a été une leçon d'humilité pour tous les commentateurs qui, pendant l'été 2007, avaient annoncé sa mort politique. Ils avaient quelques raisons de le faire. Au mois d'août 2007, J. McCain avait licencié l'état-major de sa campagne, il était au troisième rang dans les sondages, 20 points derrière Rudi Giuliani et devancé par l'ex-sénateur du Tennessee devenu acteur, Fred Thompson.
Que s'était-il passé? Depuis qu'il avait annoncé sa candidature au mois d'avril, J. McCain n'était pas arrivé à se positionner. L'aile la plus conservatrice du parti républicain ne lui pardonnait pas d'avoir dénoncé certains de ses dirigeants, en 2000, comme des "agents de l'intolérance". Il avait défendu un dossier dont l'impopularité était encore fraîche dans les esprits, celui de la réforme de l'immigration. Son soutien au surge (l'augmentation des troupes en Irak), n'avait reçu aucune sanction positive des événements. Le fait qu'avec le temps les passions se soient calmées sur l'immigration, et que la situation se soit améliorée en Irak, a sans doute contribué à sa résurrection, mais cette dernière est surtout due à la stratégie de son adversaire principal.
À l'automne 2007, tandis que J. McCain reprenait la route à bord de son autocar fétiche, le Straight talk express ("l'express du franc-parler"), à New York R. Giuliani et son entourage concoctaient un plan d'action qui allait s'avérer fatal. L'ancien maire savait, qu'encore moins que John McCain, il n'avait de chance auprès des électeurs conservateurs, essentiellement à cause de son soutien à la liberté de choix sur l'avortement. Il faut aussi ajouter qu'aussi populaire que soit la ville de New York dans le reste du monde, elle est considérée dans une grande partie des États-Unis comme un territoire étrange, pour ne pas dire étranger.
L'idée était de court-circuiter les premières compétitions, qui se déroulaient essentiellement dans des États ruraux et conservateurs, pour démarrer sur la Floride, un État divers où vivent des nombreux transfuges de la ville de New York et d'y remporter un succès sans appel, qui permettrait de rebondir en force, le mardi suivant, dit le Super Tuesday, où vingt États étaient en compétition. Au soir du 12 février, R. Giuliani devait, grâce à ce scénario, avoir verrouillé la nomination. Cela n'a pas marché. Les primaires ont beau avoir un rythme absurde, ce rythme est têtu. Tandis que R. Giuliani ratissait la Floride, J. McCain gagnait le New Hampshire, le Michigan, la Caroline du Sud… et finissait dans la foulée, par gagner la Floride. Il ne restait plus à R. Giuliani, qui avait mis tous ses œufs dans le même panier, qu'à plier bagage. Il a depuis fait loyalement campagne pour son ancien adversaire.
John McCain n'avait pas encore tout à fait les mains libres. Il restait en face de lui deux adversaires de poids, qui avaient les faveurs de l'électorat conservateur. Le premier, Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas et ancien pasteur baptiste, s'est battu sur le front des valeurs morales. Cela ne veut pas dire qu'il s'est signalé par son austérité. M. Huckabee restera dans la petite histoire pour la réplique la plus drôle de la campagne. À quelqu'un qui lui demandait: "Que pensez-vous que Jésus ferait à votre place ?", il a répondu "Jésus est bien trop malin pour se présenter à une élection !".
Mike Huckabee s'est retiré de la course le 4 mars, au Texas, après un beau succès dans les États du vieux Sud. Un peu plus tôt était parti le candidat le plus riche de la compétition, Mitt Romney, ancien gouverneur du Massachusetts, qui aurait mis 40 millions de dollars (M$) de sa propre fortune dans sa campagne. Il était le favori des conservateurs économiques, mais son appartenance à la religion mormone suscitait des réticences, qui en faisaient un candidat improbable.
Underdog au début, underdog à la fin
Pour John McCain, la nomination du Parti républicain a été une revanche, après l'humiliation de 2000 où il avait dû quitter la course, victime d'une campagne de dénigrement attribuée à l'entourage de George W. Bush. L'ironie veut que George W. Bush soit indirectement au cœur de ses difficultés, une nouvelle fois, en 2008, le camp démocrate l'ayant associé sans relâche à un président impopulaire, dont il partage l'étiquette politique. John McCain a pourtant fait du refus des étiquettes la base de sa stratégie politique. Il se décrit comme un maverick, un terme qui désigne les esprits libres, les anticonformistes. Il est vrai qu'il a souvent été en désaccord avec les républicains, tout autant qu'avec les démocrates.
Dans cette campagne, John McCain a également incarné de façon presque constante, le rôle de ce que l'on appelle l'underdog, littéralement le "sous-chien", bref le candidat qui n'a pas le dessus !
Les républicains lui ont beaucoup reproché de ne pas avoir mis à profit l'affrontement des deux candidats démocrates pour consolider ses positions. Face à la campagne Obama, réglée comme une horloge, la sienne semblait naviguer à vue et souvent par temps de brouillard.
Le candidat lui-même a souvent honoré sa réputation de candeur par des déclarations qu'il aurait mieux fait de garder pour lui, comme le jour où il a dit que l'économie n'était pas son point fort, ou que les fondamentaux de l'économie américaine étaient solides. Ces déclarations sont venues le hanter, lorsqu'au mois de septembre 2008, la crise financière est entrée dans une phase aiguë.
John McCain dit qu'il n'est jamais aussi à l'aise que dans les situations difficiles. Elles font partie de son histoire, qui est extraordinaire. En 1967, alors qu'il était pilote de chasse, son avion a été abattu au-dessus du Nord-Vietnam. Pendant six ans, il a été prisonnier et a subi un traitement d'autant plus cruel qu'il représentait un symbole aux yeux de ses geôliers nord-vietnamiens. Son père était un amiral à quatre étoiles de l'US Navy. Il aurait pu être libéré en échange d'un désaveu de la guerre, son refus lui a valu des tortures supplémentaires, qui l'ont mutilé à vie. John McCain est considéré comme un héros national. Selon la "méthode Axelrod", qui a façonné la campagne Obama, il aurait pu bâtir sa candidature sur son histoire si les circonstances avaient été en adéquation avec son personnage. Mais il se trouve que la sécurité nationale, qui avait dominé l'élection précédente, était passée au second plan. La crise économique a été l'assommoir de sa campagne.
Un site humoristique, Jibjab.com, qui capture remarquablement l'essence des campagnes électorales, a représenté Barack Obama en personnage magique caracolant au-dessus des contingences électorales de ses concurrents. Le candidat démocrate semble en effet avoir un état de grâce qui lui a permis de survoler des épisodes aussi périlleux que les déclarations télévisées de son pasteur et ami de 20 ans, tenant des propos hostiles à l'Amérique blanche !
Au milieu de l'été 2008, la magie n'était pas dans le camp du candidat républicain. Mais jusqu'où iront les Conventions !
Le 25 août, la Convention démocrate s'est ouverte à Denver dans le Colorado. Le 28, 45 ans jour pour jour après le discours de Martin Luther King, "I have a dream", pour la première fois de l'histoire des États-Unis, un candidat noir a accepté la nomination d'un grand parti.
Après le discours de Barack Obama dans un stade contenant 70000 personnes, il semblait que la Convention républicaine fût condamnée à un ennui profond. Une fois encore, le caractère exceptionnel de cette campagne avait été sous-estimé !
Quatre jours plus tard, à St Paul Minneapolis, la Convention républicaine a eu la particularité inédite d'être différée pour cause d'ouragan à l'autre extrémité du Mississippi. Une tempête se dirigeait vers la Nouvelle-Orléans, menaçant de rééditer le désastre de Katrina. John McCain a suspendu les réjouissances de Minneapolis et converti les délégués républicains en secouristes, qui se sont retrouvés à emballer des objets de première nécessité pour les futurs sinistrés. Les festivités n'ont repris qu'après le passage de la tempête, et après le moment où George W. Bush et Dick Cheney auraient dû prendre la parole lors de la Convention. Ce contretemps est apparu comme une grande manœuvre de J. McCain, qui ne souhaitait pas plus l'arrivée du tandem présidentiel, que la Nouvelle-Orléans une dépression de force 5…
Cette convention a été aussi celle de la grande surprise J. McCain: la présentation de sa colistière Sarah Palin, gouverneur de l'Alaska, et jusqu'alors quasi inconnue, en dehors de cet État excentré. S. Palin, une jeune et belle femme au verbe haut, se présente comme une "hockey mom", une maman ordinaire qui accompagne ses enfants aux matches de hockey. On pourrait comparer son arrivée dans la campagne à une manœuvre qu'emploient souvent les coaches de ce sport nordique et qui s'appelle: "sortir le goal". Lorsqu'en fin de partie une équipe est dominée, le coach enlève le gardien de ses buts, pour qu'il renforce l'attaque dans le camp adverse. C'est une opération risquée, car ou bien le goal aide à marquer un but, ou bien l‘équipe adverse fait un carton dans des buts dégarnis. Il semble que l'opération Palin soit à ranger dans cette seconde catégorie.
La rumeur était que John McCain aurait voulu mettre sur son ticket son vieil ami le sénateur démocrate Joseph Lieberman, qui avait été le colistier d'Al Gore en 2000. Cela lui aurait coûté des voix dans l'électorat conservateur, enthousiasmé par la personnalité de S. Palin dont l'arrivée a coïncidé avec un durcissement du ton de la campagne McCain -durcissement qui a fait perdre au centre ce qui avait été gagné aux extrêmes.
Barack Obama a sans doute fait un choix moins risqué en choisissant comme colistier Joe Biden, qui a passé la moitié de sa vie au Sénat, où il est surtout connu pour un amour non maîtrisé du verbe. Il y a en tout cas gagné, à l'ancienneté, l'expérience que l'on disait faire défaut au candidat démocrate.
Un vainqueur, l'argent
Cette saga ne serait pas complète si l'on n'y ajoutait l'un des personnages principaux: le dollar. Au mois de septembre, la campagne Obama a recueilli 150 M$. C'était inimaginable dans un passé récent. Cela représente la somme que George W. Bush et John Kerry ont dépensée à eux deux pendant leurs deux derniers mois de campagne. La campagne Obama revendique plus de 3 millions de donateurs, soit en gros une personne sur 300 aux États-Unis. Mais, contrairement à une légende, ce n'est pas un afflux de petits dons sur Internet qui a rempli ses coffres. Ils existent, certes, mais d'après les analyses des documents financiers de la campagne, qui sont du domaine public, les dons inférieurs à 200 dollars ne représentent qu'un quart des rentrées. C'est un pourcentage comparable à celui des donateurs de la campagne Bush en 2004 (Washington Post, 22 octobre 2008).
L'un des mouvements stratégiques les plus payants du candidat démocrate a été de revenir sur sa promesse d'utiliser, dans la dernière ligne droite de sa campagne, un financement public, qui l'aurait limité à 85 M$ comme son rival républicain.
Hillary Clinton aurait dû commencer à s'inquiéter lorsqu'en février 2007, à un an des primaires en Californie, Barack Obama recueillait 1,3 M$ en une seule soirée à Hollywood !
L'argent a toujours été un signe avant coureur de la montée en puissance de B. Obama. Il a été, d'un bout à l'autre de la campagne, mieux financé que ses adversaires, ce qui lui a permis de jouer avec eux au jeu des Horaces et des Curiaces, en les obligeant à disperser leur forces. Hillary Clinton a terminé sa campagne ruinée (métaphoriquement) après avoir essayé de contrebalancer les achats d'espaces publicitaires de la campagne Obama. Lorsque que s'est ouverte la bataille pour l'élection générale en juin 2008, la campagne d'Obama a lancé un "blitz" publicitaire dans 18 États, dont certains n'étaient pas considérés comme des champs de bataille. En Virginie, elle a mobilisé quatre fois plus d'argent que la campagne McCain, en Caroline du Nord huit fois plus.
Mais, comme on dit aux États-Unis, "l'argent parle" et il a été le reflet du potentiel que représentait le candidat démocrate. S'il fallait isoler l'une des qualités qui ont porté B. Obama dans cette campagne, ce serait sans doute l'optimisme. Un sondage réalisé à la mi-octobre pour ABC News donnait un quotient d'optimisme de 2 contre 1 à la candidature Obama contre la candidature McCain. On retrouve la même proportion dans l'enthousiasme des supporters des uns et des autres: 52 % des électeurs potentiels d'Obama se disent enthousiasmés par leur candidat, contre 26% de ceux favorables à McCain. Au pays de la pensée positive, c'est sans doute le meilleur signe de la réussite d'une campagne.