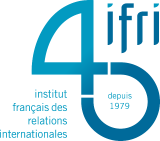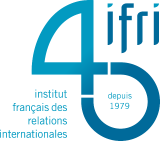Le système social américain Chroniques électorales américaines, n° 10, octobre 2008

La grave crise financière que les États-Unis traversent à l'automne 2008 a mis en lumière la fragilité du système social américain. Celui-ci dépend en effet largement des entreprises, qui gèrent l'assurance-maladie et une partie des retraites de leurs employés. Une personne qui perd son travail perd donc, du même coup, une grande partie de sa couverture sociale. Une autre part importante du réseau de protection relève de la responsabilité individuelle. Elle est financée par une épargne généralement placée en bourse. Les conséquences des soubresauts économiques ont donc des répercussions sur la vie quotidienne des citoyens, dont on ne soupçonne pas l'ampleur à l'étranger.
On pourrait dire que système social américain est à beaucoup d'égards l'illustration de la formule bien connue de Fernand Raynaud, "il vaut mieux être riche et bien portant que malade et sans le sou". Avec plus de 40 millions de personnes sans couverture sociale, ce qui est sans égal pour un pays développé, la réforme de l'assurance-maladie a été l'un des grands dossiers de cette élection présidentielle. Il existe néanmoins des services sociaux, même si ce que l'on appelle le Welfare, l'assistance de l'État, a été démantelé en 1996 sous la signature d'un président démocrate, Bill Clinton.
Les retraites
La Social security est la base de la protection sociale américaine, et elle n'a rien à voir avec la traduction littérale française " sécurité sociale ". Créée en 1935, par Franklin D. Roosevelt, elle assure une retraite de l'État, une assurance chômage, et des pensions pour invalidité.
La Social security est la seule protection sociale universelle aux États-Unis. Elle fonctionne par répartition: 12,4% des salaires sont versés à un fonds, les cotisations étant partagées à parts égales entre l'employeur et l'employé. Le volet retraite peut être perçu à partir de 62 ans, mais plus le bénéficiaire attend, plus la somme augmente. Les retraites assurées par la Social security sont la base d'une pyramide à trois étages, les deux autres étant les fonds de pension et la capitalisation individuelle. Pour 60% des retraités américains, le chèque mensuel de l'État constitue la source unique, ou essentielle, des revenus.
Aux États-Unis la protection sociale est en grande partie à la charge des entreprises. Jusqu'à un passé récent, les grandes entreprises offraient des pensions confortables auxquelles les employés contribuaient en cotisant sur la base du volontariat. Les plus généreuses étaient celle des travailleurs de l'automobile, négociées à l'âge d'or de cette industrie, après la dernière guerre mondiale. Elles offraient une retraite et une assurance-maladie couvrant l'ensemble des soins pour les employés et leur famille, la totalité de la retraite et la prise en charge des soins étaient assurées pour le conjoint jusqu'à sa mort. Ce système est considéré comme en partie responsable des difficultés extrêmes que traversent les trois géants américains General Motors, Ford et Chrysler. La protection sociale des retraités et de leurs veuves représente un surcoût de 1400 dollars ($) par véhicule produit à Detroit. Lors de négociations historiques, les constructeurs ont donc révisé ces contrats avec le tout puissant syndicat de l'automobile United Auto Workers (UAW) qui, avec un réalisme qui n'a pas toujours été apprécié par ses adhérents, a reconnu que la survie de leur activité était à ce prix.
Ce syndicat est lui-même en perte de vitesse, car les constructeurs étrangers qui s'installent dans des États américains pratiquant the right to Work ('le droit de travailler') -essentiellement dans le sud des États-Unis, où se développe une nouvelle grande région industrielle- échappent à ses contraintes. Les employés n'y sont syndiqués que s'ils le souhaitent, les syndicats ne contrôlant pas l'embauche ou les salaires comme dans les États du nord. Quel que soit le régime, les salaires ne sont pas très différents, puisqu'ils sont dictés par la loi du marché, mais la prise en charge des retraites peut être réduite. Les prestations sociales offertes par une entreprise relèvent en effet d'un contrat privé qui peut être renégocié.
De plus en plus souvent, la retraite est assurée par le troisième étage de la pyramide: l'épargne individuelle. Cette dernière est encouragée par les grandes et moyennes entreprises qui offrent ce que l'on appelle un 401K, du nom du paragraphe de la loi qui l'a institué. Le principe est simple: l'employé investit chaque mois une fraction de son salaire dans un portefeuille. L'entreprise contribue à ce portefeuille en versant une somme soit équivalente, soit supérieure, soit inférieure. La composition de ce portefeuille est déterminée par l'employé, en fonction de son goût du risque. Il est recommandé de panacher au maximum ses investissements, mais certaines entreprises incitent leurs employés à privilégier leurs propres actions: c'est ce qui a largement provoqué la ruine des employés d'Enron, qui avaient été poussés à investir massivement dans leur compagnie.
Lors de la tempête qui a secoué la bourse au début du mois d'octobre, certains Américains ont ainsi perdu jusqu'à 20% de leur épargne retraite en une dizaine de jours. Beaucoup de ceux qui s'apprêtaient à quitter le monde du travail reconsidèrent leur décision en attendant de savoir quel pourra être, au bout du compte, le montant de leur capital.
Puisqu'il n'y a pas d'âge de la retraite obligatoire aux États-Unis, les Américains quittent le monde du travail lorsqu'ils s'estiment prêts, financièrement ou psychologiquement. Certains y restent jusqu'à la fin de leur vie; d'autres y reviennent, par ennui ou par nécessité. On assiste actuellement à deux phénomènes. D'une part beaucoup de retraités ont sous-estimé leur espérance de vie et voient leurs économies disparaître avant eux. D'autre part, ceux qui ont misé l'essentiel de leurs revenus sur un portefeuille boursier, ou sur la valeur de leur maison, sont soumis aux fluctuations de marché, et sont parfois obligés de se remettre à travailler à un âge avancé. Les répercussions de cette situation sur le marché de l'emploi sont une des grandes inconnues de la crise actuelle.
L'assurance-maladie
Face à une offre de travail, un Américain regarde souvent les benefits, c'est-à-dire essentiellement la qualité de l'assurance-maladie qu'offre son entreprise… si tant est qu'elle en ait une! En effet, les petites entreprises n'ont souvent pas les moyens de payer les cotisations de leurs employés.
L'État ne prend en charge les dépenses de santé que sous deux formes: Medicaid qui est destiné aux indigents, et Medicare qui couvre en partie les personnes de plus de 62 ans, c'est-à-dire ceux qui sont éligibles à la retraite.
Contrairement à une idée répandue, les hôpitaux ne laissent pas mourir dans la rue ceux qui n'ont pas les moyens de payer leur facture. Une loi fédérale interdit de refuser de soigner une personne malade. La conséquence en est l'émergence d'une médecine d'urgence, où les malades attendent d'être très mal en point pour se faire soigner. L'absence de prévention fait que, malgré toutes ses insuffisances, le système de santé américain revient horriblement cher.
Le sixième de la population qui n'est pas assuré se trouve à la confluence de deux phénomènes : certains ne veulent pas s'assurer parce qu'ils n'en voient pas l'utilité, et d'autres ne peuvent s'assurer parce qu'aucune formule n'est disponible pour eux. La majorité des assurances sont fournies par des compagnies privées. Elles peuvent refuser de couvrir un type de traitement, chaque acte qui sort de l'ordinaire faisant l'objet d'une demande préalable. Elles peuvent refuser de couvrir une maladie qui relève de ce que l'on appelle une pre-existing condition: un problème de santé antérieur à l'adhésion du souscripteur. Pour cette même raison, les assurances privées peuvent refuser un souscripteur individuel qui présente un trop grand risque financier, et même annuler sa couverture en cours de route. Certains États américains interdisent cependant cette dernière pratique.
Des trois candidats principaux à l'élection présidentielle de 2008, seule Hillary Clinton a proposé un système de santé universel. Barack Obama s'y est rallié après sa victoire dans les primaires, ce qui a constitué une concession majeure à son adversaire. Il proposait initialement un système accessible à tous mais sur la base du volontariat. John McCain propose quant à lui des crédits d'impôt pour aider les familles à souscrire une assurance. Mais aucun n'envisage de mettre le système entre les mains de l'État. Il s'agit en fait de mettre bout à bout toutes les possibilités existantes, celles du gouvernement fédéral, celle des États, celles des entreprises, et d'offrir à tous ceux qui passent entre les mailles du filet des aides d'État pour qu'ils puissent s'assurer, sans que les compagnies puissent refuser leur adhésion.
Le monde du travail
Aux États-Unis, il est très facile de licencier, à condition que l'éviction d'un employé ne tombe pas sous le chapitre des diverses discriminations sexistes ou ethniques. On peut se retrouver sans travail littéralement d'une heure à l'autre, le salarié étant prié d'emballer ses affaires et de quitter les lieux. Les indemnités font partie d'un severance package, qui relève de la politique de l'entreprise, ou de ce qui a été négocié au moment de l'embauche. Il existe un programme national d'assurance chômage, financé par les cotisations des employeurs et géré conjointement par l'État fédéral et les États, ce qui signifie qu'il n'est pas tout à fait le même d'un État à l'autre. Une allocation est versée pendant 26 semaines, en moyenne de $290 par semaine. La Chambre des représentants a voté une loi doublant le temps d'indemnisation, mais le texte n'est pas encore passé au Sénat, et il est douteux qu'il voie le jour pendant la session 2008.
Il n'existe pas de congé de maternité obligatoire. Celui-ci se négocie avec l'entreprise, généralement sous forme de congé sans solde. Les futures mères travaillent souvent jusqu'à quelques jours avant l'accouchement. Il n'existe pas non plus de vacances obligatoires, sauf pour les jours fériés. Là encore, les congés se négocient avec les entreprises, les Américains s'en octroyant en moyenne 12 jours par an. Certains ne prennent même pas les congés dont ils pourraient disposer.
L'éducation
Comme beaucoup de choses aux États-Unis, la scolarité relève des États et de non de l'État fédéral. Ce sont les États qui, par exemple, fixent la période pendant laquelle la scolarité est obligatoire. Elle commence généralement à 6 ans. Certains États, dans lesquels les parents sont particulièrement enclins à pousser la formation de leurs enfants, ont été obligés de fixer également un âge minimum: un ou deux ans. Dans la majorité des États, il est obligatoire d'aller à l'école jusqu'à 18 ans, dans les autres, l'âge maximum se situe entre 16 et 17 ans. La scolarité est divisée en 12 niveaux, représentant normalement une année d'étude, au terme desquels l'élève reçoit un high school diploma, nécessaire pour entrer à l'université. Environ 70% des élèves passent et réussissent l'examen qui y donne accès.
Contrairement à ce que l'on croit souvent, le système scolaire américain est essentiellement public. Jusqu'à l'entrée à l'université environ 9 élèves sur 10 fréquentent une école publique. Celles-ci sont financées à moins de 10% par l'État fédéral, le reste étant partagé entre les États et les collectivités locales. L'État fédéral n'intervient que pour définir les grands principes de l'éducation, comme la qualification des enseignants ou la standardisation des programmes et des examens. Les États ont d'ailleurs eux-mêmes une influence sur le contenu de l'enseignement, comme en témoignent les batailles sur l'introduction de théories autres que le darwinisme dans les programmes de sciences naturelles.
Ce mode de gestion local entraîne une grande disparité dans la qualité de l'école publique. La proximité d'une bonne école est un facteur important dans le choix d'un lieu de résidence, et a une incidence sur le prix de l'immobilier. Pendant sa présidence, George W. Bush a poussé un système de vouchers: allocations de l'État aux familles modestes qui souhaitent éduquer leurs enfants dans une école privée. Bien que, d'une façon générale, le système américain consomme beaucoup d'argent et de moyens (90% des élèves ont par exemple accès à un ordinateur), les performances des élèves sont en moyenne inférieures à celles des grands pays européens, et de l'Inde, particulièrement dans le domaine des sciences et des mathématiques.
Il existe au États-Unis une pratique étonnamment répandue, le home schooling: l'éducation à la maison. Entre un et deux millions d'enfants et d'adolescents seraient éduqués selon ce système. Le flou des chiffres provient du fait que dans un grand nombre d'États, les parents ne sont pas obligés de déclarer qu'ils enseignent eux-mêmes à leurs enfants. Poussé à ses limites, le home schooling est un moyen de détourner de la scolarité obligatoire. Le District de Columbia, par exemple, vient tout juste de réinstaurer un contrôle sur l'éducation à la maison, après 17 années de vide juridique absolu. Le niveau de régulation de cette forme d'enseignement varie en effet grandement selon les États. Certains ne se préoccupent pas du degré de compétence des parents, et permettent aux enfants d'échapper aux tests de contrôle et aux vaccinations obligatoires. À l'autre bout du spectre, la Californie exige que les parents aient un diplôme d'enseignant, mais cette clause est actuellement contestée devant la Cour suprême de l'État. La motivation principale des parents est bien souvent d'ordre moral ou religieux.
Contrairement à l'école publique, les universités sont payantes et le coût d'une inscription, quoique l'éventail de prix soit très large, reste cher. La tuition (" droits de scolarité ") est en moyenne de $6 000 pour une université publique, et de $23 000 pour une université privée. Son montant varie aussi, généralement du simple au double, pour les universités publiques, selon que les parents ou l'étudiant sont ou non résidents de l'État.
Afin de pouvoir leur faire suivre des études supérieures, les parents qui le peuvent ouvrent des comptes d'épargne dès la naissance de leurs enfants, et sollicitent fréquemment la participation des grands-parents et des proches. Et si les étudiants disposent par ailleurs de nombreuses aides (prêts de l'État, bourses attribuées par l'université elle-même ou par diverses fondations privées), au bout du compte, 60% d'entre eux se trouvent dans l'obligation d'emprunter pour les financer. Leur niveau moyen d'endettement individuel étant de $20 000.
La réforme du Welfare
En 1996, le président Clinton a signé une loi mettant fin à 60 ans d'un système instauré au moment de la Grande dépression. Connu sous le nom de Welfare, il assurait inconditionnellement une allocation aux personnes vivant en dessous du niveau de pauvreté. Cette réforme a été élaborée par un Congrès républicain, mais Bill Clinton avait lui-même, pendant sa campagne électorale, annoncé la fin du "Welfare tel qu'il existe". Le nouveau programme a consisté à remettre le maximum de gens au travail. La tâche, déléguée aux États, a été remplie de manières diverses, mais avec efficacité. Des programmes de formations, de transport et de garde d'enfants ont été mis en place. Le nombre de familles vivant du Welfare est passé en 10 ans de plus de 5 millions à moins de 2 millions, les trois quarts de ces dernières étant dirigées par des femmes seules. Vingt-cinq millions de personnes, dont la plupart travaillent, mais dans des emplois peu payés, reçoivent des food stamps, des bons alimentaires.
Contrairement aux prévisions de la gauche américaine, la réforme de l'assistance d'État n'a pas jeté des millions de personnes à la rue. Elle a heureusement coïncidé avec une période d'expansion économique. La période de crise qui s'amorce amènera peut-être à réviser ce constat. Le réseau parallèle de la bienfaisance
Les Américains sont un peuple généreux. Cette générosité a atteint son comble en 2006, où 300 milliards de dollars de dons ont été enregistrés, soit près de la moitié du montant de l'actuel plan de sauvetage de l'économie américaine. Cela représente 1,7% du produit national brut (PNB), contre 0,14% pour les bonnes œuvres françaises. 70% des foyers font des dons à des œuvres charitables, 44% font du volontariat.
En fait, les Américains, naturellement rebelles à l'impôt, préfèrent donner volontairement ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur prenne. L'ironie étant que ces dons charitables sont déductibles des impôts dus à l'État, ce qui en fait une forme d'évasion fiscale.
Les plus gros bénéficiaires sont les communautés religieuses, qui reçoivent plus du tiers de donations. Si elle n'est pas respectée stricto sensu, la tradition judéo-chrétienne de la dîme inspire les comportements. Les mormons sont seuls tenus de reverser 10% de tous leurs revenus, y compris les héritages, à leur Église. Mais dans les autres confessions, les fidèles donnent aussi des sommes substantielles. Fortes de ces énormes revenus, les communautés religieuses sont devenues un véritable réseau social parallèle, subventionnant d'immenses hôpitaux comme le Presbyterian de New York ou les hôpitaux baptistes du sud. Elles assurent des soupes populaires, des programmes pour les sans-abri, les mères célibataires, ou les toxicomanes.
Sans être un cas social, un Américain sait qu'il peut trouver en cas de besoin un secours matériel et un réseau d'entraide auprès de son groupe de soutien spirituel. Le système a montré son efficacité au moment de l'ouragan Katrina, les Églises ayant été seules à même de mobiliser immédiatement des secours que l'État fédéral et l'État local s'avéraient incapables d'apporter. Les Américains sont-ils prêts pour un vrai système social?
Si les Américains envient le système de protection social d'un pays comme la France, ce sentiment s'efface lorsqu'ils comprennent le coût qu'il représente pour les individus. L'absence de contraintes sociales est l'un des facteurs du dynamisme de l'économie américaine. Les créations d'emplois se font sans arrière-pensée puisque les licenciements sont faciles, et que les petites entreprises engagent sans souci des charges sociales.
S'il y a un consensus en faveur d'un régime de couverture maladie accessible, un nombre surprenant de gens qui en auraient les moyens négligent de souscrire à une assurance. Les conseillers financiers ont du mal à persuader leurs clients qu'il faut commencer à économiser dès les premières années d'activité pour leur retraite. En fait, tout au long de sa vie, un Américain est censé se prendre en charge et gérer son avenir financier, en économisant pour sa santé, sa vieillesse, pour l'éducation de ses enfants, pour les mauvais jours… En contrepartie, il n'est pas accablé de prélèvements sociaux. Hormis à la gauche du Parti démocrate, le sentiment prévaut que l'individu est plus avisé que l'État sur la manière de dépenser son argent. Si cette philosophie peut s'épanouir en période de prospérité, elle risque pourtant d'être sérieusement remise en question dans la période de crise qui s'installe.