L'activisme commercial croissant de la Chine au sein de l'Asean et ses conséquences pour l'UE
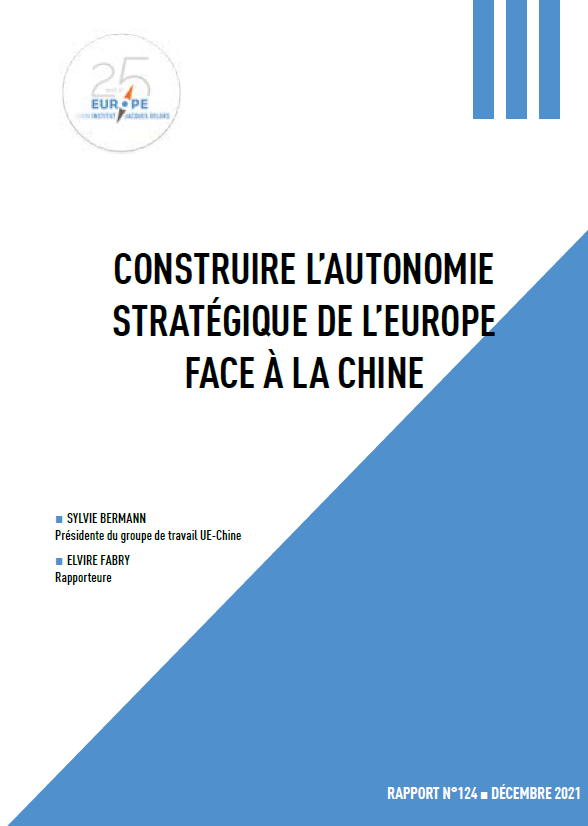
L’Institut Jacques Delors a constitué début 2021 un groupe de travail qui rassemble des chercheurs, universitaires, praticiens et représentants des milieux d’affaires émanant de divers Etats membres, pour se concentrer sur des enjeux structurants de la relation bilatérale UE-Chine. Françoise Nicolas formule des recommandations pour que l'UE développe ses relations avec l'Asie du Sud-Est où la Chine continue de gagner de l'influence.
Au cours des dernières années et ce, même si la Chine étend son empreinte en Asie du Sud-Est depuis la fin des années 1990, le pays est devenu de plus en plus actif dans la région, notamment dans le cadre de l’initiative phare du Président chinois Xi Jinping, la Belt and Road Initiative (BRI). L’activisme de la Chine dans la région est avant tout de nature économique et le commerce est le principal moyen pour elle de renforcer son influence sur cette partie du monde.
Le centre de gravité du monde s’étant déplacé vers l’Asie, L’Union européenne doit également y être présente. Elle doit développer ses relations avec les pays de la région longtemps négligés au seul profit de la Chine, c’est en particulier le cas des pays d’Asie du Sud-Est, où la Chine s’est fortement investie et continuera de gagner de l’influence après la ratification de l’Accord régional économique global (RCEP) de novembre 2020.
L’UE aurait intérêt à conclure la négociation engagée avec l’Indonésie, qui forte de près de 300 millions d’habitants sera d’ici à la fin de la décennie au minimum la cinquième économie mondiale. En outre, tout en donnant un nouveau souffle aux négociations bilatérales engagées avec la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines, elle doit travailler à la relance du projet d’accord avec l’ASEAN. L’UE ne devrait pas non plus écarter l’idée de rejoindre l’accord CPTPP, signé par onze pays de la région pacifique qui auront à cœur de peser avec des normes communes, et qui n’en aurait que plus de poids pour influencer les pratiques commerciales chinoises.
> Voir l’article sur le site de l’Institut Jacques Delors

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesTrump II et l'Asie : le vent se lève…
L'Indo-Pacifique est une priorité de l'administration Trump II, la Chine étant perçue comme le principal rival stratégique des États-Unis. Toutefois, Donald Trump a entamé son second mandat de manière déconcertante en durcissant les relations avec les partenaires traditionnels de Washington. Il a ensuite ouvert les hostilités avec Pékin, déclenchant une guerre commerciale plus intense encore que lors de son premier mandat. Les autorités chinoises n'entendent pas se laisser faire.
Chine-Inde : un rapprochement sous contrainte
En marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui s’est déroulé du 31 août au 1er septembre, le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré le président chinois Xi Jinping. Cette deuxième rencontre en moins d’un an reflète la volonté des deux pays de renouer le dialogue après une longue période de tensions, consécutive aux affrontements frontaliers dans la vallée de Galwan en juin 2020.
Élections au Japon. Le gouvernement en difficulté face à la montée des populismes
Les élections sénatoriales du 20 juillet 2025 ont marqué un tournant dans la vie politique japonaise.
La crise indo-pakistanaise du printemps 2025 : reflet d’un conflit en mutation
Les affrontements du 7 au 10 mai 2025, déclenchés après l’attentat de Pahalgam du 22 avril, représentent la plus grave escalade militaire entre l’Inde et le Pakistan depuis plus de 20 ans. Cette crise met en lumière des transformations profondes du conflit indo-pakistanais, analysées en détail dans ce Briefing de Sylvia Malinbaum.
















