Le solutionnisme technologique : vrais problèmes, fausses solutions ?
Benjamin Pajot, chercheur associé au Centre géopolitique des technologies de l’Institut français des relations internationales (Ifri), dresse « les fondements idéologiques et politico-économiques du solutionnisme technologique, ses ramifications et les conséquences qu’il entraîne pour l’ensemble de nos sociétés, afin d’en montrer les limites et d’identifier des moyens de s’en prémunir plus efficacement », sans omettre de rendre compte des alternatives, actuelles et à venir, qui permettraient de tracer « un horizon plus juste et durable ».

À force de coder, tous les problèmes du monde ressemblent à des bugs
Le solutionnisme technologique correspond à une vision du monde selon laquelle la technologie – et plus particulièrement les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle ou la géo-ingénierie – est la seule vraie réponse aux défis majeurs auxquels nos sociétés sont confrontées, qu’il s’agisse du changement climatique, de la crise énergétique ou même de la pauvreté. Cette approche tend à réduire la complexité des problèmes sociaux, politiques ou économiques en les ramenant exclusivement à des questions techniques, bien souvent au détriment d’une analyse globale des enjeux, la technologie constituant en outre « le point de départ plutôt que d’arrivée de la réflexion, conduisant à traiter les symptômes plutôt que les causes des enjeux considérés ». Cette vision est activement promue par les figures les plus influentes du secteur technologique et financier de la Silicon Valley, aux États-Unis, notamment par les membres de la « mafia PayPal » avec Peter Thiel (Palantir), Marc Andreessen et Ben Horowitz (Andreessen Horowitz), Elon Musk (Tesla/SpaceX) et par les figures du philanthro-capitalisme et des géants technologiques comme Bill Gates (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Larry Page (Google) ou encore Sam Altman (OpenAI).
Benjamin Pajot s’intéresse tout particulièrement à « l’avènement de l’État solutionniste et sa promotion active à travers le monde », qui se traduit par le passage généralisé des États autoritaires et démocratiques vers « des sociétés de surveillance, où les autorités publiques recourent de plus en plus à des technologies pour surveiller les citoyens, tant individuellement que collectivement », et qui favorise « une privatisation progressive des services publics et de l’appareil d’État au profit des grandes entreprises technologiques qui acquièrent ainsi une influence considérable sur les politiques publiques sans disposer d’un mandat électoral ».
Comme il cite dans le rapport, « le Covid-19 est à l’État solutionniste ce que les attentats du 11-Septembre sont à l’État de surveillance ». Ces sociétés de surveillance généralisée opèrent tout à la fois à l’échelon individuel et collectif et versent, pour les régimes autoritaires, dans une forme d’hyper-contrôle. L’auteur prend pour exemple la vidéosurveillance algorithmique, qui « désigne la nécessité de recourir à des algorithmes pour analyser des images et données captées en trop grand nombre pour pouvoir faire l’objet d’un traitement humain » et dont l’expérimentation en France devait théoriquement se cantonner à l’organisation des Jeux Olympiques. Or, le déploiement progressif de ces outils implique « que le curseur de l’acceptabilité sociale se voit déplacé » faisant craindre, alors que des populistes sont élus un peu partout dans le monde, un « point de non-retour qui verrait tout futur pouvoir exécutif disposer de moyens disproportionnés d’encadrement et de privation des libertés publiques ».
D’autant plus que, pour les décideurs politiques dont les actions sont davantage dictées par une communication politique à court terme que par une véritable volonté de s’emparer de problèmes sociaux complexes, « le technosolutionnisme offre un répertoire d’action immédiate », même si la preuve de l’efficacité de tels dispositifs est loin d’être établie. Pour dépasser le technosolutionnisme, il faut d’abord proposer une alternative à la vision techniciste, explique Benjamin Pajot, en traitant les causes profondes des problèmes et en repensant nos priorités collectives au service du bien commun. Cela implique de redéfinir notre rapport à la technologie à partir des usages réels, et non des promesses. L’objectif n’est pas de rejeter la technologie, mais d’encourager les innovations utiles à la société, en évaluant leurs impacts et en répondant à des besoins clairement identifiés. Si le rapport analyse avec beaucoup de perspicacité les fondements et l’impact du solutionnisme technologique sur les sociétés, l’auteur ne cède pas non plus à un pessimisme indépassable et soutient que « le technosolutionnisme n’a rien d’inéluctable ». Il rappelle ainsi que nos choix politiques, éclairés, pourraient être « un moteur permettant de stimuler l’innovation technologique d’utilité publique, répondant à des besoins clairement identifiés par des propositions soutenables sur les plans écologique et social ».
> Lire l'article complet sur le site de La revue européenne des médias et du numérique (N° 73-74, 2025)
Titre
Aller plus loin
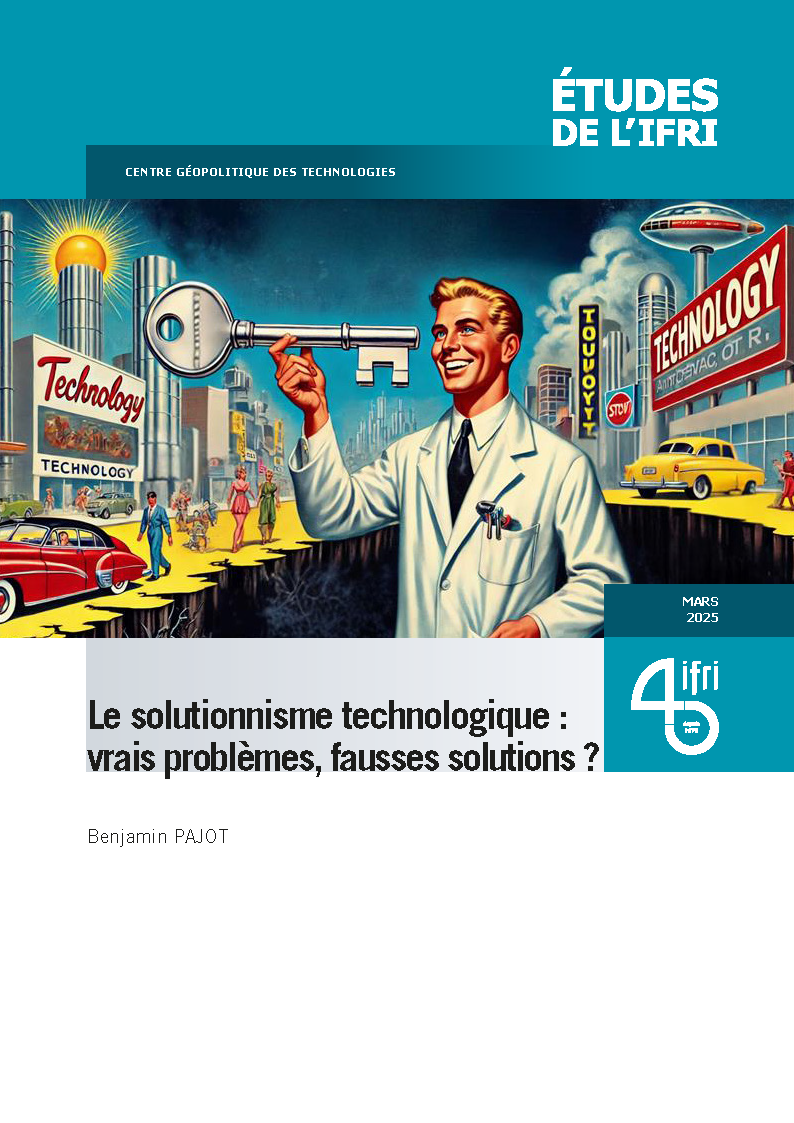

Média
Journaliste(s):
Format
Partager








