Afrique du Nord et Moyen-Orient : des migrations en quête d'une politique
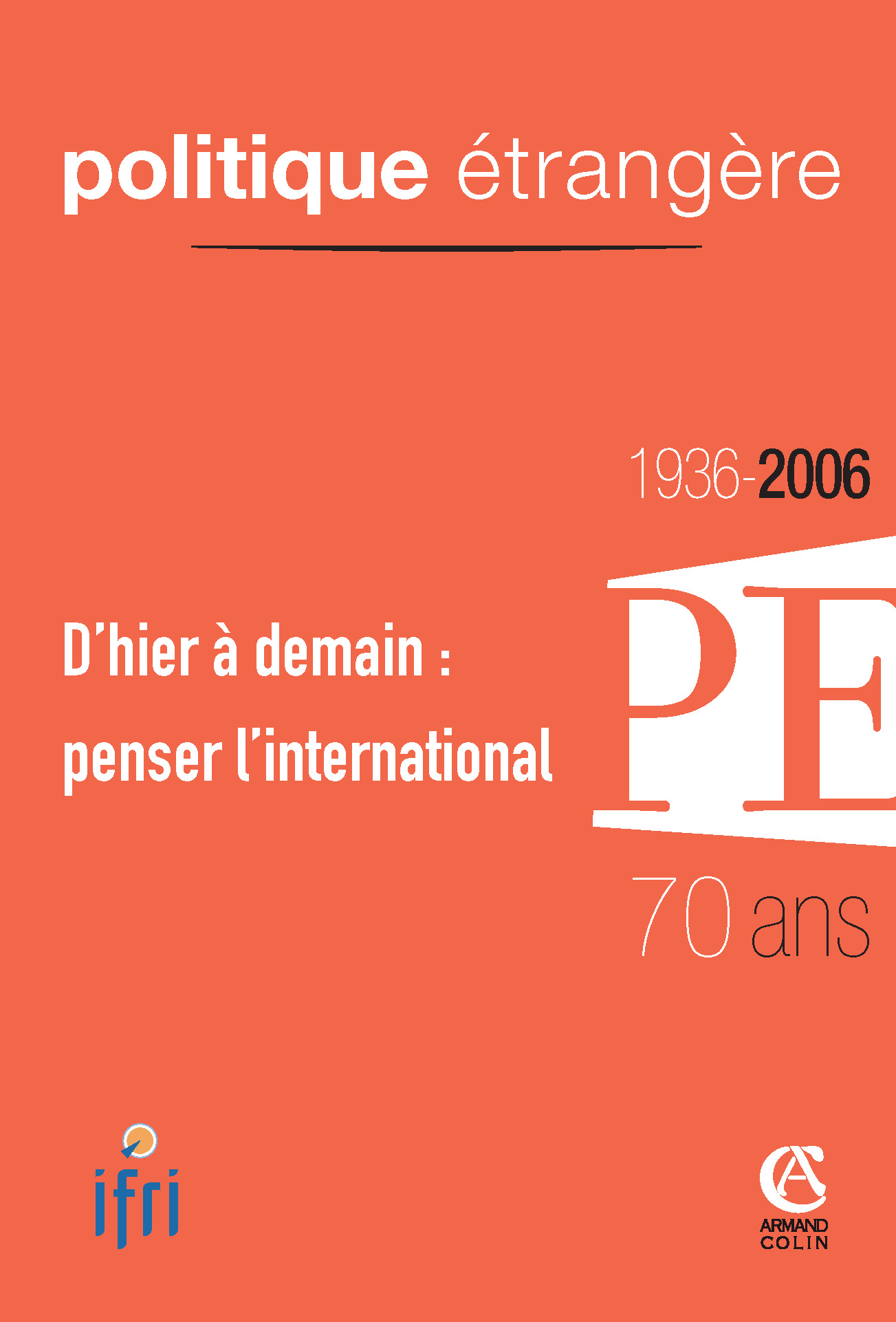
La distinction pays émetteurs/pays récepteurs tend à s’effacer au sud de la Méditerranée. Si les pays pétroliers deviennent plus restrictifs vis-à-vis de l’immigration, nombre d’autres pays doivent se transformer en pays d’accueil, ou de transit, d’une immigration mondialisée. Partout se pose donc le problème des politiques nécessaires: au niveau international pour réunir les questions de l’émigration et de l’immigration, au niveau national pour intégrer les populations nouvelles.

Nuit sans lune. Des embarcations légères abordent le navire qui attend au large sa cargaison de clandestins pour l’Europe. Ils iront grossir les rangs de cette « multitude d’hommes, de femmes et d’enfants en haillons qui errent dans les rues de Marseille, de Barcelone et d’autres villes françaises et espagnoles. Quand on leur demande pourquoi ils ont quitté leur pays, ils inventent des histoires invraisemblables de femmes et d’enfants massacrés, simplement pour attirer la compassion. » Nous sommes au Liban en 1889 ; le consul de la Sublime Porte à Barcelone commente les résultats de l’enquête qui révèle l’existence d’un réseau de trafiquants dont la tête est à Tripoli (Liban). Le gouverneur de Beyrouth ordonne que l’on saisisse les embarcations et que l’on fasse comparaître les trafiquants et leurs complices. Son successeur comprend bientôt que les mesures administratives à l’encontre de l’émigration, loin d’éliminer le phénomène, ne font que favoriser son caractère illégal. Les routes de la migration clandestine sont si bien établies que ce ne sont plus seulement les habitants du Liban qui les empruntent, mais ceux des pays proches. Il faudra vingt ans pour que le ministre de l’Intérieur de l’Empire ottoman admette que « le problème se résoudra de lui-même en temps utile, lorsque l’argent envoyé par les émigrés et leurs investissements apporteront un essor du commerce, de l’artisanat et des usines dans le Mont-Liban et au-delà. »
Près de cent vingt ans plus tard, l’histoire se répéterait-elle ? Oui : la pression migratoire, le trafic qu’elle alimente, la réticence des pays receveurs et les stratégies de contournement que celle-ci engendre n’ont guère changé. Non, si l’on considère son contexte : la démographie et la politique ont créé un terrain totalement nouveau sur lequel se jouent les migrations modernes. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- La fin de l’opposition entre pays d’émigration et pays d’immigration
- Qui sont les migrants ?
- Persistance de l’émigration
- Mobilisation des diasporas
- Généralisation de l’immigration
- Protectionnisme et absence de projet d’intégration des immigrés
Philippe Fargues, professeur à l’Institut universitaire européen de Florence, dirige le Consortium euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur les migrations internationales au Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Spécialiste des questions de population dans le monde musulman, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages et de plus d’une centaine d’articles scientifiques.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Afrique du Nord et Moyen-Orient : des migrations en quête d'une politique
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









