Le Moyen-Orient en 2029
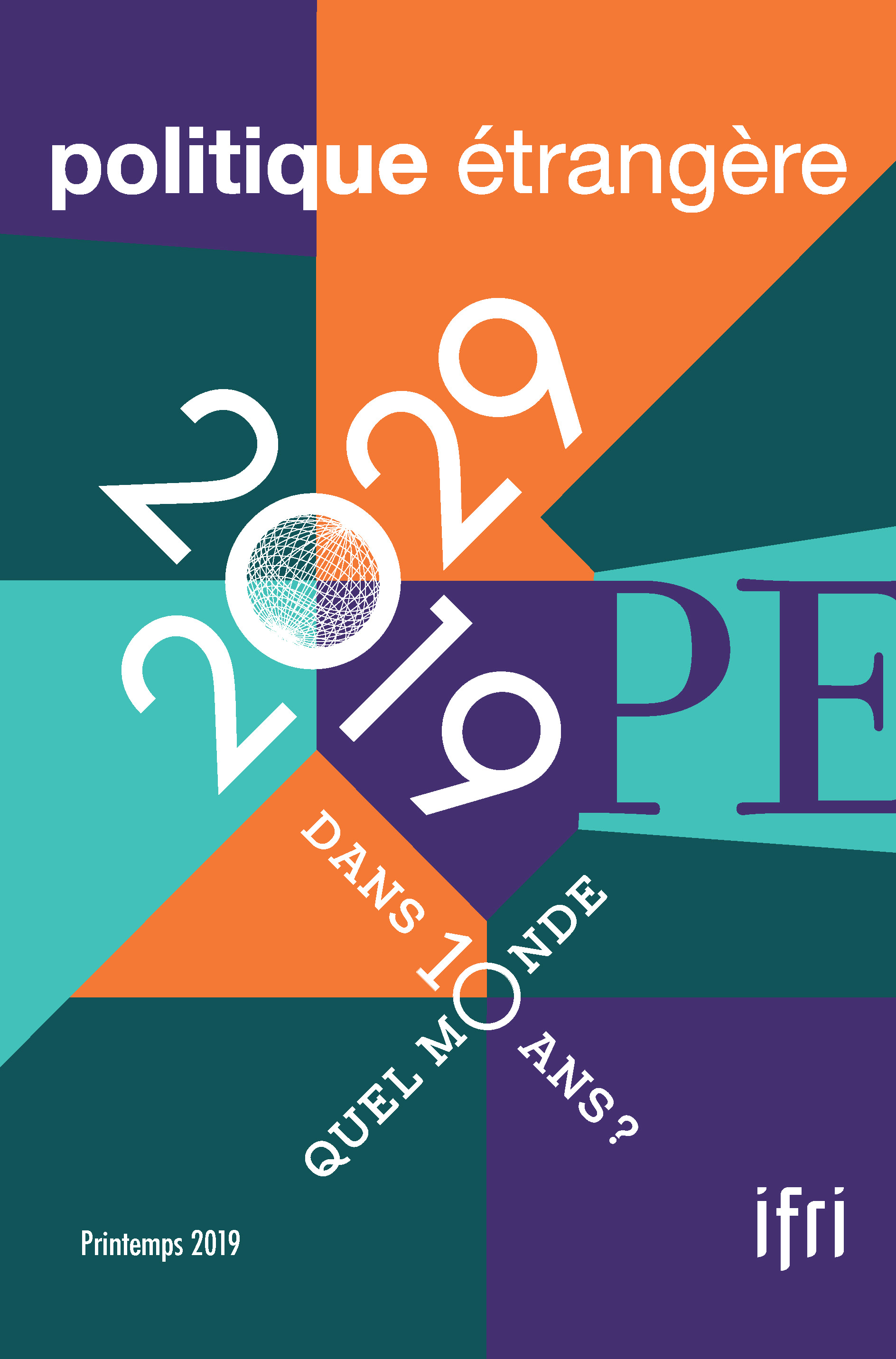
Les guerres qui ravagent aujourd’hui le Moyen-Orient n’ont pas vocation à se poursuivre éternellement et la région n’est pas vouée à être dirigée par des autocrates. Une transition vers un ordre plus juste pour les populations est possible mais elle prendra du temps. Il est peu probable qu’elle advienne d’ici 2029. Les progrès viendront graduellement, poussés par la société civile. De nouvelles révolutions sont possibles mais il n’est pas sûr qu’elles produisent davantage de démocratie.

Ces dix dernières années, le Moyen-Orient a subi une transformation historique qui a irrémédiablement bouleversé le statu quo. Un conflit aux multiples facettes se déploie dans le Grand Moyen-Orient, en particulier dans le monde arabe, sur l’avenir de l’État-nation, le rôle du religieux dans le politique et la relation entre dirigeants et citoyens. Ce conflit n’est pas seulement territorial, il est aussi idéologique et institutionnel. Il s’agit d’une lutte existentielle entre de multiples acteurs – conservateurs, progressistes, islamistes, nationalistes… Une guerre froide régionale opposant trois acteurs clés – Iran, Arabie Saoudite et Turquie – est au cœur de ce conflit, qui a des implications bien au-delà de la région. Son issue déterminera la nature et l’identité des États-nations, ainsi que leurs relations avec le reste du monde.
La division criante du monde arabe entre une identité nationale et des identités tribales, religieuses et sectaires se manifeste par de violents affrontements. Ces identités secondaires ont émergé dans le vide laissé par des institutions étatiques défaillantes et des élites dirigeantes en mal de légitimité ; elles menacent aujourd’hui de détruire le système étatique tout entier. Redessiner les cartes ne résoudra pas la crise. L’exemple récent du Sud-Soudan témoigne des effets négatifs qui peuvent résulter de telles tentatives.
Le système étatique du Moyen-Orient est en pleine transition. Dans toute la région, des visions divergentes de l’État-nation et du contrat liant pouvoirs et populations s’affrontent. Les tentatives de réformer les États-nations du Moyen-Orient reflètent les expériences longues et souvent sanglantes d’autres régions du monde en matière de nation building. Elles mettent aussi en lumière l’une des dynamiques évolutives de la lutte actuelle : l’héritage du colonialisme et son impact sur l’émergence de l’organisation locale.
La donne politique du Moyen-Orient – des États-nations bâtis par des puissances coloniales – sera certainement toujours d’actualité en 2029 et au-delà, en dépit d’efforts conséquents d’acteurs non étatiques souhaitant les remplacer par d’autres modèles. Si les puissances coloniales européennes ont construit ces États-nations selon des frontières arbitraires, le développement historique de la région montre que ces identités nationales sont profondément enracinées. Ces frontières sont aujourd’hui largement admises par les communautés locales. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- De la politique du passé à la politique de l’avenir
- Le Moyen-Orient dans le contexte mondial
- Un système étatique durable
- Le constitutionnalisme
- La réinvention du populisme autoritaire au Moyen-Orient
- Concevoir le changement par la base
Fawaz A. Gerges est professeur de relations internationales à la London School of Economics. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Making the Arab World, Princeton, Princeton University Press, 2018 et ISIS: A History, Princeton, Princeton University Press, 2016.
Le texte est traduit de l'anglais par Cécile Tarpinian.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le Moyen-Orient en 2029
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.








