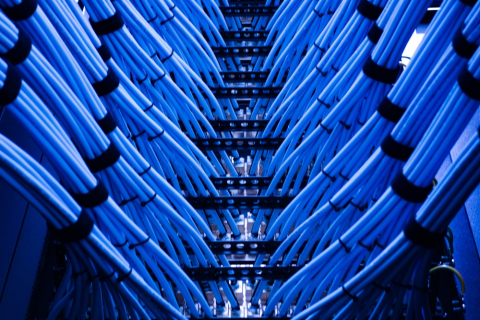« Erdogan veut replacer la Turquie au centre du jeu avec l’islam »
Dorothée Schmid est responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. Elle décrypte le projet de néo-ottomanisme d'Erdogan récemment illustré par son ministre de la Défense qui a posté une photo avec une carte de la Turquie comprenant Mossoul, Arbil, Kirkuk...

D'où vient le néo-ottomanisme voulu par Erdogan ? Qu'est-ce que cela signifie et quel est l'objectif ?
Dorothée Schmid : Le néo-ottomanisme vient de la politique étrangère d'Ahmed Davutoglu, ancien ministre des Affaires étrangères d'Erdogan puis Premier ministre de 2014 à 2016. Il a travaillé à une vision alternative des relations internationales visant à replacer la Turquie au centre du jeu en utilisant l'islam comme un instrument de soft power. Quand il a décidé que la Turquie allait avoir une politique d'influence dans son voisinage, le plus simple et les plus cohérent pour lui d'un point de vue intellectuel, était de se redéployer dans l'espace anciennement ottoman où les Turcs considéraient que la Turquie était attendue : une partie du monde arabe et les Balkans.
Cette étiquette de néo-ottomanisme a d'abord été utilisée par les critiques de la politique étrangère de l'AKP. Conscient qu'elle était négative car perçue comme du néo colonialisme turc, Davutoglu s'en est longtemps défendu.
Pourtant, les références culturelles montent en puissance ?
D.S. : Elles deviennent de plus en plus évidentes sur le plan intérieur avec la mise en scène de la conquête d'Istanbul, des noms de grands sultans à des ouvrages d'art, la création du musée de la conquête d'Istanbul... Ou encore des chercheurs qui se remettent à travailler sur les archives ottomanes, sans oublier les séries télés particulièrement suivies sur le Siècle d'or. Cet imaginaire développé en interne a peu à peu été assumé dans le discours officiel, avec des références aux sultans ottomans de Davutoglu comme d'Erdogan. Tout ceci a d'autant mieux fonctionné qu'on était sur un terrain quasiment vierge du point de vue de la mémoire collective, Atatürk ayant tenté d'éradiquer cette page de la mémoire turque.
Cette « ottomania » va aussi avoir des implications politiques ?
D.S. : Oui car les discours deviennent révisionnistes, affirmant que le traité de Lausanne est caduc, qu'il faut revoir la distribution des territoires en mer Egée, se réapproprier Mossoul ou certaines villes syriennes comme Alep. Il y a une légitimation d'un discours de revanche historique sur le XXe siècle, disant qu'on ne peut pas se satisfaire des frontières telles qu'elles ont été fixées à Lausanne grâce à une guerre qui a été baptisée guerre d'indépendance par les Kémalistes.
Étrangement, cette perspective ottomane a aussi séduit une partie du public arabe. Notamment à travers les séries via une sorte de folklore historique qui a fonctionné mais aussi parce que les Turcs ont eu une diplomatie de rupture sur certains dossiers régionaux. Par exemple, la question palestinienne a été prise en charge par Erdogan et la popularité de ce dernier est réelle parmi les Palestiniens : certains Arabes affirment aujourd'hui que les Ottomans étaient légitimes dans la région et que la perspective néo-ottomane est plutôt une bonne nouvelle. Cela passe aussi par la restauration du patrimoine architectural ottoman et notamment les mosquées, financées par l'agence d'aide extérieure turque et par la Diyanet, la direction des affaires religieuses. Il y a eu des travaux financés un peu partout, depuis La Mecque jusqu'aux Balkans musulmans - Bosnie, Albanie, Kosovo - en passant par le Liban.
Atatürk avait nié cette page car l'empire ottoman n'était, selon lui, pas assez nationaliste ?
D.S. : Il y a eu des réflexions sur le nationalisme dans l'empire ottoman mais comme c'était un empire multinational, il était difficile d'avoir un nationalisme monolithique mais c'était une question présente dès la fin du XIXe siècle car tout l'enjeu pour les Ottomans était d'empêcher que les nationalismes présents dans l'empire n'amènent à sa dislocation. Ils ont tenté de proposer une sorte de citoyenneté ottomane, dont les contours étaient difficiles à définir, et finalement la perspective islamique l'a emporté : l'islam était le plus grand dénominateur commun des peuples de l'Empire. En se débarrassant des minorités religieuses et en niant les différences nationales entre Turcs et Kurdes via une « turcisation » des Kurdes, Atatürk a réussi à faire avancer un nationalisme de « purification » dont les stigmates sont encore très présents dans la culture politique turque.
Ce nationalisme turc a différents visages dont celui de l'extrême droite dont Erdogan a eu besoin pour gagner les élections de 2018 ?
D.S. : Islamisme et nationalisme sont les deux grandes ressources qui permettent la mobilisation politique en Turquie et il y a eu, à différents moments de l'histoire, des synthèses islamo-nationalistes, une vision nationale turque d'un islamisme. On peut considérer que l'AKP renoue avec cela. On pourrait dire qu'Erdogan a été phagocyté car on a le sentiment, qu'aujourd'hui, l'outrance nationaliste tient le haut du pavé en Turquie, plus que la surenchère religieuse qui a été présente à d'autres moments. L'alliance avec le MHP a permis à ce parti, en voie d'extinction notamment pour cause d'impossible réforme interne, de survivre. Mais, avec la guerre en Syrie on s'aperçoit que même la branche dissidente du parti, qui s'était alliée avec les opposants du CHP lors des élections municipales de juin, joue à nouveau la même partition que l'AKP. C'est ce que souhaitait Erdogan : refaire une unité nationaliste autour de sa personne. Aujourd'hui, c'est lui le chef. Peu s'opposent à lui à part le parti pro-kurde du HDP. Il n'y a donc pas eu phagocytage mais c'est l'AKP qui porte aujourd'hui l'agenda nationaliste au détriment des autres éléments de son programme, comme le libéralisme économique ou la réislamisation de la société.
Comment s'inscrit l'intervention en Syrie dans cette stratégie ?
D.S. : Cette intervention entre dans le projet de réappropriation du champ politique turc et d'unité autour de sa personne, de par l'enthousiasme que cela provoque. Dans ce projet nationaliste, les Kurdes sont désignés comme des ennemis : Kurdes du PKK et par extension du YPG. Cet ennemi est défini idéologiquement mais, implicitement, il y a une définition ethnique de cet ennemi qui est non turc, et non prêt à être « turcisé ».
Elle se place dans la suite d'Afrine et de toutes les interventions en Syrie : pour mémoire l'opération bouclier de l'Euphrate en 2016-2017. On a un projet d'occupation du terrain en Syrie en ligne avec le projet de révisionnisme des frontières dont j'ai parlé précédemment. Si être présent en Syrie est un objectif en soi pour abolir la frontière, il y a aussi la volonté de briser l'espace kurde que les Kurdes avaient tenté d'unifier en Syrie. C'est présenté comme un projet pour la sécurité en Turquie mais c'est très ambivalent puisque, malgré tout, on est dans une occupation du territoire syrien.
Retrouver cet entretien sur le site de La Marseillaise.

Média
Partager