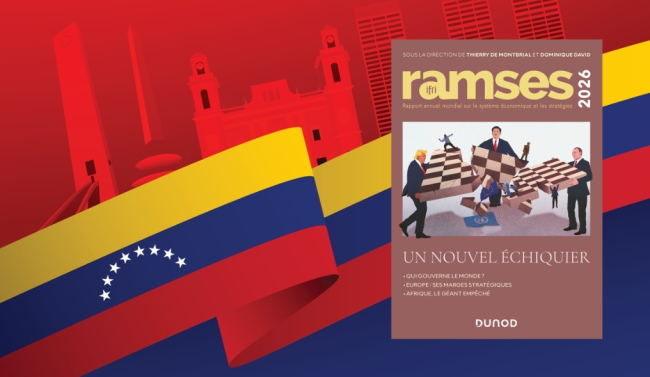Les négociations États-Unis/Iran sur le nucléaire : les limites de la méthode Trump
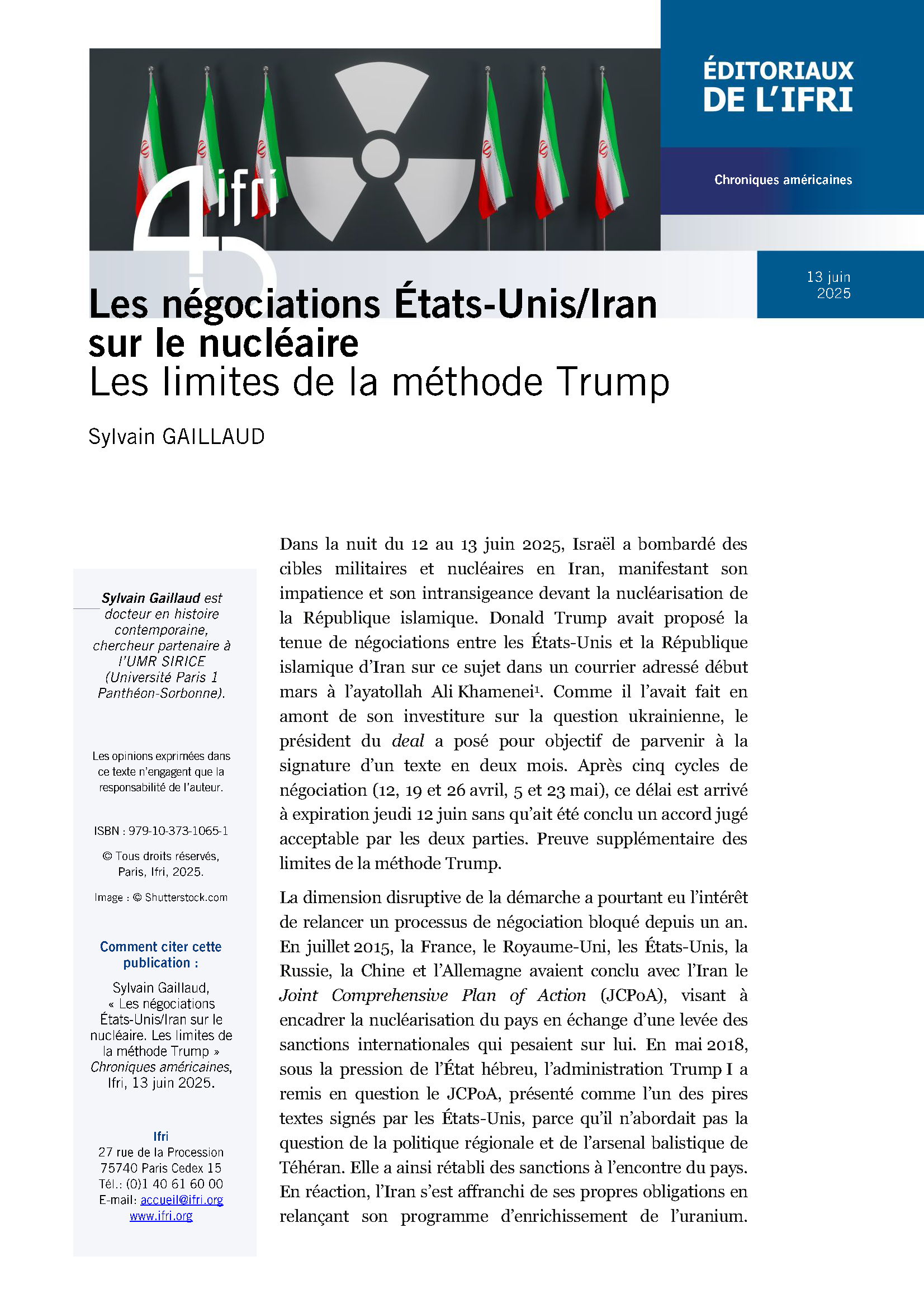
Dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, Israël a bombardé des cibles militaires et nucléaires en Iran, manifestant son impatience et son intransigeance devant la nucléarisation de la République islamique.

États-Unis – Iran : la tentative avortée de Donald Trump
Donald Trump avait proposé la tenue de négociations entre les États-Unis et la République islamique d’Iran sur ce sujet dans un courrier adressé début mars à l’ayatollah Ali Khamenei. Comme il l’avait fait en amont de son investiture sur la question ukrainienne, le président du deal a posé pour objectif de parvenir à la signature d’un texte en deux mois. Après cinq cycles de négociation (12, 19 et 26 avril, 5 et 23 mai), ce délai est arrivé à expiration le jeudi 12 juin sans qu’ait été conclu un accord jugé acceptable par les deux parties. Preuve supplémentaire des limites de la méthode Trump.
Un nouveau pari diplomatique à haut risque
La dimension disruptive de la démarche a pourtant eu l’intérêt de relancer un processus de négociation bloqué depuis un an. En juillet 2015, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Allemagne avaient conclu avec l’Iran le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), visant à encadrer la nucléarisation du pays en échange d’une levée des sanctions internationales qui pesaient sur lui. En mai 2018, sous la pression de l'Etat hébreu, l’administration Trump I a remis en question le JCPoA, présenté comme l’un des pires textes signés par les États-Unis, parce qu’il n’abordait pas la question de la politique régionale et de l’arsenal balistique de Téhéran. Elle a ainsi rétabli des sanctions à l’encontre du pays. En réaction, l’Iran s’est affranchi de ses propres obligations en relançant son programme d’enrichissement de l’uranium.
Malgré la mise en place de cadres de négociation apaisés à partir d’avril 2021, l’administration Biden n’est pas parvenue à conclure un nouvel accord, face à un interlocuteur iranien peu acquis à l’initiative.
Une relance de dialogue inspirée d’Obama
La lettre du président au Guide suprême renoue avec la démarche mise en œuvre en amont de la négociation du JCPoA à l’automne 2014 : dans un courrier secret à Ali Khamenei, Barack Obama avait alors mis en avant l’intérêt d’une lutte conjointe contre l’État islamique, conditionnée à la conclusion d’un accord au sujet du programme nucléaire iranien . La prise de contact de 2025 a répondu à un contexte favorable. Le président Massoud Pezeshkian a été élu en juillet 2024 sur la promesse de réparer une économie iranienne exsangue en négociant directement avec Washington. La personnalisation du processus a cependant porté dès l’origine les germes de son inefficacité entre deux partenaires hantés par les « fantômes de l’histoire » depuis la révolution de 1979 . Le chantage d’une alternative militaire en cas d’échec a essuyé une réponse acerbe du Guide suprême, qui a la haute main sur le dossier nucléaire et le dernier mot dans la prise de décision : « L’insistance de certains gouvernements tyranniques à négocier n’a pas pour but de résoudre les problèmes, mais d’imposer leurs propres attentes. »
En amont du dialogue, Washington s’est employé à construire un rapport de force favorable. Des sanctions ont été imposées sur les réseaux de blanchiment d’argent et de financement de l’armée iranienne, sur les acteurs impliqués dans la fabrication de missiles balistiques et d’avions de combat, et dans l’industrie pétrolière et pétrochimique du pays . Ces mesures prolongent une politique de pression maximale en vigueur depuis la dénonciation du JCPoA en 2018. L’administration Trump I avait porté le nombre de sanctions de 417 à 1 635, un chiffre atteignant 2 562 en décembre 2024, l’administration Biden n’étant pas revenue sur cette stratégie. Or, elle a déjà montré ses limites. L’administration Trump I entendait entraver le financement de l’« axe de la résistance » et nourrir par l’inflation induite un soulèvement de la société iranienne contre le régime islamique. La déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient – qui culmine avec l’attaque du 7 octobre 2023 –, ainsi que la féroce répression de la révolte « Femme, Vie, Liberté », ont montré la résilience du régime . Plus encore, la République islamique a développé une « économie de la résistance » échappant aux sanctions et renforçant les partisans de la ligne dure, proches du Guide suprême, lesquels pourraient à nouveau user de leur influence pour faire avorter des négociations auxquelles ils n’ont pas intérêt.
Un rapport de force en trompe-l'œil
L’application de la méthode du deal à l’art de la négociation est enfin à double tranchant face à un interlocuteur iranien rompu aux jeux du marchandage. Les positions étatsuniennes ont témoigné dès l’origine d’une incohérence liée aux dissensions entre les partisans d’une ligne dure et les acteurs prêts à transiger. Le magnat de l’immobilier Steve Witkoff, chargé des négociations, a laissé entendre qu’un accord permettrait à l’Iran de continuer à enrichir de l’uranium à 3,67 %, avant d’affirmer que Téhéran devait « arrêter et éliminer » son programme nucléaire . Le premier scénario aurait en effet conduit à ressusciter le texte de 2015, que Trump avait rejeté comme irrecevable. Le changement de position a en revanche très tôt suggéré une fenêtre de négociation dans laquelle s’est engouffré l’interlocuteur iranien, qui a, lui, maintenu ses « lignes rouges » : le maintien d’un programme d’enrichissement sur le sol iranien et l’exclusion du cadre des négociations des questions balistiques et régionales.
Dans ce contexte, le rejet par Téhéran d’un plan d’enrichissement par un consortium international hors du territoire iranien a conduit Trump à brandir à nouveau la menace militaire. Or, aussi risquée que soit l’alternative, l’Iran ne semble pas être dupe.
Le « Signalgate » et la crise interne à Washington
Le renvoi du conseiller à la sécurité nationale Michael Waltz à la suite du « Signalgate » a autant sanctionné son implication dans la fuite de documents confidentiels que sa préférence pour l’option militaire contre Téhéran quand l’agenda de Trump demeurait la négociation. La réticence du président du deal à envisager l’implication des États-Unis dans la défense de l’Europe face à la Russie et de Taïwan face à la Chine n’est enfin pas passée inaperçue en Iran, qui continue à gagner du temps. Le pays disposerait d’une quantité de combustible à un niveau d’enrichissement proche de la bombe suffisant pour fabriquer dix armes nucléaires.
Un contexte régional en recomposition
Pas plus que 24 heures n’auront suffi à résoudre le conflit russo-ukrainien, deux mois n’auront donc pas permis d’aboutir à un nouveau compromis nucléaire entre les États-Unis et l’Iran. Le contexte y semble pourtant plus favorable qu’il ne l’était en 2015. En témoigne la recomposition des rapports de force régionaux autour d’un axe de pays arabes qui considèrent que la menace a changé de camp depuis l’automne 2023 : parce qu’ils seraient les premières victimes d’un affrontement régional, Tel-Aviv a remplacé à leurs yeux Téhéran comme agent de déstabilisation . Washington n’a eu de cesse de réfréner les velléités militaires de Benyamin Netanyahou, opposant de la première heure au JCPoA. Le Premier ministre israélien voit dans la réactivation des tensions entre Tel Aviv et Téhéran l'opportunité de détourner l'attention internationale de la bande de Gaza et les oppositions à son régime de la scène intérieure. Les dernières frappes israéliennes sur l'Iran, dont les Etats-Unis se sont désolidarisés, montrent la faible portée de la voix de Washington dans la région. Elles pourraient convaincre les négociateurs iraniens de transiger lors du nouveau cycle de négociation prévu le 15 juin à Mascate (sultanat d'Oman). Elles pourraient également, selon la portée des représailles iraniennes, faire basculer la région dans un conflit aux conséquences en cascade.
Un compromis toujours hors de portée ?
La mise en œuvre d’un édifice de sécurité sous-tendant un compromis nucléaire avec le soutien des partenaires régionaux aurait demandé du temps et de la souplesse dont le président du deal, dans sa nervosité présomptueuse, semble dépourvu. Après avoir relancé le processus de négociation, la méthode Trump pourrait ainsi contribuer à le faire avorter.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les négociations États-Unis/Iran sur le nucléaire : les limites de la méthode Trump
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesVenezuela : un pouvoir affermi
Nicolás Maduro semble plus impopulaire que jamais dans la population vénézuélienne, mais il verrouille aussi de manière toujours plus affirmée le système politique et institutionnel du pays. À l’extérieur, Donald Trump semble engager un nouveau bras de fer avec le gouvernement vénézuélien, dans une logique qui paraît très imprévisible.
De l'IRA à l'OBBA : les entreprises françaises de l'énergie aux États-Unis
Adopté en 2022 sous l’administration Biden, l’Inflation Reduction Act (IRA) a marqué un tournant historique dans la politique énergétique américaine, offrant une visibilité supposée de long terme et attirant les investissements. De 2022 à 2024, les investissements américains dans les énergies propres ont atteint près de 500 milliards de dollars (+ 71 % en deux ans).
Le Brésil à un an des élections générales d’octobre 2026
Les élections générales brésiliennes auront lieu le 4 octobre 2026 afin d’élire le président, le vice-président, les membres du Congrès national, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les assemblées législatives des états de la fédération. Pour les élections du président et des gouverneurs, un second tour sera organisé le 25 octobre si aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages au premier tour.
États-Unis : la liberté d’expression face aux attaques du mouvement MAGA
La séquence ouverte par l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk le 10 septembre 2025 illustre l’importance et la relative fragilité du principe de liberté d’expression dans la société américaine.