Le HDP, un nouveau venu en quête d’ancrage
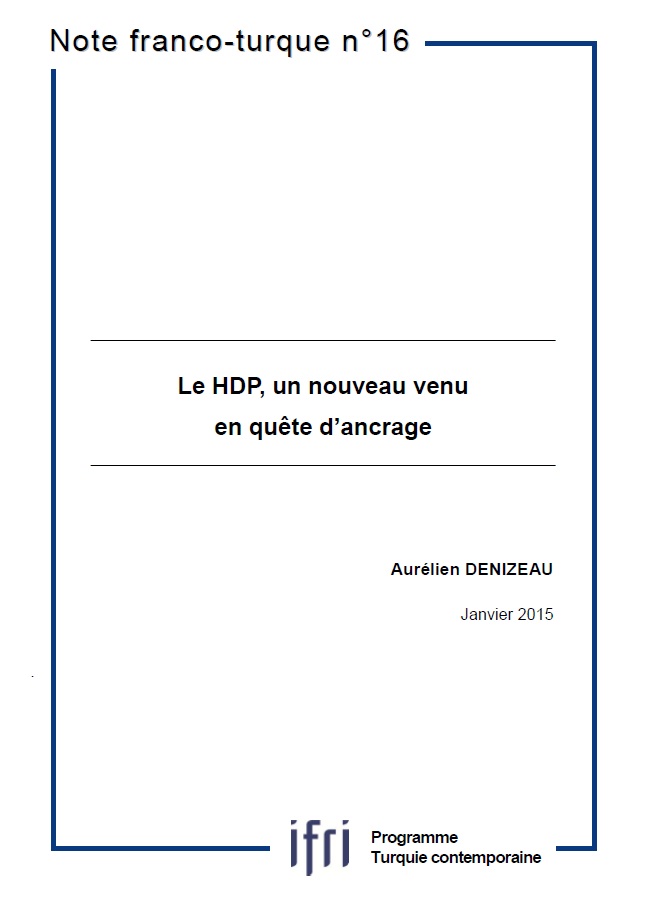
L’élection présidentielle du mois d’août 2014, puis les élections législatives de 2015 en Turquie ont attiré l’attention sur l’émergence d’un nouveau venu sur la scène politique : le Parti Démocratique des Peuples (HDP, Halkların Demokratik Partisi). Sous l’impulsion de ses deux co-présidents, Figen Yüksekdağ et surtout Selahattin Demirtaş, candidat à l’élection présidentielle de 2014 et figure charismatique désormais indissociable du parti, le HDP s’est imposé sur cet intervalle de temps comme une nouvelle force d’opposition au gouvernement islamo-conservateur du président turc, Recep Tayyip Erdoğan, et de son parti l’AKP.

Performance notable, le HDP a obtenu un score suffisant aux législatives pour envoyer des députés à l’Assemblée nationale turque. L’élection s’est jouée dans des circonstances particulières, un premier scrutin n’ayant pas permis en juin de dégager une majorité de gouvernement. Le vote « rejoué » le 1er novembre atteste en fait d’un recul du HDP, qui passe de 13% à 10,8% des votes. Ce résultat sanctionne la fragilité intrinsèque du parti ; pourtant, il a réussi l’exploit de passer le seuil éliminatoire des 10% et s’installe ainsi officiellement dans le paysage institutionnel turc.
Alors que ce résultat spectaculaire a attiré l’attention de toute la presse turque et, plus largement, de l’ensemble des commentateurs internationaux, le HDP demeure une énigme politique. Il incarne une expérience nouvelle sur la scène turque aussi bien qu’européenne, d’où la difficulté à le catégoriser et même, plus simplement, le définir. Une incertitude qui semble du reste traverser le parti lui-même, encore en recherche d’une identité précise. La comparaison avec d’autres mouvements européens peut-elle aider à le classer sur l’échiquier politique, à comprendre son (ou ses) moteur(s) idéologique(s) et à anticiper des scénarios d’avenir ?

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le HDP, un nouveau venu en quête d’ancrage
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Canada et la reconnaissance de l'État palestinien
Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
La République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Turquie 2050 - Corridors ; Communauté LGBTI ; Turquie - Chypre Nord
Repères sur la Turquie n° 33 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.











