L'enjeu culturel au coeur des relations internationales
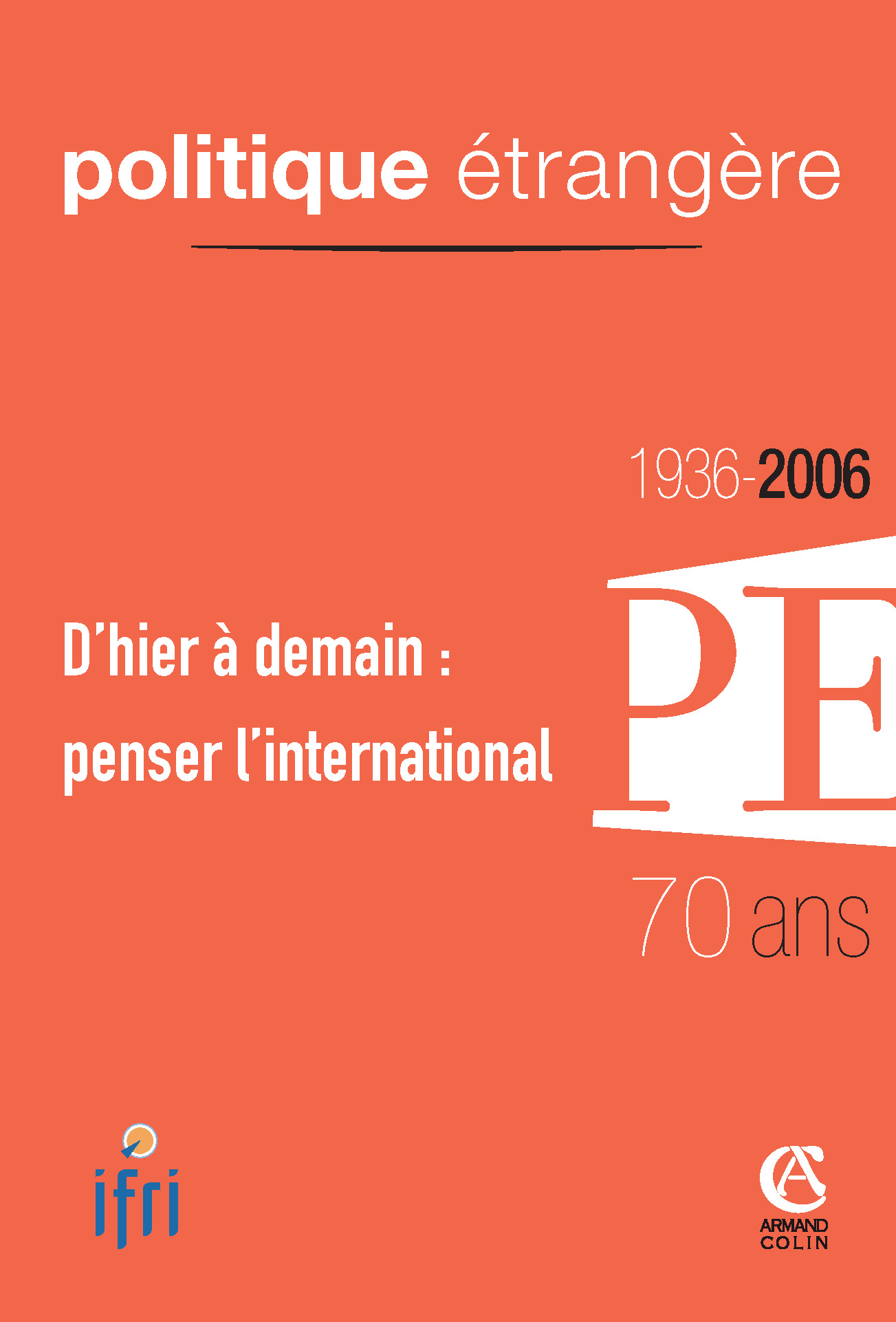
Plus la sphère du mondialisé s’accroît, plus l’ampleur des différences à appréhender augmente. La compréhension et le maintien de la diversité culturelle sont donc aujourd’hui impératifs, d’où la nécessité de développer de véritables politiques culturelles, intégrant tous les acteurs: organisations internationales, États, sociétés civiles, secteur privé. L’éducation et la préservation du patrimoine (au sens extensif) constituent sans doute les enjeux les plus immédiats.

Il est devenu habituel d’associer, dans le champ des relations internationales, culture et politique, comme en témoignent les propos tenus, en mai 2005, par le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Alpha Oumar Konaré, au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) : « le combat culturel est aussi un projet politique visant à donner un contenu social à l’Union et à constituer autour de l’Afrique un ensemble d’influence ».
Ces paroles fortes illustrent une prise de conscience largement partagée, et nous engagent à réfléchir sur la façon la plus opportune de repenser la place de la culture, délestée de son statut de soft issue pour reprendre le vocabulaire des juristes, sur l’agenda politique national et international.
Les inquiétudes nouvelles auxquelles nous faisons face – développement du terrorisme et des violences interethniques, inégalités homme/femme, pauvreté, pandémies, crise du dialogue interculturel, menaces sur la sécurité humaine, etc. – rendent nos sociétés plus opaques à elles-mêmes, incertaines de leur avenir et même de leur passé. Il est urgent de centrer notre action sur des problématiques globales, pour répondre à la quête de sens et d’intelligibilité de nos contemporains. Il est clair, surtout depuis le 11 septembre 2001, que l’enjeu culturel au sens large – politiques culturelles, promotion de la diversité culturelle, dialogue des cultures – s’est imposé au premier plan des préoccupations politiques. Chacun cherche aujourd’hui un cadre éthique universel dont les principes pourraient inspirer et irriguer l’ensemble des politiques nationales et internationales, dans une conjoncture où il devient impératif de réaffirmer l’égale dignité des cultures. Cette orientation s’est reflétée tout particulièrement lors du Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg, en 2002, au cours duquel il a été reconnu que la culture était le quatrième pilier du développement, aux côtés de l’économie, de l’écologie et du social.
Tout en gardant à l’esprit les dérives, divisions, parfois les crimes engendrés au nom de la culture, il est désormais impératif de répondre à cette demande sociale en faveur d’une reconnaissance plus large de ce qui fonde la diversité et le pluralisme. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Mondialisation et diversité culturelle
- De la culture aux politiques culturelles
- De la diversité culturelle au dialogue interculturel ?
- Quels partenaires ?
- Perspectives
Koïchiro Matsuura, ancien Premier secrétaire de la délégation japonaise à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), mène une longue carrière au ministère des Affaires étrangères du Japon: en 1994 notamment, il représente le Japon au sommet du G-7. En 1999, il est élu Directeur général de l’UNESCO et exerce aujourd’hui son second mandat.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'enjeu culturel au coeur des relations internationales
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









