La politique africaine de la France sous François Hollande : renouvellement et impensé stratégique
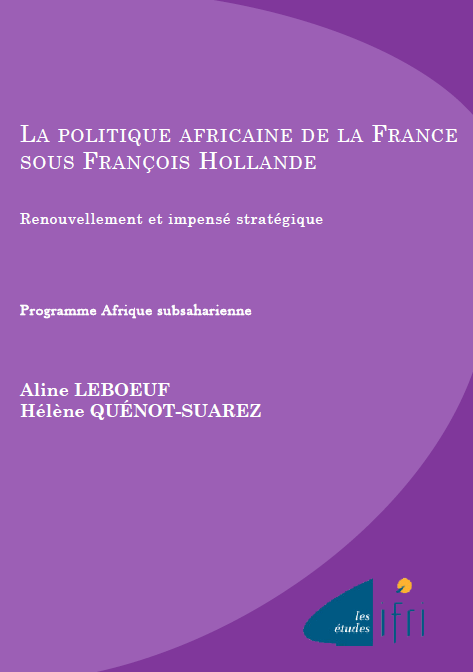
La relation française à l’Afrique résulte d’évolutions délicates et débattues depuis 30 ans, entre normalisation, retrait, et (ré)engagement.
Les partisans d’une normalisation de la relation au continent africain semblent s’imposer mais leur stratégie apparaît encore peu lisible.
Si François Hollande a annoncé vouloir mettre « fin à la Françafrique », les événements extérieurs l’ont contraint à s’engager sur le continent. Par ailleurs, annoncer la mort de la Françafrique ne structure pas une politique. La normalisation qu’il souhaite est donc difficile à mettre en oeuvre.
L’étude se structure sur deux axes principaux : démontrer le besoin pour la France d’une nouvelle stratégie vis-à-vis de ses partenaires africains ; et souligner qu’une telle stratégie se heurte à un décalage entre ambitions et moyens.
Sommaire
INTRODUCTION
ACTEURS ET INSTITUTIONS D’UNE POLITIQUE AFRICAINE « NORMALE »
- En (re)finir avec la Françafrique
- Un processus décisionnel normalisé ?
- L’aide au développement est-elle utile (à la France) ?
- Changements à la tête du MAE
- L’Afrique a déménagé : luttes pour le leadership
L’AFRIQUE AUX AFRICAINS, LA FRANCE EN SOUTIEN
- Hollande 1 : une nouvelle relation aux décideurs africains ?
- Hollande 2 : appropriations, complications
- Je te tiens, tu me tiens ? La dépendance française face à l’Afrique
L’AFRIQUE, C’EST AVANT TOUT LES CRISES ?
- Intervenir seule malgré elle
- L’opération Barkhane
- Une gestion militaire des crises ?
- Gérer ou prévenir les crises ?
LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE, UNE DIPLOMATIE EN RUPTURE ?
- Croissance et concurrence
- La fin des diplomates à l’ancienne ? Inventer une « diplonomie » à la française
- La lutte économique déjà dépassée ? Des atouts culturels forts
PETITS MOYENS, GRANDS OBJECTIFS
- Une grenouille française ?
- Des instruments traditionnels insuffisants
- « Aimer l’Afrique » : un outil insuffisant pour la comprendre
- Désafricaniser et trilatéraliser
- Réorganiser les moyens économiques ?
CONCLUSION

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La politique africaine de la France sous François Hollande : renouvellement et impensé stratégique
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa politique russe de recrutement de combattants et d’ouvrières en Afrique subsaharienne
La guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022, s’est rapidement internationalisée. La Russie et l’Ukraine se sont très vite efforcées de mobiliser leurs alliés afin d’obtenir un soutien politique et diplomatique, ainsi que des ressources militaires et économiques. Mais les deux belligérants ont aussi cherché à recruter des étrangers à titre privé pour soutenir leurs efforts de guerre respectifs. Cette politique est globale et s’étend de l’Amérique latine à l’Extrême-Orient. L’Afrique subsaharienne, dans ce panorama, présente un intérêt particulier car elle constitue un vivier de recrutement vaste et facilement accessible, en raison de taux de pauvreté élevés dans la plupart des pays de la zone conjugués à un important désir d’émigration.
Jeunesses et mobilisations en ligne au Mozambique : vers une redéfinition de l’espace public ?
Cette recherche explore la manière dont les jeunesses mozambicaines investissent les espaces numériques pour contourner les canaux traditionnels de participation politique et sociale. À travers une analyse des mobilisations en ligne, notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et WhatsApp, il met en lumière les nouvelles formes d’engagement qui remettent en question le monopole de l’État sur la parole publique et l’agenda politique.
Revendiquer “le peuple” : explosions démographiques de la jeunesse, dirigeants autoritaires affaiblis et politiques “populistes” au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie
Cette étude analyse l’émergence de tendances politiques qualifiées de « populistes » dans trois pays d’Afrique de l’Est : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Elle s’ancre dans une discussion plus large autour de la notion de « populisme », en interrogeant son usage et sa pertinence dans les contextes africains (et plus spécifiquement est-africains), avant d’examiner les dynamiques propres à trois cas emblématiques : la victoire électorale de William Ruto en 2022 au Kenya et sa rhétorique de la « Hustler Nation » ; l’opposition portée par Bobi Wine face à Yoweri Museveni en Ouganda ; et le style de gouvernement fortement personnalisé de John Magufuli en Tanzanie.
Gabon : un modèle politique issu d’une transition (presque) exemplaire ?
Les 27 septembre et 11 octobre 2025, les citoyens gabonais élisent dans un scrutin à deux tours à la fois les pouvoirs municipaux et les députés de la nouvelle Assemblée nationale. Il s’agit de l’étape presque ultime d’une transition politique qui s’approche de sa fin, un peu plus de deux ans après le coup d’État ayant renversé le régime dynastique plus que trentenaire des Bongo, celui du père, Omar, mort au pouvoir en 2009, puis celui de son fils, Ali, maintenant en exil.














