Les pouvoirs coutumiers en RDC : institutionnalisation, politisation et résilience
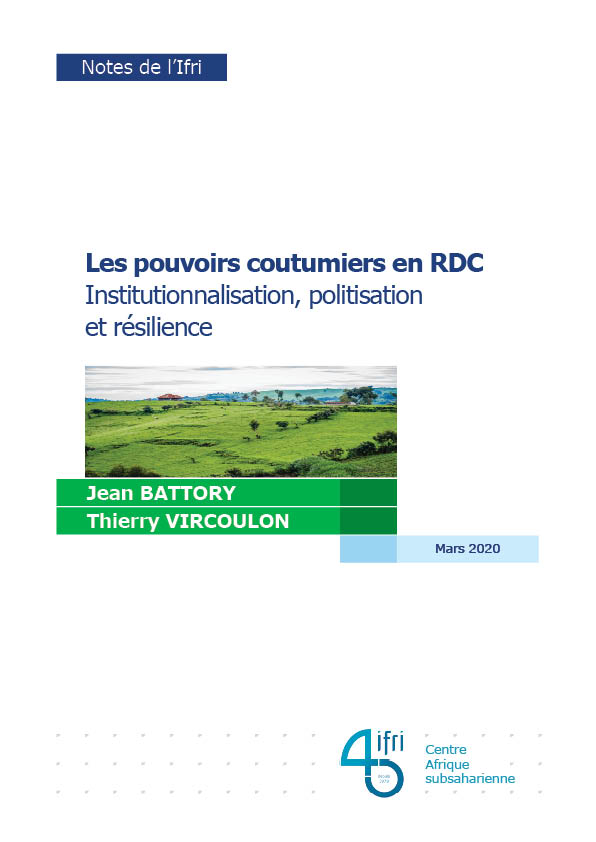
Loin d’être un archaïsme précolonial, les chefs coutumiers sont une des premières manifestations de la modernité politique.

La généralisation de la chefferie dans le cadre territorial du Congo est en grande partie l’œuvre du colonisateur belge. Depuis l’époque coloniale, les chefs coutumiers sont parvenus à préserver leurs prérogatives et à rester les gestionnaires du foncier et les pourvoyeurs de justice locale. Leur résilience a démenti tous ceux qui prédisaient et espéraient leur inéluctable obsolescence sous l’effet de la dictature du parti unique de Mobutu et du pluralisme électoral au début de ce siècle. Cette résilience s’explique autant par leurs capacités d’adaptation que par la reconnaissance par les différents pouvoirs en place, de leur utilité institutionnelle et politique. Bien que, selon la loi, les chefs sont apolitiques, leur politisation insidieuse est aujourd’hui une réalité acceptée. La conséquence la plus évidente de la survie historique de la chefferie est son implication dans les conflits qui agitent la République démocratique du Congo. À la fois victimes et acteurs de ces conflits, les chefs coutumiers occupent une place dans les dynamiques de conflit qui fluctuent en fonction des circonstances. Cette implication représente l’inévitable contrepartie de leur rôle institutionnel et politique.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les pouvoirs coutumiers en RDC : institutionnalisation, politisation et résilience
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesUn « faux départ » : l’avenir des chefferies coutumières en Afrique
Au-delà du seul cas du Burkina Faso, la cérémonie hebdomadaire du « faux départ » du Moro Naba, « l’empereur des Mossi » symbolise dans l'Afrique d’aujourd'hui la position paradoxale de dirigeants traditionnels jouissant d'une influence qui se situe en marge de la sphère politique moderne tout en conservant à la différence de celle-ci, une forte dimension religieuse.
La politique russe de recrutement de combattants et d’ouvrières en Afrique subsaharienne
La guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022, s’est rapidement internationalisée. La Russie et l’Ukraine se sont très vite efforcées de mobiliser leurs alliés afin d’obtenir un soutien politique et diplomatique, ainsi que des ressources militaires et économiques. Mais les deux belligérants ont aussi cherché à recruter des étrangers à titre privé pour soutenir leurs efforts de guerre respectifs. Cette politique est globale et s’étend de l’Amérique latine à l’Extrême-Orient. L’Afrique subsaharienne, dans ce panorama, présente un intérêt particulier car elle constitue un vivier de recrutement vaste et facilement accessible, en raison de taux de pauvreté élevés dans la plupart des pays de la zone conjugués à un important désir d’émigration.
Jeunesses et mobilisations en ligne au Mozambique : vers une redéfinition de l’espace public ?
Cette recherche explore la manière dont les jeunesses mozambicaines investissent les espaces numériques pour contourner les canaux traditionnels de participation politique et sociale. À travers une analyse des mobilisations en ligne, notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et WhatsApp, il met en lumière les nouvelles formes d’engagement qui remettent en question le monopole de l’État sur la parole publique et l’agenda politique.
Revendiquer “le peuple” : explosions démographiques de la jeunesse, dirigeants autoritaires affaiblis et politiques “populistes” au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie
Cette étude analyse l’émergence de tendances politiques qualifiées de « populistes » dans trois pays d’Afrique de l’Est : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Elle s’ancre dans une discussion plus large autour de la notion de « populisme », en interrogeant son usage et sa pertinence dans les contextes africains (et plus spécifiquement est-africains), avant d’examiner les dynamiques propres à trois cas emblématiques : la victoire électorale de William Ruto en 2022 au Kenya et sa rhétorique de la « Hustler Nation » ; l’opposition portée par Bobi Wine face à Yoweri Museveni en Ouganda ; et le style de gouvernement fortement personnalisé de John Magufuli en Tanzanie.















