Les femmes sont-elles des djihadistes comme les autres ?
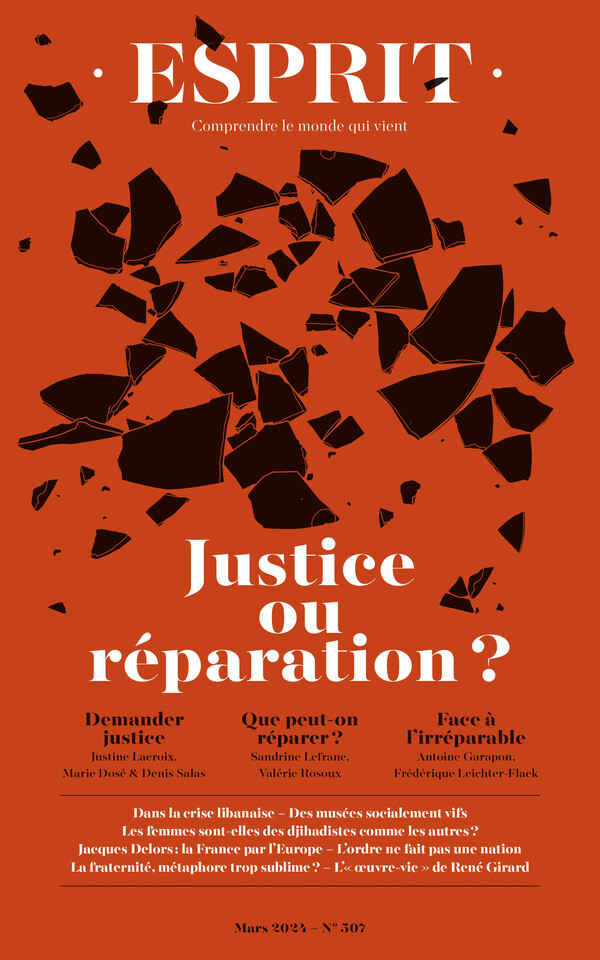
En juillet 2023, la France a rapatrié dix femmes et vingt-cinq enfants qui vivaient depuis plusieurs années dans les camps de prisonniers de Daech gérés par l’administration kurde du Nord-Est syrien. Ce rapatriement est le quatrième depuis le changement de politique décidé par le gouvernement français à la mi-2022.
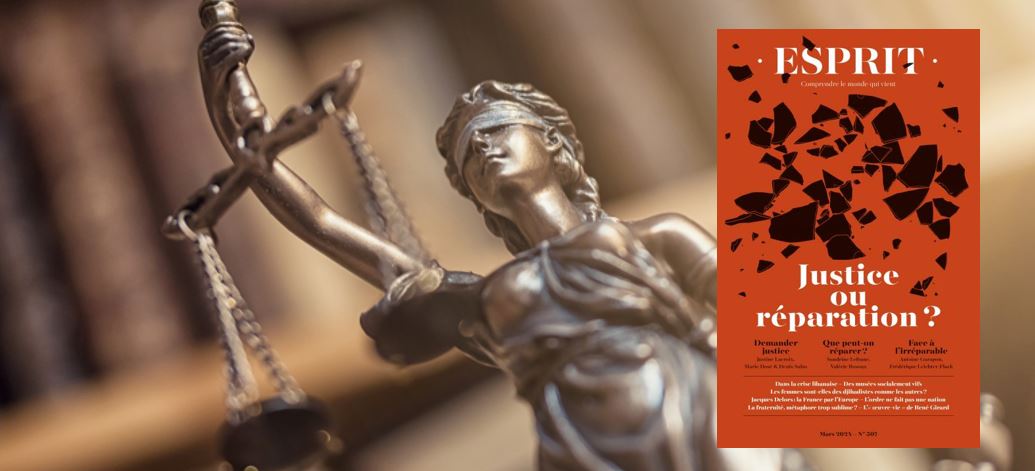
Jusqu’alors, la France ne rapatriait ses ressortissants qu’au « cas par cas », c’est-à-dire au compte-gouttes. Entre mars 2019 et janvier 2021, trente-cinq enfants « particulièrement vulnérables » avaient été ramenés sur le territoire national. S’en était suivie une pause de dix‑huit mois sans aucun retour.
Avant 2019, la problématique se posait différemment : Daech n’avait pas encore perdu l’intégralité de ses territoires en zone syro‑irakienne, et les camps gérés par les Kurdes n’avaient pas encore vu affluer des dizaines de milliers d’individus. Certains Français qui étaient parvenus à quitter la Syrie avaient réussi à rentrer par leurs propres moyens. D’autres avaient été arrêtés par les autorités turques, puis expulsés conformément au « protocole Cazeneuve », mis en place en 2014.
Parmi les cinq à six mille Européens ayant rejoint un groupe djihadiste en zone syro‑irakienne depuis le début de la guerre civile, les Français constituent le contingent le plus important, avec entre 1 400 et 1 500 individus. Le nombre de « revenants » est, quant à lui, estimé à plus de 670, dont un peu moins de la moitié de mineurs. Parmi les adultes, si les hommes étaient nettement majoritaires jusqu’à la chute de Daech, leur flux s’est ensuite tari. En effet, la politique de rapatriement n’a concerné que des femmes et des enfants.
Les femmes engagées dans le djihadisme ont fait couler beaucoup d’encre. Les ouvrages qui leur sont consacrés font apparaître un changement de perception : alors qu’elles étaient considérées au départ comme des femmes de djihadistes, elles sont vues depuis quelques années comme des femmes djihadistes. Cette évolution s’est accompagnée d’une modification de leur traitement judiciaire et carcéral, qui peut être résumé en une formule : les femmes sont désormais traitées par les pouvoirs publics comme des djihadistes comme les autres, c’est‑à‑dire des terroristes. Avant de détailler la manière dont la justice et l’administration pénitentiaire appréhendent le phénomène du djihadisme féminin, revenons sur les raisons de cette évolution.
[...]
__________
Marc Hecker
Politiste, directeur adjoint de l’Institut français des relations internationales, rédacteur en chef de Politique étrangère, il a notamment publié, avec Élie Tenenbaum, La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle (Robert Laffont, 2022).
Sofia Koller
Chercheuse au Counter Extremism Project à Berlin, elle a notamment contribué, avec Marc Hecker, à Female Jihadis Facing Justice: Comparing Approaches in Europe (ICCT, 2024).
> Voir l'article sur le site de la revue Esprit

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesCartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est de tirer les enseignements que l'OTAN pourrait tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.
Vers une nouvelle maîtrise des armements ? Défis et opportunités de l’expiration de New START
Signé en 2010 entre Barack Obama et Dmitri Medvedev pendant une période de détente entre les deux grandes puissances, New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) devrait – sauf revirement de dernière minute – expirer le 5 février 2026. Héritier des grands traités de réduction des armements stratégiques de la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, ce traité a permis de réduire les arsenaux nucléaires russes et américains de plus de 30 % par rapport au début du XXIe siècle, en instaurant des limites quantitatives sur le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées – c’est-à-dire immédiatement utilisables – et des mécanismes de transparence et de vérification mutuelles.
L’autonomisation dans le milieu sous-marin : une révolution sans limite ?
L’un des facteurs stratégiques déterminants de la guerre russo-ukrainienne en cours est le recours massif à des capacités dronisées, aériennes mais aussi maritimes et terrestres, qui révolutionnent la physionomie du champ de bataille. Pour autant, force est de constater qu’une partie significative de ces drones est encore télépilotée, téléopérée ou encore télésupervisée, attestant du fait que l’autonomisation des capacités militaires est encore en gestation.
















