Internet, outil de puissance – Asie : le choc des grandes stratégies
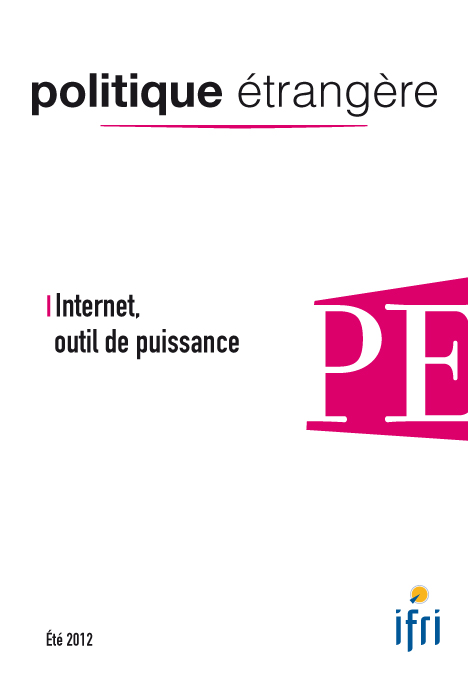
Deux espaces de notre temps se partagent cette livraison de Politique étrangère. L’un, bien réel, définira demain en large part l’avenir économique et politique de la planète : l’Asie. L’autre, que les générations descendantes qualifient encore de « virtuel », est aussi réel et pèse tout autant sur l’avenir : le cyberespace et sa composante première, Internet. Sans doute ces deux espaces englobent-ils, avec le champ des échanges financiers, les dynamiques majeures de recomposition de notre monde.
Au cœur de l’Asie : l’inconnue chinoise. Outre les interrogations sur la pérennité de sa croissance et ses éventuels cahots politiques internes, c’est la capacité de la Chine à maîtriser ses propres errances internationales qui est en cause : son poids même ne rend-il pas l’action chinoise contradictoire, et le mastodonte peut-il se faire aussi léger, aussi conciliant qu’il le prétend ? Quel effet ces errances, ces contradictions peuvent-elles avoir sur la région et sur les grands partenaires de Pékin ? Et au-delà sur le monde ? On sait que la Chine pèse bien au-delà de l’Asie : sur les approvisionnements énergétiques, sur le système financier mondial, sur l’organisation des échanges commerciaux… et sur la stratégie de la première puissance du monde, les États-Unis. Une stratégie qui pose problème à des Européens parfois dépités de la rétraction de la puissance américaine qui suit les échecs de l’ère Bush et inquiets de son indéniable réorientation en direction de l’Asie.
Certes, la Chine n’est pas seule en Asie. Mais l’Inde, sa puissance réelle et ses stratégies restent remarquablement mal connues en Occident, spécialement de ce côté-ci de l’Atlantique. Le pays n’est souvent analysé qu’en « contre » de Pékin, qu’en instrument d’une nouvelle diplomatie américaine dans la région. New Delhi a pourtant mis en œuvre depuis la fin de la guerre froide des stratégies régionales discrètes et fines qui l’installent comme joueur de plein exercice bien au-delà de l’Asie du Sud, comme élément décisif des recompositions présentes.
L’espace asiatique abrite peut-être l’« usine du monde » ; mais aussi un des laboratoires du monde de demain. On tente de s’orienter, dans le présent numéro, dans le lacis des acteurs et l’enchevêtrement des organisations intergouvernementales que recèle l’Asie : un défi non négligeable pour des esprits occidentaux que rassurent d’abord les concepts de gouvernance pyramidale… Mais ce modèle articulé d’organisations spécialisées correspond sans doute à la complexité, à la subtilité d’un vaste espace où les sous-régions se rapprochent sans se confondre, où les acteurs s’affirment en cherchant de nouveaux rôles et où la gouvernance future n’évoquera que de loin un ordonné concert des nations. L’Asie s’occupe à inventer un monde qui ne ressemblera pas au nôtre, même s’il en reprend quelques logiques – par exemple celle des accumulations d’armements.
***
Qu’Internet soit un objet politique, nul n’en doute. Il organise, désorganise, structure – mais autour de quelles logiques ? – nos sociétés. Il joue ici ou là un rôle non négligeable de mobilisation sociale, comme l’ont montré les soulèvements arabes. Il s’est développé selon des logiques propres, des modes de gestion transnationaux particuliers, qui retiennent l’attention de tous ceux qui s’intéressent à l’émergence d’une nouvelle gouvernance internationale. Il est utilisé par les États dans la gestion de leur propre espace politique – comme le rappellent les exemples russe et chinois présentés dans ce numéro. Il est aussi utile pour affirmer la présence internationale et l’action diplomatique des États (les États-Unis ont eu le mérite de le comprendre avant d’autres).
L’affaire est pourtant plus profonde. Plus qu’un simple objet politique, Internet est désormais un objet de puissance : un facteur de constitution de la puissance et un facteur d’affirmation internationale de la puissance – dans le cadre des États et en dehors d’eux. Certes, les États tiennent toujours le devant de la scène, contre les modernistes qui proclamèrent leur déclin dès l’immédiat après-guerre froide. L’après-11 septembre a vu, pour le meilleur ou le pire, leur retour en force dans la « guerre contre le terrorisme ». C’est encore vers les États que se tournent les plus enragés « déréglementeurs » en temps de crise économique. Quant aux chaos politiques qui mobilisent l’attention internationale, qui pourrait hors les États les prendre en charge ? Mais l’espace Internet pose – de manière pratique mais aussi théorique – un véritable problème au fondement même de l’action des États : la souveraineté. [...]
Licence d'abonnement et pay per view : CAIRN

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Internet, outil de puissance – Asie : le choc des grandes stratégies
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesCrise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.

Ouverture du G7 à la Corée du Sud : relever les défis mondiaux contemporains
L'influence mondiale du G7 s'est affaiblie à mesure que des puissances telles que la Chine remodèlent la gouvernance internationale à travers des initiatives telles que les BRICS et l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). Le G7 ne représentant plus aujourd'hui que 10 % de la population mondiale et 28 % du PIB mondial, sa pertinence est de plus en plus remise en question.
Cambodge-Thaïlande : un accord de paix en trompe-l’oeil
Après le Moyen-Orient, Donald Trump a vu en Asie du Sud-Est une nouvelle opportunité de consolider son image de président faiseur de paix. Confirmée à la dernière minute par la Maison-Blanche, sa participation au sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) a ainsi été conditionnée à l’organisation en grande pompe d’une cérémonie de signature d’un accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande.
Le rôle clé de la Chine dans les chaînes de valeur des minerais critiques
La Chine occupe aujourd’hui une position dominante dans les chaînes de valeur des minerais critiques, de l’extraction à la transformation jusqu’aux technologies en aval. Cette suprématie repose sur des décennies de politiques industrielles et lui confère une influence stratégique considérable sur la sécurité d’approvisionnement mondiale, notamment pour l’Union européenne.













