Théories et pratiques des relations internationales depuis la fin de la guerre froide
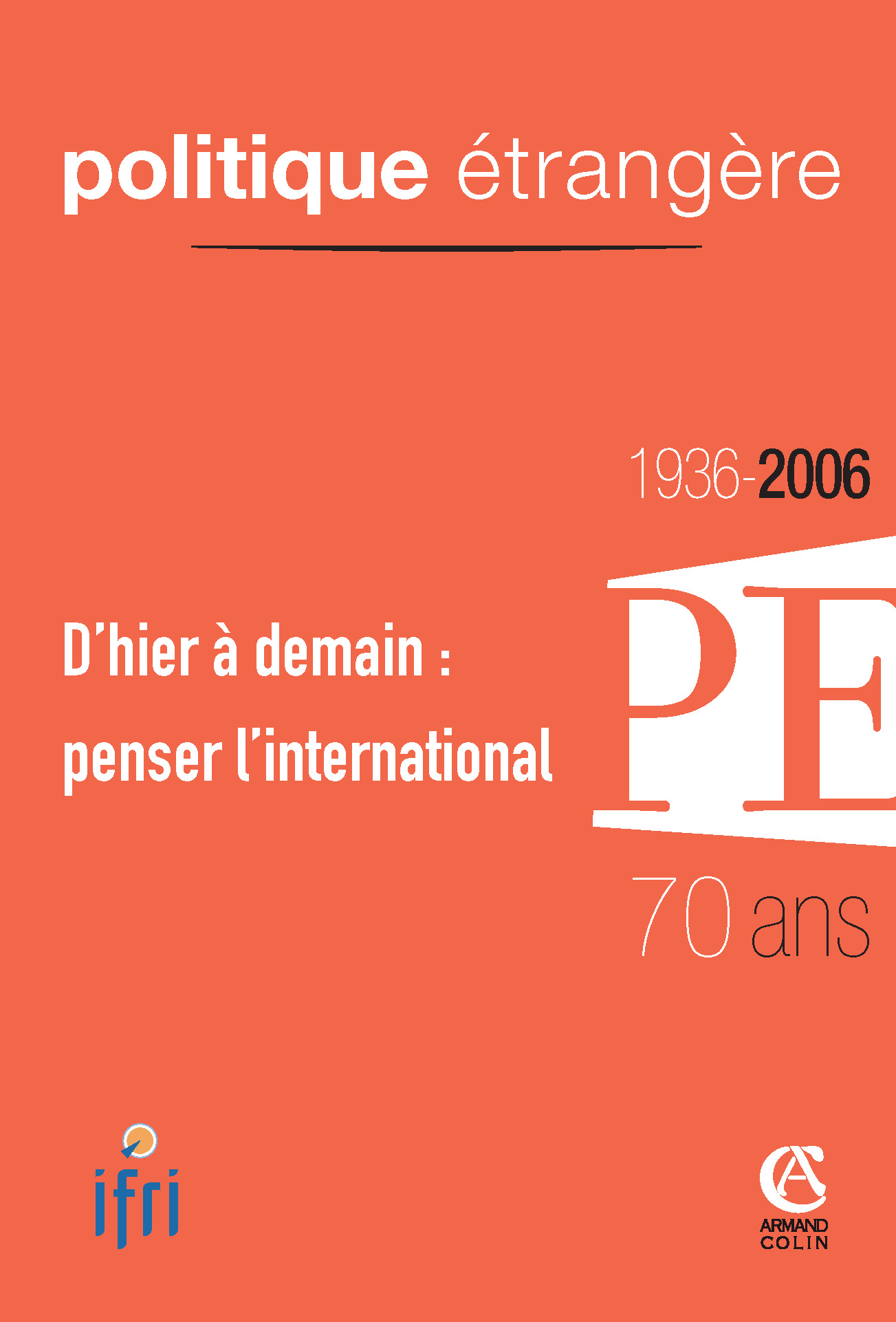
L’effondrement de l’Union soviétique a considérablement modifié les pratiques des relations internationales et a suscité des débats théoriques qui se poursuivent encore. L’école réaliste, dominante pendant la guerre froide, a été remise en cause par les tenants du transnationalisme. Chaque courant de pensée permet, à sa manière, d’éclairer le monde dans lequel nous vivons, et les théories doivent être perçues davantage comme des outils interprétatifs que comme des dogmes infaillibles.

Les relations internationales ont subi d’importantes transformations depuis la fin de la guerre froide, d’autant que l’effondrement de l’empire soviétique a eu lieu dans le cadre de la mondialisation. La destruction du rideau de fer, l’élargissement de l’Union européenne (UE), la montée en force de nouveaux pôles de puissance économique et politique en Asie, au premier rang desquels la Chine et l’Inde, l’expansion très rapide des marchés de biens et de services – stimulée tant par l’aboutissement des négociations du cycle d’Uruguay que par les innovations techniques dans les secteurs des communications et de l’information –, la mainmise croissante des milieux d’affaires sur l’économie mondiale, les perturbations politico-stratégiques consécutives au 11 septembre 2001 sont des aspects de ces changements. Les États sont aujourd’hui imbriqués dans des réseaux d’interdépendance étroits et les individus, aussi bien que les mouvements sociaux, interagissent au niveau planétaire grâce à ces évolutions structurelles et politiques.
Quelle signification faut-il donner à ces changements ? S’agit-il d’une mutation dans l’essence même des relations internationales ? Quelles sont les incidences politiques et normatives des nouveaux flux transnationaux, des régimes de coopération, des organisations intergouvernementales, des entreprises transnationales ? Ces questions ont engendré une vaste littérature allant d’essais superficiels et anecdotiques à des travaux visant des efforts de théorisation rigoureux. Il n’existe toutefois guère d’accord, parmi les chercheurs engagés dans l’étude des relations internationales, sur les causes et les conséquences de ces évolutions, sur leurs implications théoriques et pratiques. Certains auteurs sont enclins à minimiser les changements structurels en cours, en recherchant sur la longue durée les racines historiques des évolutions actuelles du système capitaliste, d’autres à les désigner comme la manifestation d’une rupture importante, voire même radicale, avec le passé.
Dans un monde marqué par l’emprise grandissante des réalités transnationales sur le devenir des sociétés – influence qui est de nature économique, sociale, politique et institutionnelle –, on doit reconnaître que la distinction entre la sphère étatique et celle des relations internationales est toujours moins tranchée. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Les débats sur la mondialisation
- Les enjeux normatifs
- Les défaillances des institutions internationales
Pierre de Senarclens, professeur en relations internationales à l’Université de Lausanne, ancien directeur de la Division des droits de l’homme et de la paix à l’UNESCO (1980-1983), est aujourd’hui vice-président du Conseil de la Croix-Rouge suisse. Son dernier ouvrage publié, avec Y. Ariffin, est : La Politique internationale. Théories et enjeux contemporains (Paris, Armand Colin, 2006).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Théories et pratiques des relations internationales depuis la fin de la guerre froide
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.








