Quand la technologie façonne le monde...
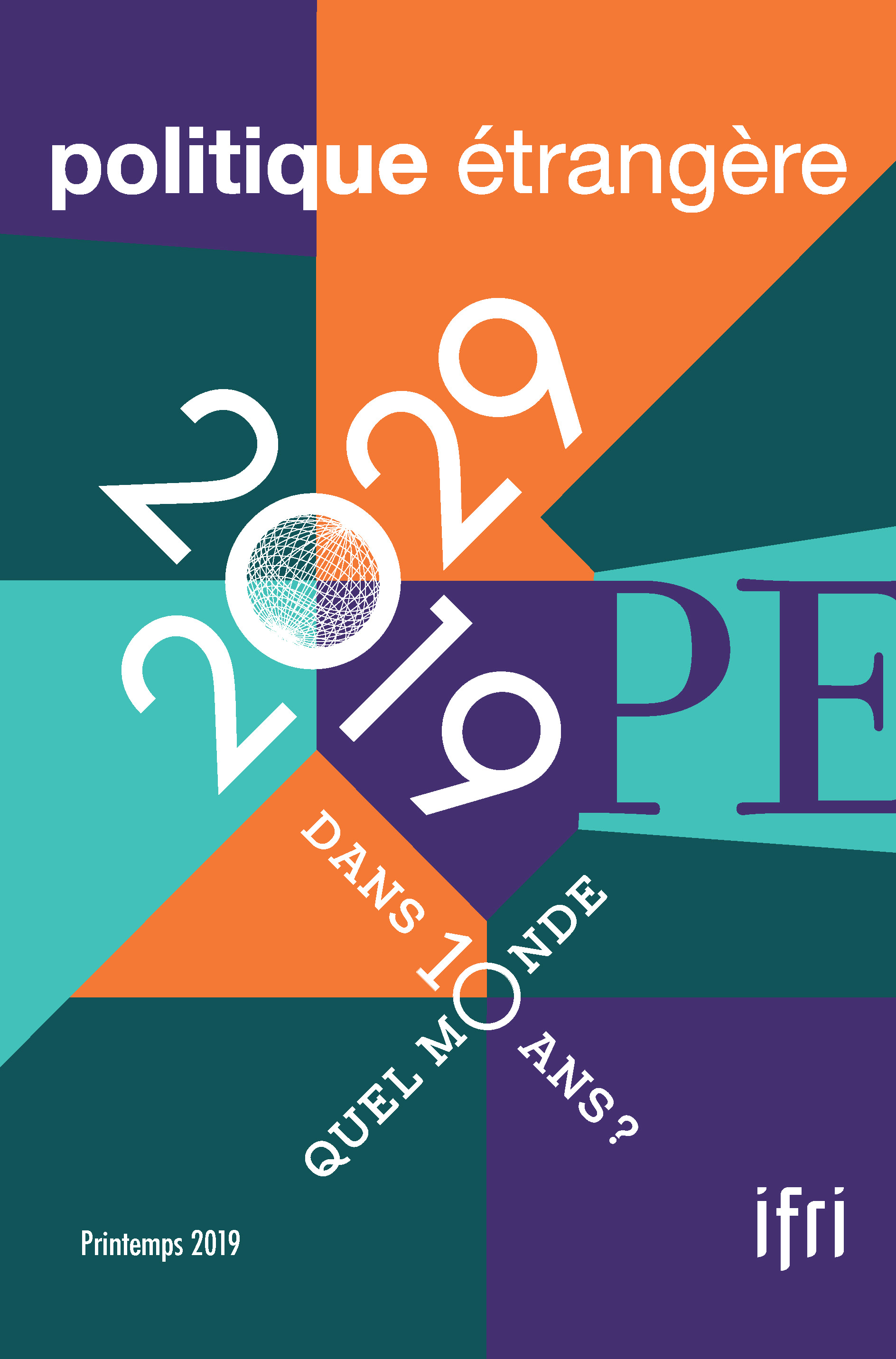
Les nouvelles technologies – en particulier dans le cyberespace – ont un fort impact sur les relations internationales et la conflictualité. Les acteurs malveillants – que ce soit des États ou des acteurs non étatiques – développent des opérations d’influence sophistiquées. Ils tendent à coordonner de plus en plus finement leurs actions physiques et cyber. Les stratégies de sécurité des États occidentaux doivent évoluer en conséquence et cesser de fonctionner en silo.

Les technologies cyber sont de plus en plus sophistiquées mais demeurent accessibles à un grand nombre d’acteurs. Leur développement redéfinit certaines catégories traditionnelles des relations internationales, et introduit de nouvelles sources de conflits potentiels entre États. Ces derniers ne peuvent plus se permettre de dissocier les environnements physiques et numériques. Les implications de la cybernétique ayant introduit de nouvelles menaces, une approche sécuritaire plus globale est devenue nécessaire. La technologie a, notamment, élargi les paramètres de la guerre classique, permettant aux individus d’influer et d’agir sur la stabilité des États et du système dans son ensemble.
Les opérations d’influence, à l’instar de la désinformation, offrent le meilleur angle de vue pour étudier l’incidence de la technologie sur la géopolitique. Amplifiées par la puissance de la cybernétique, elles ont des effets inédits sur les relations internationales. Ceux-ci se révèlent bien plus difficiles à contrer que les formes classiques de cyberguerre. C’est la psyché même des citoyens qui est visée, d’où des défis sans précédent pour les gouvernements des nations prises pour cible.
La cyber-conflictualité a rebattu les cartes de la sécurité et des conflits internationaux. Les cyberattaques sont peu onéreuses et difficiles à attribuer, ce qui a d’abord pour effet d’enhardir les acteurs étatiques et non étatiques. La guerre cinétique classique repose sur des armes et des cibles classiques, d’abord constituées des moyens militaires de l’adversaire (d’où les destructions d’infrastructures, les occupations de territoires, etc.). Le cyber a redéfini les notions de contrôle d’un espace et même de victoire.
L’arsenal des cyberattaques comprend, entre autres, des tactiques comme le piratage, l’emploi de logiciels malveillants (malwares) et les attaques par déni de service (DoS). Il permet de pénétrer, endommager et perturber des ordinateurs et des réseaux. L’omniprésence des technologies de communication modernes – téléphones mobiles, réseaux sociaux, applications de messagerie, objets connectés… – crée de nouvelles vulnérabilités. Ces technologies constituent une ligne d’accès directe entre acteurs malveillants et individus, qui peut être utilisée par des gouvernements adverses ou des groupes non étatiques à des fins de déstabilisation. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Repenser la sécurité à l’ère de l’autonomisation des individus
- La conflictualité à l’âge de la post-vérité
- Étude de cas : le conflit en Ukraine
Jared Cohen est président de Jigsaw, incubateur créé par Google dans le but de développer des technologies permettant d’« améliorer la sécurité des personnes dans le monde entier ». Il est chercheur associé au Council on Foreign Relations et a travaillé au Policy Planning Staff du Département d’État. Il est l’auteur de Accidental Presidents, New York, Simon & Schuster, 2019.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Quand la technologie façonne le monde...
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.








