Désigne, détruit, domine : la dronisation massive des opérations comme potentielle révolution militaire
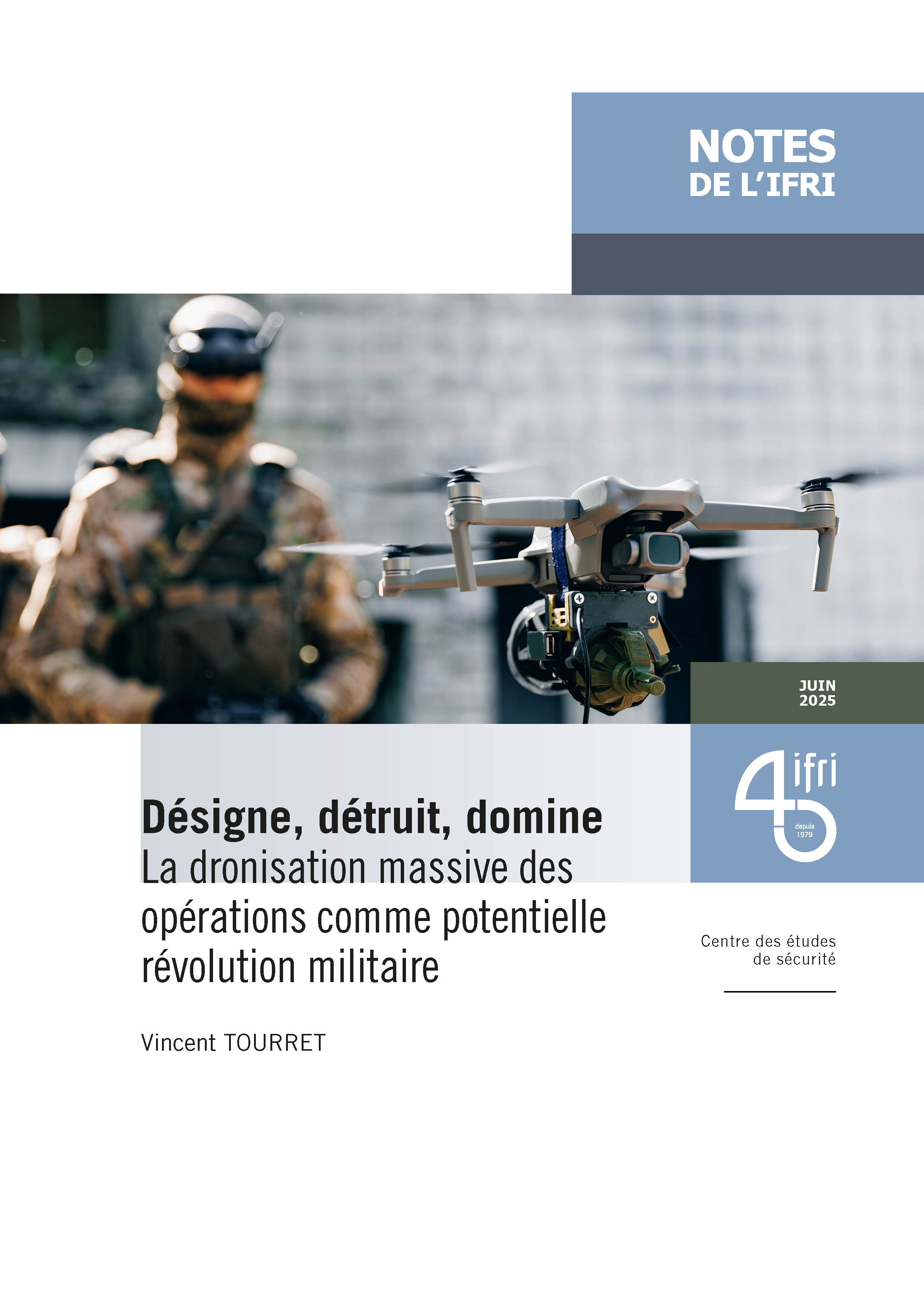
La dronisation observée en Ukraine, par l’ampleur des flottes engagées et son omniprésence dans les opérations des deux belligérants, semble réunir les conditions d’une véritable révolution militaire.

La dronisation ne peut être réduite à une innovation technique ou à une gamme spécifique d’appareils. Elle s’impose comme un principe de transformation comparable à la motorisation et mécanisation du siècle passé. Elle s’incarne dans l’évolution des appareils en objets consommables et adaptatifs, dans l’avènement d’une « guerre participative », dans la conduite des opérations, qui évolue vers un « combat multi-feux, multi-champs ».
Pour le modèle de force européen, l’exemple ukrainien devrait conduire à établir l’écosystème numérique, industriel et humain capable d’accompagner la dronisation : constituer un système d’information et d’aide à la décision unifié, développer une « culture drone » dans les forces armées et cibler à court terme le « segment haut » de la dronisation, soit les capacités de frappe en profondeur.
Entrant dans sa troisième année, l’invasion russe de l’Ukraine est le théâtre d’une dronisation massive des opérations. Le phénomène est sans précédent, tant d’un point de vue quantitatif avec désormais plusieurs millions d’appareils produits et détruits chaque année, que par son influence sur la cinématique des opérations et la structure des forces. À titre d’indication, le conflit le plus « dronisé » avant 2022 est la guerre pour le Haut-Karabagh. Dans celui-ci, les pertes infligées par les drones sont de l’ordre de 45 % du total des blindés, véhicules, pièces d’artillerie et batteries antiaériennes. En Ukraine, en 2025, 60 à 70 % des pertes toutes catégories confondues sont la résultante de frappe de drone.
Pour les deux belligérants, les drones se sont ainsi imposés comme les capteurs, relais et effecteurs majeurs des hostilités. Ils constituent le système nerveux robotisé et de plus en plus automatisé qui conditionne l’application de leurs feux et la coordination de leurs mouvements, tous milieux et champs confondus. Véritables chimères techniques aéroterrestres, les drones servent en effet à la fois de jumelles, de grenades et de mortier pour l’infanterie qui s’empresse de les reconfigurer en permanence pour s’adapter au plus près de leur adversaire. Ils s’imposent également dans le combat de contre-batterie, la reconnaissance en profondeur et l’interdiction du champ de bataille qui constituaient jusqu’ici le cœur de métier de l’aviation légère. Dans la profondeur stratégique, ils renouvellent les méthodes de pénétration des défenses anti-aériennes et matérialisent, par une massification à moindre coût, les schémas de salves manœuvrantes contre les cibles jugées critiques, économiques et politiques, de l’effort de guerre des belligérants. Plus fondamentalement, ce sont enfin les drones qui permettent aux armées ukrainienne et russe de maintenir leur cohérence et leur combattivité dans une situation d’attrition extrême de leurs effectifs et matériels lourds. Ils leur prodiguent l’élément de choc nécessaire dans leurs poussées offensives et leur garantissent une force d’arrêt suffisante pour maintenir ou réoccuper leurs positions. Les drones saturent ainsi les premières lignes à la manière d’une mitraille permanente ou d’un bouclier réactif contre les pénétrations adverses. Ils s’infiltrent et rôdent dans les arrières pour mener la chasse aux appuis-feux et soutiens logistiques, incarnant une menace permanente pour toutes rotations de troupes et de matériels. Ils opèrent enfin des raids à longue portée contre les infrastructures et les concentrations de troupes.
Contrairement à l’image d’un front continu de 1 000 kilomètres (km) allant de Kharkiv à Kherson, la guerre de position qui s’est imposée en Ukraine depuis l’automne 2022 est, aux échelons tactique et opérationnel, profondément lacunaire et fluide. Pour survivre sur un champ de bataille saturé de capteurs et en puissance de feu, les forces en présence se sont démécanisées et dispersées. Selon les Russes, « en défense, 10 hommes maximum […] peuvent retenir l’avancée d’un ennemi supérieur, parfois jusqu’à l’équivalent d’une compagnie renforcée ». « Les opérations à grande échelle mettant en œuvre des bataillons et des régiments » sont rendues prohibitives par l’impératif d’assurer un « soutien complet et global » en matière de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) sur toute la profondeur défensive adverse, mais aussi de guerre électronique (GE), de défense sol-air (DSA), et d’appui-feux par l’artillerie, l’aviation ou des drones de frappe. Cette complexité confère ainsi aux opérations le caractère d’une progression méthodique et saccadée, proche dans son esprit de la « bataille conduite » de la fin du premier conflit mondial. Chaque poussée requiert des efforts de préparation et de coordination qui s’avèrent insoutenables à plus large échelle ou sur la durée pour les organisations traditionnelles. En conséquence, l’introduction des forces s’apparente à la menée d’incursions ou de raids limités. L’infanterie en est réduite à s’infiltrer par petits groupes et, comme le décrit un officier russe, à monter à l’assaut « à cheval » sur des véhicules sans protection mais rapides.
L’échelonnement des feux et des capteurs robotisés, dronisés, automatisés remplace ainsi celui des forces, devenu insoutenable humainement et matériellement pour deux États post-industriels. La dronisation aboutit à former un véritable maillage et tuilage « multi-feux, multi-champs » extrêmement résilient et adaptatif qui enserre les actions des deux belligérants et accapare leur attention.
Des bouleversements d’une telle ampleur imposent par conséquent de trancher cette question : la dronisation incarne-t-elle une révolution militaire ? En revenant d’abord sur les critères d’un tel concept, l’analyse portera sur ses caractéristiques et implications, au niveau des appareils, des systèmes de production puis dans la conduite des opérations.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Désigne, détruit, domine : la dronisation massive des opérations comme potentielle révolution militaire
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesCartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est de tirer les enseignements que l'OTAN pourrait tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.
Vers une nouvelle maîtrise des armements ? Défis et opportunités de l’expiration de New START
Signé en 2010 entre Barack Obama et Dmitri Medvedev pendant une période de détente entre les deux grandes puissances, New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) devrait – sauf revirement de dernière minute – expirer le 5 février 2026. Héritier des grands traités de réduction des armements stratégiques de la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, ce traité a permis de réduire les arsenaux nucléaires russes et américains de plus de 30 % par rapport au début du XXIe siècle, en instaurant des limites quantitatives sur le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées – c’est-à-dire immédiatement utilisables – et des mécanismes de transparence et de vérification mutuelles.
L’autonomisation dans le milieu sous-marin : une révolution sans limite ?
L’un des facteurs stratégiques déterminants de la guerre russo-ukrainienne en cours est le recours massif à des capacités dronisées, aériennes mais aussi maritimes et terrestres, qui révolutionnent la physionomie du champ de bataille. Pour autant, force est de constater qu’une partie significative de ces drones est encore télépilotée, téléopérée ou encore télésupervisée, attestant du fait que l’autonomisation des capacités militaires est encore en gestation.












