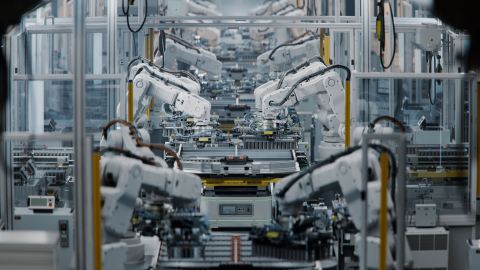Simone Veil (1927-2017)

Simone Veil, qui vient de décéder, a été membre du Conseil d'administration de l’Ifri pendant de nombreuses années. Nous nous souvenons de son attention bienveillante et de son soutien constant.
Elle avait par ailleurs rédigé un article pour Politique étrangère (n° 2/1988) au sujet de son rapport à Israël. Nous reproduisons ce texte ci-dessous.
Il y a quarante ans, mon rapport avec Israël était avant tout d’ordre affectif. À Auschwitz, j’avais découvert ce que signifiait le sionisme pour une diaspora toute tendue vers la recherche de la terre promise. Pour les juifs déportés de Pologne, pour certains de ceux venus de Tchécoslovaquie, l’idée de rester en Pologne ne les effleurait pas ; seul les habitait, si jamais ils échappaient à l’extermination, l’espoir de se rendre en Palestine. Pour nous, juifs français, la question ne se posait pas. La France nous attendait, notre vie reprendrait chez nous, pas comme avant, mais presque.
Après 1945, je me suis sentie profondément solidaire du périple des personnes déplacées vers la Palestine, des acteurs de l’aventure tragique d’Exodus, des victimes du refoulement par les Anglais. J’ai vécu la déclaration d’indépendance d’Israël et les combats qui ont suivi dans une perspective émotionnelle. La création de l’État juif apparaissait comme une espèce de miracle, la réalisation d’une promesse autant que d’un rêve. L’État d’Israël, c’était aussi un pays d’accueil pour les juifs chassés et persécutés durant des siècles.
C’était une terre que l’on fertilise, un désert qui devient verger. C’était enfin le pays des kibboutz, d’une expérience nouvelle d’organisation sociale fondée sur la solidarité. Les juifs devenaient tout à la fois soldats et hommes de la terre. Cette émotion que j’éprouvais alors, je la ressens encore aujourd’hui face à la transformation du pays quand je vais de Jérusalem à Tel-Aviv, à travers cette route si chargée d’histoire et empreinte de tant de beauté.
J’avais vécu l’aventure militaire de la défense du territoire avec passion, angoisse. Au lendemain de la guerre des Six Jours, en 1967, après une victoire brillante, rapide et qui survenait après une très grande peur, je me posais de nouvelles questions : Israël était victorieux mais comment allait-il aménager sa victoire ? Saurait-il concilier les exigences de sa sécurité avec le principe du respect du droit des peuples ? C’est en termes personnels et émotifs, encore une fois, que j’ai vécu ce dilemme. Je ne saurai mettre en cause la sécurité d’Israël mais en même temps la reconnaissance de certaines valeurs s’impose. Je vis dans une perpétuelle tension, prise entre le désir de l’objectivité – si nécessaire à Israël – et en même temps la difficulté, n’étant pas israélienne, n’assumant pas les risques des Israéliens d’adopter une approche objective et en quelque sorte désincarnée.
Il est facile d’être donneur de conseils et de jouer au juste en se retranchant derrière des principes alors qu’on assume ni les charges ni les risques d’un pays en guerre. Mon avenir se joue ailleurs, ce n’est ni ma sécurité, ni celle de mes enfants qui sont en cause.
Pourtant je ne puis cacher qu’en 1982, au lendemain de l’invasion israélienne du Liban, je me suis sentie particulièrement troublée. D’instinct, je jugeais cette aventure risquée – comme beaucoup d’Israéliens – mais il m’était désagréable de m’exprimer ouvertement et en public. Lorsqu’on exerce des responsabilités publiques dans son pays, l’influence que peut exercer ce que l’on dit, ce que l’on exprime, peut aller bien au-delà de ce que l’on a voulu dire, bien au-delà de votre pensée. Aussi me suis-je imposée une grande prudence d’expression. La tentation permanente de la diaspora est de juger Israël. Mais ce que nous disons est perçu différemment par les Israéliens et par le monde extérieur.
Parce que nous sommes juifs, on accorde à nos propos une signification particulière, souvent mal ressentie par les Israéliens eux-mêmes, même si une partie des Israéliens sollicitent l’avis de la diaspora à des fins de politique intérieure. Une grande majorité d’Israéliens, en fait, acceptent difficilement que les juifs de la diaspora prennent parti dans leur débat intérieur. Ils le vivent comme une accusation, un rejet, une remise en cause illégitime. Au moment où Shimon Pérès se déclara favorable à l’idée d’une conférence internationale sur le Moyen-Orient, je fus sollicitée pour appuyer ce projet. À l’époque je ressentais cette initiative comme inopportune, et pour le moins prématurée. Aujourd’hui, les propositions de George Shultz interviennent dans un contexte international différent. La situation dans les territoires occupés est telle que l’ouverture et le dialogue s’imposent pour sortir de l’impasse dans laquelle Israël se trouve.
Quarante ans nous séparent de la création de l’État d’Israël. Pour beaucoup de jeunes Européens, les victimes aujourd’hui ce sont les Palestiniens. Ils ignorent les conditions qui ont amené la création de l’État d’Israël même s’ils connaissent la shoah. Ils ne perçoivent pas Israël comme une terre d’accueil. Comment les jeunes comprendraient-ils les événements qui secouent Israël sur le plan affectif comme sur le plan historique ? Au lendemain de la rencontre germano-américaine de Bitburg, en 1985, j’ai très intensément éprouvé qu’une phase de l’histoire était en train de s’achever, que l’on passait à autre chose. Quarante ans, c’est le temps qu’il a fallu à Moïse pour sortir du désert. Quarante ans, c’est l’espace de deux générations. Celle qui a subi, et celle qui, déjà, théorise.
Devant le passage du temps, la diaspora doit avant tout éviter le provincialisme, le repli sur soi. Aujourd’hui, j’éprouve à l’égard d’Israël la même émotion, le même attachement, mais également une inquiétude. Plus que jamais, l’interdépendance des pays entre eux s’impose comme une réalité. Certes, la détente pourrait profiter à Israël. Mais la situation d’Israël est objectivement périlleuse. Politiquement, culturellement, Israël fait partie du Nord, mais géographiquement il se trouve au Sud. Israël doit-il devenir un pays du Sud et accepter d’y jouer son destin, devenant un partenaire ouvert au dialogue avec ses voisins, fussent-ils arabes, dans un ensemble régional ? Est-il inconcevable de penser qu’Israël pourrait apporter une manière de penser et de faire qui leur serait pour tous un facteur de progrès ?

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Simone Veil (1927-2017)
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa Russie, les Palestiniens et Gaza : ajustements après le 7 octobre
L'Union soviétique (URSS), puis la Fédération de Russie en tant que successeur légal internationalement reconnu, ont toujours cherché à jouer un rôle visible dans les efforts visant à résoudre le conflit israélo-palestinien.
Le Canada et la reconnaissance de l'État palestinien
Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
La République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.