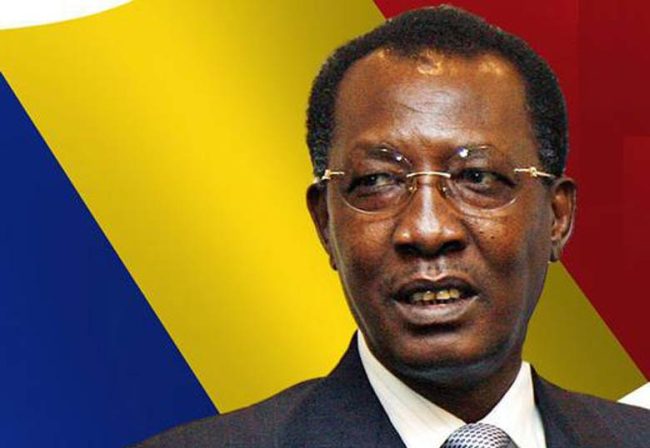Afrique subsaharienne
L'Afrique subsaharienne n'est pas monolithique. Si les crises au Sahel ont beaucoup retenu l'attention, les autres régions doivent aussi être suivies, et pas uniquement à travers le prisme de la sécurité.
Sujets liés

La politique russe de recrutement de combattants et d’ouvrières en Afrique subsaharienne

La guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022, s’est rapidement internationalisée. La Russie et l’Ukraine se sont très vite efforcées de mobiliser leurs alliés afin d’obtenir un soutien politique et diplomatique, ainsi que des ressources militaires et économiques. Mais les deux belligérants ont aussi cherché à recruter des étrangers à titre privé pour soutenir leurs efforts de guerre respectifs. Cette politique est globale et s’étend de l’Amérique latine à l’Extrême-Orient. L’Afrique subsaharienne, dans ce panorama, présente un intérêt particulier car elle constitue un vivier de recrutement vaste et facilement accessible, en raison de taux de pauvreté élevés dans la plupart des pays de la zone conjugués à un important désir d’émigration.
TIC et systèmes de santé en Afrique
De plus en plus de projets mobilisent les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le domaine de la santé en Afrique.
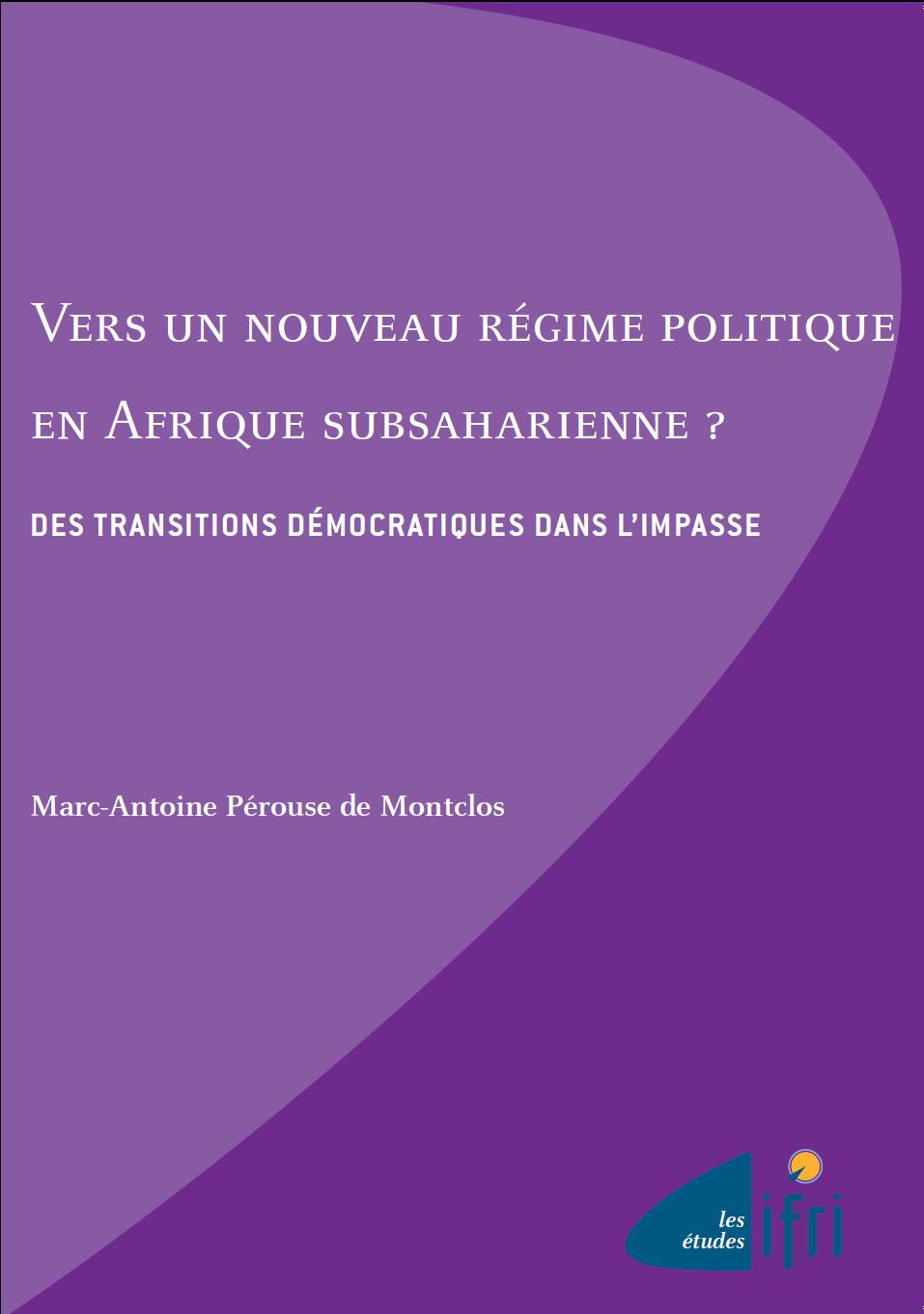
Vers un nouveau régime politique en Afrique subsaharienne : Des transitions démocratiques dans l'impasse
L’Afrique subsaharienne est revenue sur les espoirs de démocratisation qu’avait suscités la fin de la guerre froide et des régimes de parti unique. L’heure est à la désillusion. Même les pôles de stabilité qu’étaient le Sénégal (depuis l’indépendance en 1960) et l’Afrique du Sud (depuis 1994) sont aujourd’hui menacés d’une dérive autoritaire.
Les "émeutes de la faim" au Sénégal : Un puissant révélateur d'une défaillance de gouvernance
L’expression " émeutes de la faim ", qui a été utilisée lors des manifestations de la fin 2007 / début 2008 dans une trentaine de pays dans le monde, dont une majorité de pays africains, rassemble des phénomènes de nature très différente d’un pays à l’autre. Nous nous attacherons dans cette note à revenir sur le cas du Sénégal, pays où les " émeutes " ont été nombreuses.
Une rapide recension des différentes " manifestations " de mécontentement qui ont secoué ce pays laisse apparaître, entre autres, la faillite d’un secteur agricole qui, bien qu’employant presque 60 % de la population active, n’arrive pas à nourrir la population sénégalaise. Un tel constat invite à s’interroger sur les causes structurelles, qui ne peuvent être réduites à des raisonnements économiques. Bien vite, la défaillance de gouvernance apparaît dans toute sa béance : accoutumance aux importations, structure monopolistique de l’importation de certains produits, sacrifice des populations rurales pendant des décennies pour s’assurer de prix raisonnables pour les consommateurs urbains, bien plus redoutés par le pouvoir. Les blocages ne sont pas toujours là où on les croit.
Alain Antil est responsable du programme Afrique subsaharienne à l'Ifri
Violences en brousse : Le "peacebuilding" international face aux conflits fonciers
Suite au conflit en Ituri (1999-2003), la communauté internationale a déployé divers programmes de reconstruction de la paix dans ce district du nord-est de la République démocratique du Congo (RDC). Inclus dans une approche nationale de transition démocratique, ces programmes n’ont pas toujours pris la mesure de l’ampleur des conflits locaux et de la fragilité des institutions locales qui sont à la fois les cibles et les relais de ces programmes.
S’intéressant prioritairement au système judiciaire, l’intervention internationale a montré ses limites et ses dysfonctionnements. Les opérateurs ont dans un premier temps négligé la dimension foncière du conflit iturien et la nécessité d’une action intégrée dans ce domaine. À partir de 2006, quelques actions de soutien aux acteurs du foncier se sont mises en place, sans toutefois embrasser l’intégralité de la problématique : prévalence de la coutume, faiblesse de l’administration, limites de l’approche institutionnelle, dimension politique, rôle mineur de la société civile. Cependant, une initiative locale a vu le jour avec la création d’une Commission foncière de l’Ituri qui, après quelques balbutiements, semble pouvoir être une piste intéressante de prévention et de gestion des conflits fonciers si elle parvient à relever deux défis : devenir viable et intégrer une diversité d’acteurs qui lui permettra d’asseoir sa légitimité et de trouver des solutions innovantes au règlement des conflits fonciers.
Florence Liégeois est responsable Programmes République Démocratique du Congo, RCN Justice & Démocratie ASBL
Thierry Vircoulon est chercheur associé au programme Afrique subsaharienne de l'Ifri
Un an après le début de la crise politique malgache, quel bilan ?
La crise malgache, inaugurée avec les tristes évènements du 26 janvier 2009 a aujourd’hui un an et aucune perspective de sortie de crise n’est apparue. Les accords de Maputo II (9 août 2009) et d’Addis Abeba (6 novembre 2009) ne sont plus d’actualité et le Groupe International de Contact (GIC), aujourd’hui mené par Jean Ping, a tenté une médiation de la dernière chance devant déboucher sur une mission de l’Union Africaine (UA) du 11 au 13 février à Antananarivo.
Le Président de la Haute Autorité de la Transition (HAT), Andry Rajoelina, doit proposer à l’UA des mesures plus inclusives, réintégrant les trois autres mouvances dans le processus de sortie de crise (mouvances Albert Zafy, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana). Depuis le 3 janvier, ces trois mouvances ont d’ailleurs choisi de se réunir au sein de la très fragile " mouvance Madagascar ".
Les aides internationales demeurent suspendues, le pouvoir du Président de la HAT n’a pas été reconnu et son assise demeure des plus fragiles, tant en raison de l’érosion de ses soutiens politiques que de l’influence grandissante de l’armée au sein de l’appareil étatique. De nombreux observateurs craignent un progressif délitement de l’État malgache. Concomitamment à ce blocage politique, la situation économique, comme le contexte sécuritaire, continuent de se dégrader, ce qui ne permet pas d’écarter l’éventualité d’une nouvelle mobilisation populaire.
L’urgence d’un déblocage de la situation est sur toutes lèvres mais les acteurs ne s’accordent pas sur les solutions à déployer, ce qui laisse craindre un enlisement de la situation actuelle.
L'interview a été réalisée le 25/01/2010 à Antananarivo
Les enjeux financiers de l'explosion des télécoms en Afrique subsaharienne
Les télécoms ont pris une importance significative dans l'économie de la plupart des pays africains. En cela, ce secteur est une source indéniable de croissance économique et de développement. La sphère financière est impactée à trois niveaux par ce phénomène.
Touaregs et Arabes dans les forces armées coloniales et maliennes : une histoire en trompe-l'oeil
Cette contribution propose d'analyser les rapports qui unissent ou opposent le pouvoir central de l'Etat aux populations de la frange sud du Sahara central, Touaregs et Arabes principalement, et ce, dans un espace relationnel particulier : celui des forces armées coloniales et maliennes.
Les questions foncières rurales comme facteur de crise en Afrique subsaharienne : Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Kenya
La problématique foncière rurale en Afrique subsaharienne, où le secteur agricole occupe toujours une place importante tant dans le PIB que dans la population active, est l'une des questions essentielles pour le devenir des sociétés africaines.
De Thabo Mbeki à Jacob Zuma : Quelle sera la nouvelle vision de l'Afrique du Sud ?
Mobilisations identitaires dans l'Afrique contemporaine : La question de l'autochtonie
Les accords de partenariat économique : un chemin critique vers l'intégration régionale et la libéralisation des échanges

Sub-Saharan Africa: Implosion or Take-Off?
Candide au Congo. L'échec annoncé de la réforme du secteur de sécurité (RSS)

Vers un gouvernement de l’Union africaine ? Gradualisme et statu quo v. immédiatisme
Tant que l’Union africaine demeurera une organisation de coopération et de coordination des positions, et non d’intégration, tant que la Commission restera un simple secrétariat sans pouvoir exécutif, le gouvernement de l’Union ne pourra prendre forme.
L'Aide publique au développement japonaise et l'Afrique : vers un partenariat fructueux?

Les élections angolaises de septembre 2008 : Entretien avec Indira Campos
Les dynamiques paradoxales du pentecôtisme en Afrique subsaharienne
Zimbabwe : "Pour le moment, on peut parler uniquement de tentative de coup d'Etat"
Une partie de l’armée, qui nie tout coup d’Etat, a pris le contrôle de la capitale, Harare, précisant que le président Mugabe restait au pouvoir. Thierry Vircoulon évoque une lutte pour la succession à la tête de l'Etat.
Tensions au Zimbabwe
La situation au Zimbabwe est très confuse. Le Président Mugabe est retenu par l'armée en résidence surveillée. Peut-on parler d'un coup d'Etat militaire ? La question de la succession du Président Mugabe se pose... Commentaires de Victor Magnani, spécialiste de l'Afrique australe à l'Ifri.
Le Qatar et les Emirats arabes unis à la chasse aux amis africains
Alors que la crise dans le golfe Arabo-Persique perdure, les deux émirats investissent le terrain africain pour élargir le cercle de leurs partenaires habituels.


Comment le nouveau président angolais tente de s'affranchir du clan dos Santos
« La Centrafrique est devenue le pays malade de la région »
Arrivé à Bangui le 24 octobre 2017, le secrétaire général de l’ONU Alexandre Guterres a estimé que «la communauté internationale ne s'engage pas suffisamment (…) pour aider» la Centrafrique. La situation dans ce pays est décrite comme chaotique. Entretien avec Thierry Vircoulon, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (IFRI).
Le maintien de la paix, version ONU : radiographie d’une impuissance
En matière de maintien de la paix, les Nations unies sont maintenant au pied du mur.
Que fait (vraiment) l’ONU pour la paix ?
À la veille de la 72ème Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvrira le 18 septembre prochain, nous questionnons le rôle de l'ONU ainsi que sa capacité à maintenir la paix dans le monde.


Au Kasaï comme ailleurs en RDC, « le désordre comme art de gouverner » de Joseph Kabila
Analyste pour l’IFRI, Marc-André Lagrange décrypte la stratégie de déstabilisation intérieure mise en place par le régime pour se maintenir au pouvoir.
Diplomatie tchadienne au Qatar : marche arrière toute !
Soutenez une recherche française indépendante
L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.