Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation
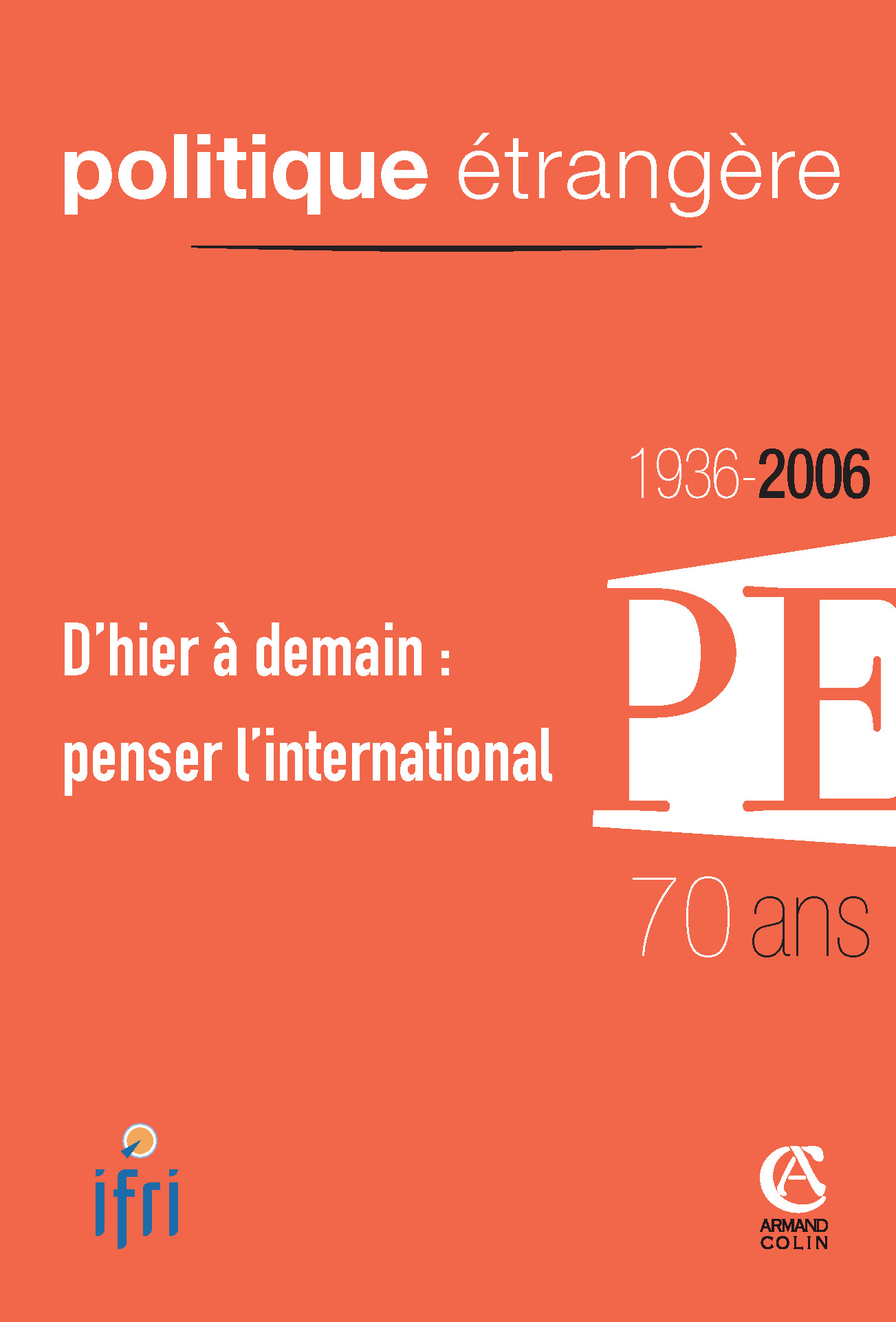
Abdou Diouf a commencé sa carrière politique au Sénégal. Il a été directeur de cabinet de Léopold Sédar Senghor puis Secrétaire général de la Présidence de la République. En 1970, il est nommé Premier ministre. En 1981, il est élu président de la République, fonction qu'il occupe jusqu'en 2000. De 2003 à 2014, il est secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Bon gré mal gré, l’Afrique doit aujourd’hui vivre, comme l’ensemble de notre planète, à l’heure de ce que l’on appelle la mondialisation. Mais, contrairement à d’autres régions du Sud, elle demeure mal outillée pour, à la fois, affronter ses contraintes et profiter de ses opportunités. Une des raisons de cette fragilité réside dans son extrême fragmentation, dans sa « balkanisation » comme on l’a souvent dit. À l’heure où les autres régions du monde s’organisent en espaces intégrés – économiques, géopolitiques ou culturels –, elle semble échapper à cette tendance, même si elle tente désormais de l’infléchir.
L’Afrique se compose d’une cinquantaine d’États, dont une vingtaine comptent moins de 10 millions d’habitants, et près d’une dizaine moins d’un million. Que pèse chacun d’eux face aux grands ensembles qui occupent aujourd’hui la scène mondiale ? D’un côté la Chine et l’Inde, États unifiés les plus peuplés du monde, qui entendent bien en devenir des puissances centrales ; de l’autre, des unions régionales de natures différentes, à la construction plus ou moins rapide et plus ou moins harmonieuse, mais dont l’un au moins des objectifs est de peser sur une scène internationale où prévalent les logiques de la globalisation : l’Union européenne (UE), qui s’est donné pour vocation de regrouper l’ensemble de l’Europe, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Marché commun du Sud (Mercado Comun del Sur, Mercosur) en Amérique du Sud, l’Association des nations du Sud-Est asiatique (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). Du côté africain en revanche, une infinité de sigles qui, jusqu’à présent, ne reflètent pour la plupart que des regroupements virtuels.
L’Afrique peut-elle continuer à regarder, impuissante, l’évolution d’un monde sur lequel elle n’a pas prise ? Peut-elle continuer à se marginaliser alors qu’elle possède tous les outils d’une meilleure insertion dans le monde d’aujourd’hui : ressources naturelles, jeunesse et dynamisme de sa population, richesse de ses cultures, etc. ? [...]
PLAN DE L'ARTICLE
- Entre rêve d’unité et réalités régionales
- La prolifération des organisations régionales
- Logiques d’intégration contre intérêts nationaux
- Le tournant mondial des années 1990 et la marginalisation de l’Afrique
- La marginalisation de l’Afrique
- Des intégrations « par le bas » ?
- Vers une prise de conscience ? Les évolutions actuelles
- Les nouveaux habits du rêve panafricain
- L’Afrique des régions
- Culture, santé, éducation, sécurité et maintien de la paix
- Les obstacles
- Vers des organisations du troisième type ?

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









