Mythologies de l'international
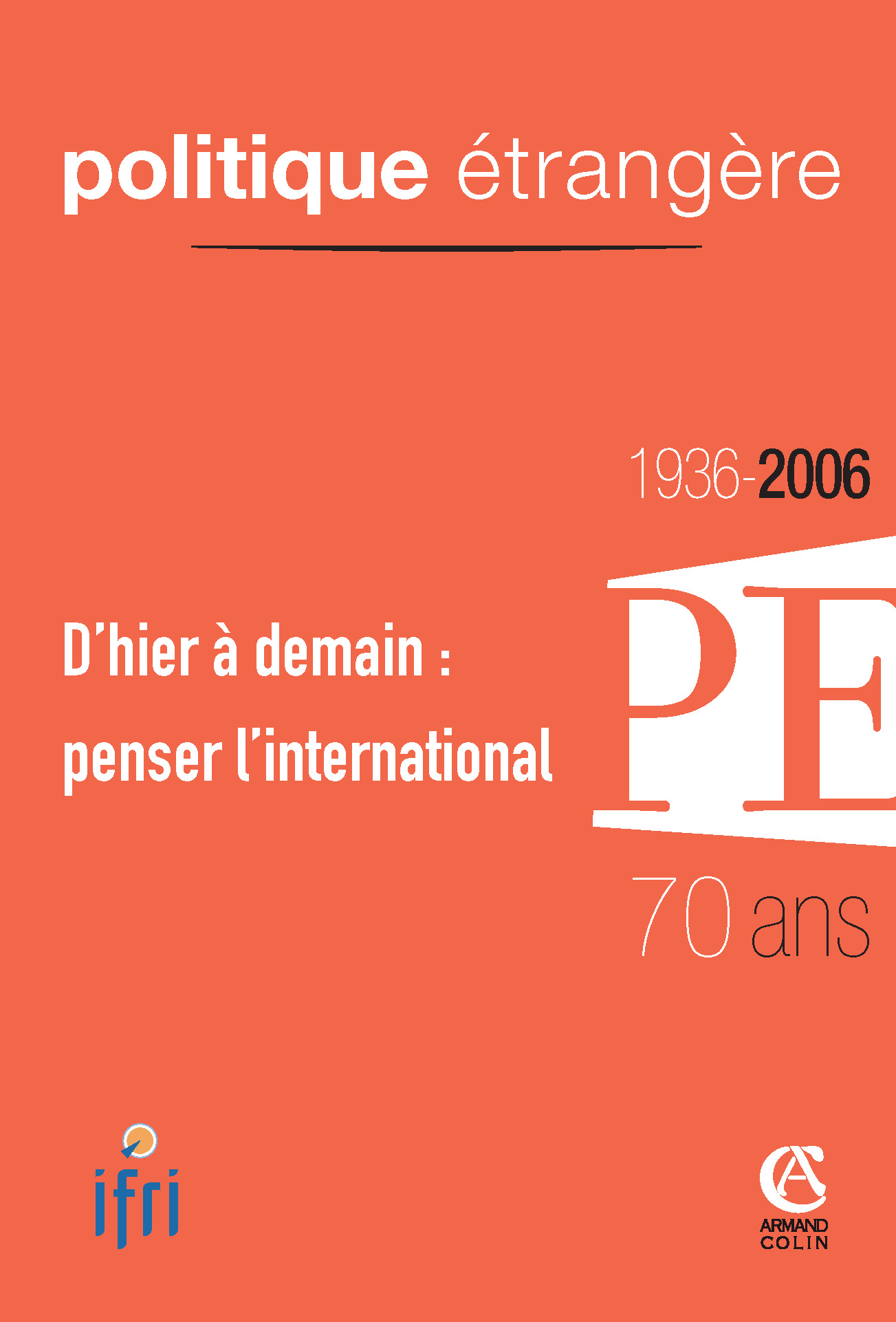
La culture internationale contemporaine est imprégnée de mythes. Trois d’entre eux occupent une place particulière: celui de l’universel, celui de la paix et celui de la suprématie du droit. Les mythes peuvent être bénéfiques à condition de ne pas oublier qu’ils ne sont que des interprétations et non des vérités absolues. C’est précisément cet oubli qui pourrait porter préjudice aux Occidentaux, créateurs et exportateurs des principales mythologies de l’international.

Phénomène si avéré, si vivant, la mondialisation finit par engendrer une culture-monde, un cosmos doté d’une logique interne où émergent des valeurs, des finalités, des comportements qui se répondent les uns aux autres. Il s’agit bien d’un monde global, au-dessus des mondes particuliers, construisant ses propres références – qu’il emprunte certes aux cultures sous-jacentes –, mais qui prennent le visage d’une nouvelle entité.
Un monde culturel entretient toujours ses propres mythes, qui forment à eux tous une histoire cohérente. Il ne faudrait pas ici entendre le mot mythe au sens, fréquent aujourd’hui, d’un mensonge ou d’une fable tout juste bonne à émerveiller les esprits arriérés. Au sens classique, le mythe est une histoire signifiante, une interprétation qui donne sens à un univers dont la vérité objective nous échappe toujours. Il n’y a que le rationalisme pour voir dans le mythe un songe creux. Nous sommes, je crois, vaccinés aujourd’hui contre le rationalisme, et nous savons bien que la raison ne saurait répondre à toutes les questions qui nous hantent. Si nous sommes des êtres rationnels, nous vivons aussi de valeurs, d’idéaux et d’interprétations. Aussi chaque culture s’enracine-t-elle dans une mythologie, une architecture de mythes qui donne un sens à son existence, légitime ses vouloirs et nourrit ses espérances.
Il existe bien une culture internationale en formation, un art de vivre et de penser qui confère une figure au maillage de relations multiples distinguant le monde d’aujourd’hui de celui d’hier (même si jamais les cultures n’ont été fermées sur elles-mêmes au point de s’ignorer réciproquement). Pourtant, cette culture diffère de celles, particulières, qui, partout dans l’histoire, ont émergé autour d’un lieu et à travers des peuples singuliers. Les cultures particulières sont circonscrites chacune dans le temps d’une histoire propre et l’espace d’une géographie visible. Des lois garanties par des souverainetés rassurent leurs valeurs et leurs mythes. Elles sont mouvantes et métamorphiques, mais affirmées, tandis que la culture internationale en gestation surgit d’un ensemble enchevêtré de comportements et d’affirmations qui se croisent et se superposent dans une sorte de désordre créateur. Ici, point d’autorité superlative pour donner le la. Ce sont les pensées les plus puissantes qui s’imposent, mais plutôt par une bonne communication que par la légitimité conférée par une instance. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Progrès et universalisme
- La paix
- Le droit, futur substitut de la politique
Chantal Delsol, professeur de philosophie à l’université de Marne-la-Vallée, est directrice de la collection 'Contretemps' aux éditions de la Table ronde. Auteur de nombreux ouvrages, traduits en une dizaine de langues, son dernier titre de philosophie s’intitule : La Grande Méprise. Justice internationale, gouvernement mondial, guerre juste... (Paris, La Table ronde, 2004).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Mythologies de l'international
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.







