Un programme pour l'OTAN : vers un réseau de sécurité mondiale
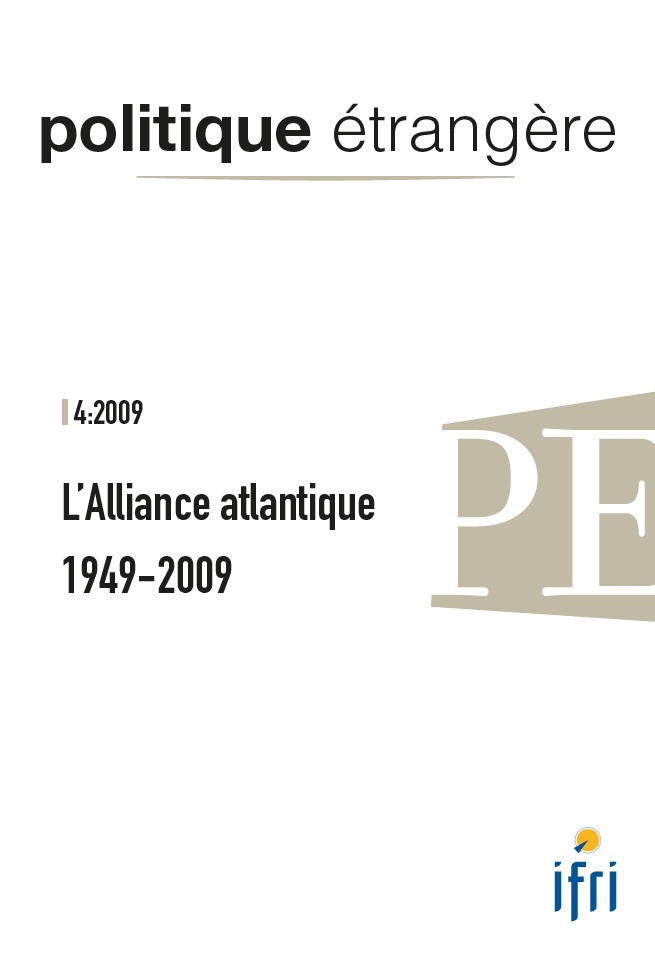
Le succès historique de l’Alliance est d’avoir unifié l’Occident face à la menace soviétique ; puis d’avoir, après la guerre froide, réussi à élargir cet Occident. L’Alliance doit pourtant aujourd’hui s’adapter à un monde nouveau marqué par l’éveil chaotique des peuples. Sa crédibilité dépend de la négociation d’une sortie politique de l’engagement en Afghanistan. À plus long terme, l’OTAN doit se penser comme centre d’un réseau d’organisations de sécurité à l’échelle du monde.

Pour analyser l’évolution du rôle de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), il faut partir du fait qu’en 60 ans d’existence, l’Alliance a présidé à trois transformations internationales fondamentales : la fin de la « guerre civile » en Occident pour la suprématie sur les mers et en Europe ; l’engagement des États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, pour la défense de l’Europe contre la domination soviétique (du fait de soulèvements internes ou d’une éventuelle Troisième Guerre mondiale), enfin la conclusion pacifique de la guerre froide, qui met fin à la division géopolitique de l’Europe, créant ainsi les conditions d’une Union européenne (UE) plus large et plus démocratique.
Ces succès suggèrent une question légitime : et maintenant ? Au vu des futurs les plus vraisemblables, le concept stratégique à venir devra répondre à quatre défis majeurs : comment trouver une sortie politiquement acceptable à l’engagement croissant de l’OTAN dans les conflits mêlés d’Afghanistan et du Pakistan ; comment actualiser le sens et les engagements du concept de « sécurité collective » de l’article 5 du traité de Washington ; comment amener la Russie à une relation qui soit au bénéfice mutuel des partenaires, avec l’Europe, et plus largement, avec la communauté atlantique ; enfin, comment répondre aux nouveaux défis de la sécurité mondiale ?
Unifier l’Occident
Dans les 500 dernières années, la politique mondiale a été dominée par les États riverains de l’Atlantique nord. Tout en se disputant richesses et puissance, ces États ont établi la suprématie mondiale de la région. Mais cette suprématie n’était pas stable. Elle fut périodiquement remise en cause par les violentes rivalités existant entre différents pays : le Portugal, l’Espagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni se sont livrés une concurrence acharnée, endossant tour à tour le rôle de l’empire dominant au-delà des mers.
Ces deux derniers siècles, la hiérarchie mondiale des puissances a radicalement changé. Sous la France napoléonienne, la rivalité, au-delà du contrôle des mers, s’étendit à la domination de l’Europe continentale. Le défi napoléonien transforma encore la géopolitique des rivalités nord-atlantiques, par l’inclusion pour la première fois dans la compétition, de deux puissances non atlantiques, la Prusse d’Europe centrale (qui devait devenir l’Allemagne) et la Russie eurasiatique (plus tard, l’Union des républiques socialistes soviétiques soviétique [URSS]).
PLAN DE L’ARTICLE
- Unifier l’Occident
- Élargir l’Occident
- S’adapter à un monde nouveau
- Maintenir la crédibilité de l’Alliance
- Consolider la sécurité collective
- Intégrer la Russie
- S’ouvrir à l’Asie
- Être au centre du réseau
Zbigniew Brzezinski a été conseiller pour la sécurité nationale aux États-Unis, entre 1977 et 1981. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont le plus récent s’intitule : Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower (New York, Basic Books, 2007)
Texte traduit de l’anglais par Diana Hochraich
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Un programme pour l'OTAN : vers un réseau de sécurité mondiale
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









