Une alliance bien vivante et qui s'adapte
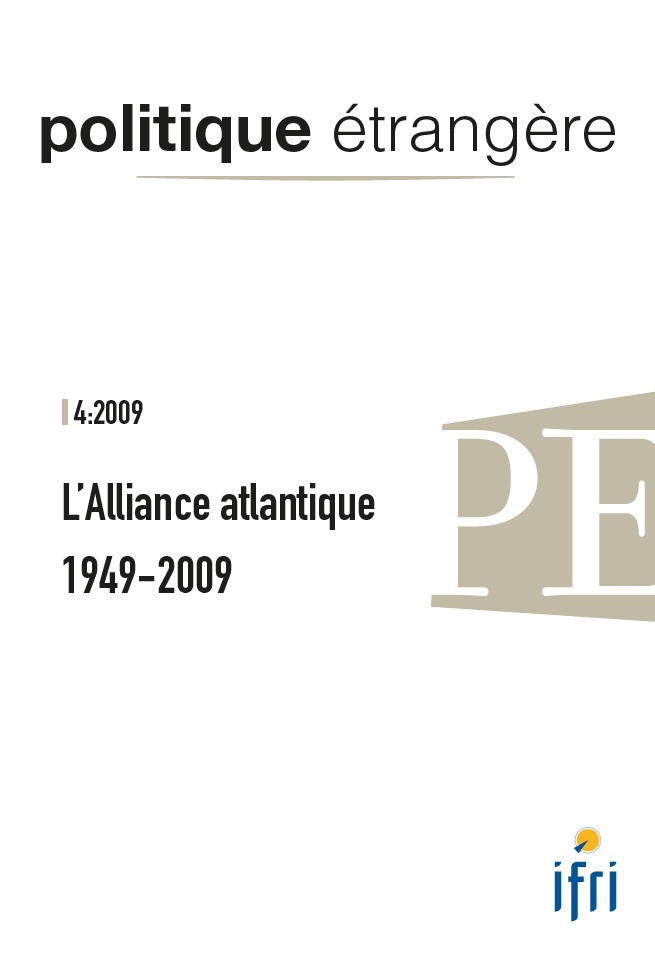
Née d’une volonté de défense contre l’Union soviétique, l’Alliance a été réinventée à la fin de la guerre froide. Elle est engagée partout où les intérêts des Alliés sont menacés, et il n’existe pas aujourd’hui d’autre option de sécurité crédible pour ses membres. Mais l’Alliance doit savoir évoluer, s’adapter à de nouveaux défis, politiques et économiques, et ajuster ses modes de fonctionnement à la multiplication de ses membres.

Une semaine exactement après le 10e anniversaire du lancement de la campagne aérienne du Kosovo, et à la veille du 60e anniversaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), on ne pourrait trouver meilleure occasion pour réfléchir sur le passé, le présent et l’avenir de l’Alliance atlantique.
Il y a dix ans, en 1999, les États membres de l’OTAN ont pris la lourde responsabilité d’attaquer un État souverain sans l’approbation du Conseil de sécurité des Nations unies. L’Alliance de 19 États née pendant la guerre froide, et originellement destinée à contenir la poussée de Staline vers l’Ouest, se voyait confrontée à une effroyable tragédie, au cœur même de l’Europe. Slobodan Milosevic, alors président de la République fédérale de Yougoslavie, avait résolu de chasser hors de la province du Kosovo la majorité albanaise en usant d’une violence crue et perverse : crimes de masse, viols, terreur sur la population.
La communauté internationale, sous le choc, avait plaidé pour une intervention. Tous les efforts diplomatiques entrepris pour arrêter les massacres s’étaient néanmoins révélés vains, et l’OTAN demeurait la seule capable d’empêcher une catastrophe humanitaire de grande ampleur. Ceux d’entre nous qui étaient aux responsabilités à l’époque n’avaient aucun doute sur ce qu’il fallait faire ; mais nul ne savait comment cela allait se passer.
Et cela a fonctionné. Nous avons décrit nos objectifs dans des termes si simples que cela m’a valu une entrée dans l’Oxford Dictionnary of Political Quotations : « Les Serbes dehors, l’OTAN dedans, les réfugiés à la maison ». Il a fallu 78 jours de frappes aériennes et des pressions diplomatiques intenses, mais nous avons mis fin à l’épuration ethnique et interdit sa reprise.
L’Alliance de l’après-guerre froide
C’est ainsi que l’OTAN, quelques années après son engagement en Bosnie en 1995, a de nouveau utilisé sa puissance de feu pour mettre un terme à des violences atroces, et participer à un règlement politique dans les Balkans. L’événement fut déterminant, non seulement pour les dirigeants de l’époque – la génération des protestataires contre la guerre du Vietnam –, mais aussi pour une alliance de défense collective qui avait pu paraître obsolète à la chute du mur de Berlin, quand le vieil ennemi qu’était la puissante Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) avait disparu.[…]
PLAN DE L’ARTICLE
- L’Alliance de l’après-guerre froide
- L’Alliance reste centrale
- Une Alliance transformée
Lord Robertson of Port Ellen a été secrétaire à la Défense du Royaume-Uni (1997-1999) et secrétaire général de l’OTAN (1999-2003). Il est président de l’Atlantic Council of the United Kingdom.
Texte traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Claire Despréaux

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Une alliance bien vivante et qui s'adapte
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








