L'OTAN : de Washington (1949) à Strasbourg-Kehl (2009)
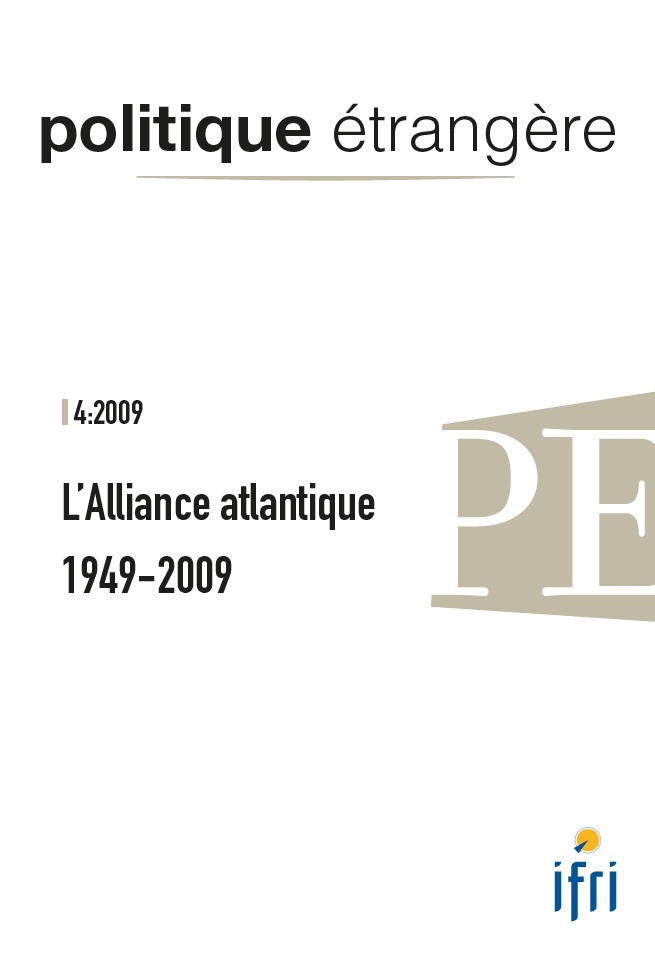
On peut tenter de cerner l’histoire de l’Alliance en en repérant trois phases. La première est constituée par les quatre décennies de la guerre froide. Puis l’Alliance revêt le rôle d’accoucheur du changement politique en Europe. Dans l’après-11 septembre, le débat rebondit sur les défis de sécurité internationale et le rôle de l’Alliance. Il est aujourd’hui encore ouvert sur des questions fondamentales : entre autres la nécessaire redéfinition de ses missions, et des moyens correspondants.

Lorsque les douze membres fondateurs signèrent, le 4 avril 1949, le traité de Washington, nul n’imaginait fonder l’alliance politico-militaire la plus réussie de l’histoire moderne. L’accord portait sur l’institutionnalisation d’une conférence d’États membres, qui devait progressivement devenir une organisation internationale dotée d’une puissante capacité militaire. Aujourd’hui, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) regroupe 28 États membres, et d’autres encore attendent leur admission. Elle conduit des opérations militaires sur trois continents, a institutionnalisé des partenariats avec quelque 20 pays, et noué des relations avec d’importantes démocraties hors Europe : Australie, Nouvelle-Zélande, Japon ou Corée du Sud.
Au vu de cette incroyable évolution, c’est un défi que d’organiser un regard rétrospectif sur les 60 dernières années de l’Alliance. Une solution consisterait à prendre conflits et crises comme principe directeur. En 1949, le traité de Washington est signé alors que Berlin est toujours sous blocus ; mais au même moment, nombre de membres de l’Alliance gardent de sévères réserves vis-à-vis de la nouvelle République fédérale. En 1959, la pression soviétique sur le statut de Berlin perdure. En 1969, les protestations internationales contre la guerre du Vietnam occupent le devant de la scène. L’année précédente, en Tchécoslovaquie, l’OTAN est restée spectatrice de la liquidation des velléités démocratiques par le pacte de Varsovie – ce que certains Européens assimilèrent à une faiblesse. En 1979, les membres de l’Alliance prenaient la Dual Track Decision, ou « double décision », pour répondre à la menace grandissante des missiles soviétiques SS-20 en Europe : ce fut le prélude d’une sévère crise qui conduisit l’OTAN au bord de l’éclatement au début des années 1980.
Même après l’effondrement du pacte de Varsovie et la « victoire » de l’OTAN dans la guerre froide, les conflits semblent demeurer la référence pour l’histoire de l’Alliance. Élargissement de l’OTAN, crise des Balkans, Afghanistan, Irak : autant de mots clés soulignant des affrontements transatlantiques, ou européens, mettant à l’épreuve la cohésion de l’Alliance. [...]
PLAN DE L’ARTICLE
- Les phases de l’OTAN
- Phase 1. Quatre décennies d’affirmation et d’autodéfense
- Phase 2. L’OTAN, accoucheur du changement
- Phase 3. L’OTAN après le 11 septembre
- Les problèmes de la soixantaine
Karl-Heinz Kamp est directeur de recherches au Collège de défense de l’OTAN à Rome. Précédemment, il a longtemps travaillé comme coordinateur des politiques de sécurité à la Konrad Adenauer Stiftung de Berlin, a été détaché auprès du ministère des Affaires étrangères allemand et a enseigné la science politique à l’université de Cologne.
Texte traduit de l’anglais (Allemagne) par Grégory Danel.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'OTAN : de Washington (1949) à Strasbourg-Kehl (2009)
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








