Le « bazooka fiscal » du gouvernement Merz, un tournant économique ?
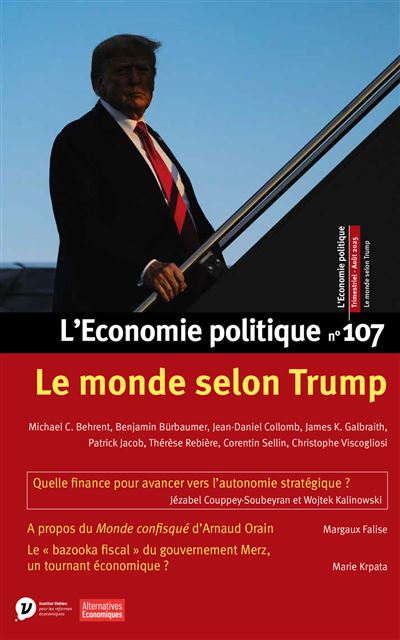
Le Parlement allemand a voté la création d’un fonds spécial pour les infrastructures et un assouplissement du frein à la dette afin d’insuffler un nouveau dynamisme à l’économie allemande et répondre à un environnement sécuritaire dégradé. Cela accroît les marges de manœuvre du gouvernement sur le plan économique, mais des réformes plus durables seront nécessaires.
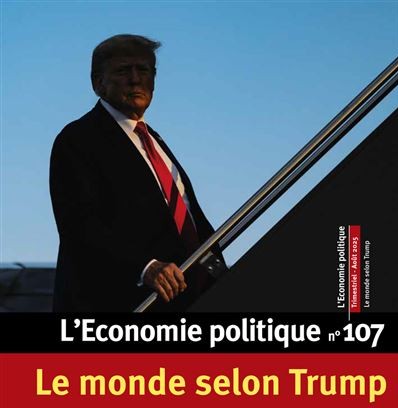
« Bazooka fiscal », « plan Marshall allemand », « harakiri fiscal »... les métaphores fusent pour qualifier la loi passée le 21 mars dernier par les chrétiens-démocrates (CDU) et les sociaux-démocrates (SPD) au Parlement allemand. Cette loi prévoit, d’une part, des investissements publics dans les infrastructures à hauteur de 500 milliards d’euros sur douze ans et, d’autre part, un assouplissement du frein à l’endettement pour les dépenses militaires dépassant 1 % du produit intérieur brut (PIB) allemand. Elle répondrait ainsi à deux attentes cruciales des électeurs allemands.
Premièrement, la vétusté des infrastructures est régulièrement pointée du doigt outre-Rhin. Diverses institutions et instituts économiques alertent ainsi sur le fait que le manque d’investissements publics ces dernières années a fini par nuire à l’attractivité économique du pays.
Deuxièmement, l’assouplissement du frein à la dette permettrait à l’Allemagne de combler son retard militaire et d’atteindre l’objectif de 5 % de son PIB consacré à la défense (dont 3,5 % en « défense pure » et 1,5 % en investissements de défense au sens large, tels que la cybersécurité et la mobilité militaire), comme elle s’est engagée à le faire lors du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) à La Haye les 24 et 25 juin dernier.
En toile de fond de l’attention croissante de l’Allemagne pour l’augmentation de ses capacités militaires se trouve la question de la pérennité du soutien des Etats-Unis à l’Ukraine – et donc de leur contribution à la sécurité européenne. Plus généralement, c’est le durcissement géopolitique au sens large qui inquiète une Allemagne au modèle économique ouvert et fortement dépendante de ses exportations.
Le 24 juin, Lars Klingbeil, le ministre des Finances et vice-chancelier allemand de la nouvelle « grande coalition » (CDU et SPD) menée par Friedrich Merz, a présenté un projet de budget pour 2025 sur lequel avait buté le gouvernement précédent (gouvernement dit « feu tricolore » car rassemblant le SPD, avec Olaf Scholz comme chancelier, les Verts et les Libéraux du FDP), au point que cela avait mené à des élections anticipées en Allemagne. La fermeté accrue des principaux partenaires commerciaux de l’Allemagne ainsi que le retour de la guerre sur le continent européen mettent en évidence la très forte dépendance économique et géopolitique de l’Allemagne, notamment avec les Etats-Unis, la Chine et la Russie, et l’obligent à revoir ses relations avec ces pays.
Le nouveau gouvernement de Friedrich Merz, acculé par le parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (AfD), s’est-il créé les marges de manœuvre fiscales nécessaires pour démontrer que les partis du centre sont capables de proposer des solutions constructives sur le plan économique, en créant les conditions permettant d’insuffler une nouvelle dynamique au pays ? Ou s’agit-il d’un repositionnement en profondeur du modèle économique allemand impulsant un effet d’entraînement plus durable et s’étendant également aux autres Etats membres de l’Union européenne (UE) ?
Des raisons structurelles à l’essoufflement de l’économie allemande…
En août 2023, l’hebdomadaire britannique The Economist titrait « L’Allemagne est-elle à nouveau l’homme malade de l’Europe ? ». En effet, en 2024, l’Allemagne, première économie européenne, vivait une récession pour la deuxième année consécutive, soulevant des questions quant aux raisons de cette performance modeste qui sont aussi structurelles que conjoncturelles. L’activité relative aux investissements en Allemagne faiblit depuis la fin de la première décennie des années 2000 6 et, en novembre 2024, la production industrielle avait décru de 12 % par rapport à 2018 7. Cette baisse suscite la crainte d’une désindustrialisation, sachant qu’en 2024 l’industrie contribuait à hauteur de 23 % au PIB allemand 8.
[...]
Lire l'article publié dans "L'Economie politique", n° 107, août 2025 intitulé - « Le Monde selon Trump » (pg 107 à 112).

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
DOI
Alternatives Économiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa fabrique de la politique européenne de l’Allemagne
L’ambition européenne de Friedrich Merz est de faire de l’Allemagne, souvent perçue comme hésitante, un acteur de premier plan de l’Union européenne. À cette fin, le chancelier allemand a annoncé vouloir mettre un terme au « German vote ». Celui-ci incarne le paradoxe d’une Allemagne à la fois indispensable et fréquemment absente dans la décision européenne.

Sécuriser les chaînes de valeur des matières premières critiques (MPC) : une condition préalable à la résilience technologique de l'Europe
Au cœur de la sécurité économique, la résilience technologique est un pilier de la compétitivité de l'Union européenne (UE). Les transitions énergétique et numérique de l'UE dépendent des matières premières critiques (MPC).

Concilier compétitivité et évolution démographique : un impératif franco-allemand
La France et l'Allemagne sont confrontées à des changements démographiques parallèles qui pourraient remodeler l'avenir de leurs économies et de leurs modèles sociaux. Ces changements reflètent des tendances européennes plus larges, mais sont amplifiés par le rôle central que jouent ces deux nations dans la gouvernance et la compétitivité de l'Union européenne.
Imaginaires et réalités de la frontière franco-allemande : un laboratoire pour l’Europe de demain
En Europe, la question des frontières est loin d’être secondaire. Selon le Parlement européen, les régions frontalières couvrent environ 40 % du territoire de l’Union européenne (UE), concentrent 30 % de sa population et produisent près d’un tiers de son produit intérieur brut.











