Offensive et contre-offensive sur l’intelligence artificielle
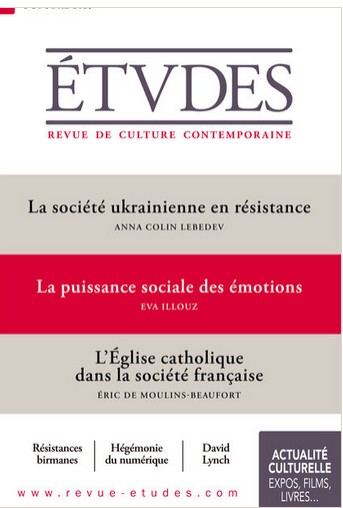
« Celui qui maîtrise l’intelligence artificielle [IA] maîtrisera le monde », prédisait Vladimir Poutine en 2017. « Une bulle comparable à celle de l’Internet pourrait éclater », annonçait Sam Altman, le cofondateur d’OpenAI, cet été. Au cours des sept dernières années, la propagation de l’IA générative s’est accélérée de manière spectaculaire. Des robots conversationnels comme ChatGPT sont entrés dans nos vies.

En janvier 2025, c’est DeepSeek, une start-up chinoise, qui affiche des performances remarquables. Librement accessible, le modèle traduit le positionnement stratégique de la Chine dans l’IA ouverte. Dans ce secteur comme dans d’autres, elle n’est plus du tout dans une dynamique de rattrapage technologique mais, au contraire, de percée.
Les États-Unis et la Chine mettent en scène leur rivalité. Les deux pays, ou plutôt les deux systèmes, partagent une stratégie moins motivée par l’intérêt général que par le gain économique et le contrôle politique. Face à ce duopole, l’Europe doit trouver sa place car elle dispose de véritables capacités, ce qui n’a pas échappé à Donald Trump.
En juillet 2025, il présente un plan qui vise à assurer la « domination mondiale » des États-Unis en ce qui concerne l’IA. Selon lui, il faut rebaptiser le nom de ce secteur « parce que ce n’est pas artificiel, c’est du génie, du pur génie ». À l’instar de Poutine, il estime que « celui qui disposera du plus vaste écosystème d’IA fixera les normes mondiales en la matière et en retirera d’importants avantages économiques et militaires ». Suivant les préceptes des patrons de la Tech, le président des États-Unis écarte les rares garde-fous que son prédécesseur avait essayé de mettre en place.
David Sacks joue un rôle clé dans le positionnement de l’administration américaine. Né en 1972, il se fait un nom chez PayPal avant de devenir un des investisseurs les plus renommés de la Silicon Valley. En 1995, il publie un livre avec Peter Thiel intitulé The Diversity Myth, qui dénonce le « politiquement correct » et les politiques progressistes dans l’enseignement supérieur. Il prend position contre le soutien militaire à l’Ukraine et apporte son soutien à Trump, qui le nomme « tsar » en charge de l’IA et des cryptomonnaies, poste nouvellement créé pour construire un nouveau cadre juridique à ces activités.
Le plan exige que les modèles d’IA soient « neutres politiquement et sans biais », c’est-à-dire conçus « pour rechercher la vérité objective ». Autrement dit, les administrations fédérales ne pourront acheter des solutions jugées politiquement « woke ». L’IA est à la fois le cadre et l’enjeu de la « guerre culturelle » en cours entre l’administration Trump et le monde académique. Le plan vise également à faciliter la construction par les entreprises de data centers et à renforcer les infrastructures énergétiques qui les alimentent. Enfin, le plan opère un revirement de position majeur concernant les semi-conducteurs. L’administration Biden, on s’en souvient, avait instauré de fortes restrictions à l’exportation pour les puces électroniques les plus sophistiquées afin de freiner l’avancée technologique de la Chine. Ce dossier porte une forte charge géopolitique en raison du poids de Taïwan dans cette industrie.
Jensen Huang, le PDG de Nvidia, l’entreprise américaine emblématique de puces électroniques, multiplie les allers-retours en Chine depuis janvier 2025. Il compare volontiers la puce technologique américaine au dollar, en indiquant qu’elle doit avoir valeur de norme mondiale. C’est dans cet esprit que le plan prévoit de restreindre les contraintes à l’exportation devant les marchés pris par les acteurs chinois dans les pays du Golfe et d’Asie du Sud-Est. Sacks résume ainsi l’alternative : « Ces nations n’ont que deux options : utiliser la technologie américaine ou la technologie chinoise. Les priver de technologie américaine, c’est les pousser dans les bras de la Chine. »
En fin de compte, ce plan s’inscrit dans une manœuvre d’ensemble, celle de la réorganisation du commerce international. La Chine et les États-Unis continuent à négocier alors que ces derniers ont déjà infligé des droits de douane à l’Inde ou à l’Union européenne. Celle-ci pensait être quitte. Or, Donald Trump poursuit son offensive en exigeant le démantèlement de la régulation numérique européenne et en exportant les solutions américaines d’IA. Ce n’est évidemment pas seulement une ambition commerciale.
> Lire la chronique sur le site de la revue Études.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
En savoir plus
Découvrir toutes nos analyses
Qui contrôle qui ? Les nouveaux rapports de force mondiaux
Dans ce nouvel essai percutant, Thomas Gomart s’interroge sur les antagonismes profonds qui bouleversent notre époque. Croisant géopolitique, géoéconomie et idéologie, il analyse six duels représentatifs des nouveaux rapports de force.
Les Européens face à la « question russe »
Fin octobre 2025, le Kremlin a annoncé les tests du Bourevestnik, missile à propulsion nucléaire, et du Poséidon, torpille lourde autonome thermonucléaire. Comme à chaque fois, ils ont fait l’objet d’une intense couverture médiatique dans les pays occidentaux. De manière plus inattendue, Donald Trump a répondu en ordonnant la reprise des essais américains.
Europe-Russie : évaluation des rapports de force
Les pays européens ne peuvent plus éluder la « question russe » car la Russie a choisi la guerre. Ils disposent du potentiel nécessaire, c’est-à-dire des moyens économiques, des compétences militaires et du savoir-faire technologique pour faire face à la Russie d’ici 2030 à condition de faire preuve de volonté politique.
La fabrique du risque : les entreprises face à la doxa géopolitique
La déformation du triangle stratégique États-Unis – Chine – Russie crée de nouvelles dynamiques auxquelles les entreprises ne peuvent se soustraire. Elles sont confrontées au risque géopolitique, sans forcément s’y être préparées. Leurs dirigeants ne peuvent plus l’ignorer.











