Un an de présidence Prabowo : entre populisme économique et reflux démocratique
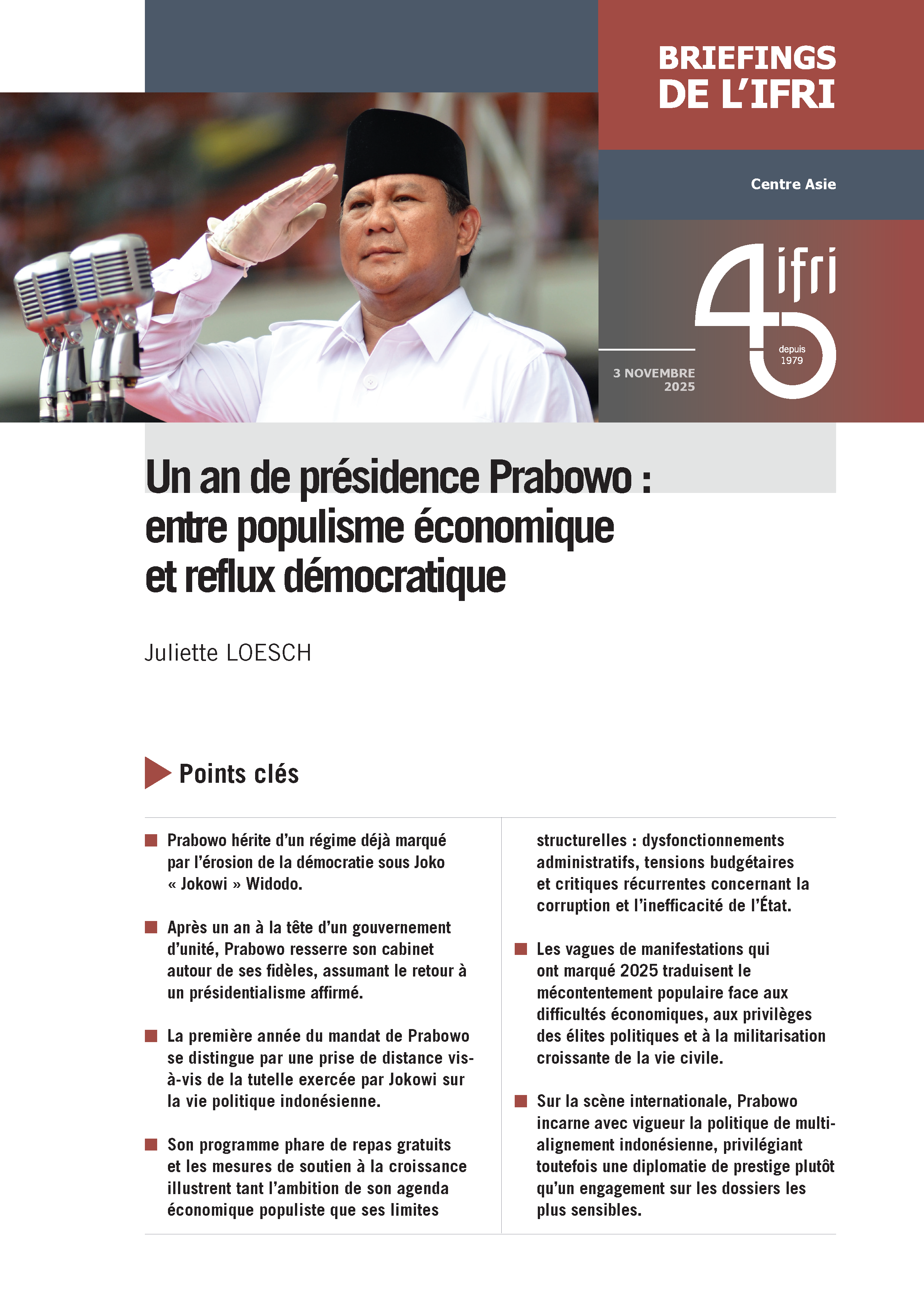
Élu à presque 60 % des suffrages en février 2024, Prabowo Subianto est officiellement devenu le huitième président de la République indonésienne le 20 octobre 2024. Adoubé par son prédécesseur et ancien rival, Joko « Jokowi » Widodo, porté par une immense popularité, en particulier auprès de la jeunesse, le nouveau chef de l’État n’a pas tardé à mettre en œuvre son programme pour une « Indonésie qui avance » (Indonesia Maju).

L’accession au pouvoir de cet ex-général au passé controversé, figure de l’ancien régime autoritaire de l’Ordre nouveau (1965-1998) et populiste aguerri, fait néanmoins craindre la fin de l’ère démocratique ouverte après la chute de Suharto en mai 1998.
La démocratie indonésienne connaît déjà une phase de régression amorcée sous Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) et accentuée durant l’ère Jokowi (2014-2024). Celle-ci se manifeste par le recours à la cooptation et la coercition à l’encontre des partis politiques et de la presse ; la répression des oppositions civiles et islamiques ; la centralisation géographique du pouvoir, à rebours des lois de décentralisation de 1999 et 2004 ; ainsi que par l’affaiblissement des instances de contrôle telles que la Commission de lutte contre la corruption (KPK) et la Cour constitutionnelle. Prabowo hérite ainsi d’un régime demeurant certes démocratique, mais dont la branche exécutive apparaît de moins en moins contrainte par l’équilibre des pouvoirs mis en place après la transition de 1998. Les premiers mois du nouveau président semblent s’inscrire dans la continuité de cette tendance en dessinant les contours d’une concentration du pouvoir dans les cercles proches de Prabowo.
Titre
Points clés
Prabowo hérite d’un régime déjà marqué par l’érosion de la démocratie sous Joko « Jokowi » Widodo.
Après un an à la tête d’un gouvernement d’unité, Prabowo resserre son cabinet autour de ses fidèles, assumant le retour à un présidentialisme affirmé.
La première année du mandat de Prabowo se distingue par une prise de distance vis- à-vis de la tutelle exercée par Jokowi sur la vie politique indonésienne.
Son programme phare de repas gratuits et les mesures de soutien à la croissance illustrent tant l’ambition de son agenda économique populiste que ses limites structurelles : dysfonctionnements administratifs, tensions budgétaires et critiques récurrentes concernant la corruption et l’inefficacité de l’État.
Les vagues de manifestations qui ont marqué 2025 traduisent le mécontentement populaire face aux difficultés économiques, aux privilèges des élites politiques et à la militarisation croissante de la vie civile.
Sur la scène internationale, Prabowo incarne avec vigueur la politique de multi-
alignement indonésienne, privilégiant toutefois une diplomatie de prestige plutôt qu’un engagement sur les dossiers les plus sensibles.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Un an de présidence Prabowo : entre populisme économique et reflux démocratique
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa politique américaine envers Taïwan, au delà de Donald Trump : cartographie des acteurs américains des relations entre les États-Unis et Taïwan
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a ravivé une incertitude profonde quant à l’engagement des États-Unis en matière de sécurité envers Taïwan. Contrairement au président Joe Biden, qui a maintes fois réaffirmé sa détermination à défendre l’île, Donald Trump évite soigneusement de se prononcer sur une éventuelle réaction américaine en cas de crise dans le détroit de Taïwan.
Japon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.














