Génération Gezi ?
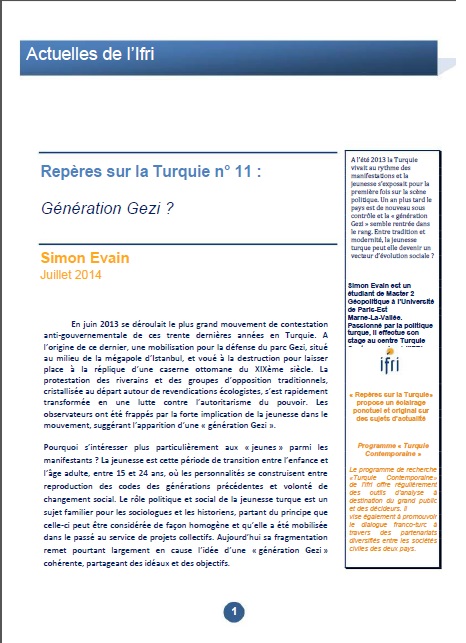
A l’été 2013 la Turquie vivait au rythme des manifestations et la jeunesse s’exposait pour la première fois sur la scène politique. Un an plus tard le pays est de nouveau sous contrôle et la « génération Gezi » semble rentrée dans le rang. Entre tradition et modernité, la jeunesse turque peut-elle devenir un vecteur d’évolution sociale ?
En juin 2013 se déroulait le plus grand mouvement de contestation anti-gouvernementale de ces trente dernières années en Turquie. A l’origine de ce dernier, une mobilisation pour la défense du parc Gezi, situé au milieu de la mégapole d’Istanbul, et voué à la destruction pour laisser place à la réplique d’une caserne ottomane du XIXème siècle. La protestation des riverains et des groupes d’opposition traditionnels, cristallisée au départ autour de revendications écologistes, s’est rapidement transformée en une lutte contre l’autoritarisme du pouvoir. Les observateurs ont été frappés par la forte implication de la jeunesse dans le mouvement, suggérant l’apparition d’une « génération Gezi »
Pourquoi s’intéresser plus particulièrement aux « jeunes » parmi les manifestants ? La jeunesse est cette période de transition entre l’enfance et l’âge adulte, entre 15 et 24 ans, où les personnalités se construisent entre reproduction des codes des générations précédentes et volonté de changement social. Le rôle politique et social de la jeunesse turque est un sujet familier pour les sociologues et les historiens, partant du principe que celle-ci peut être considérée de façon homogène et qu’elle a été mobilisée dans le passé au service de projets collectifs. Aujourd’hui sa fragmentation remet pourtant largement en cause l’idée d’une « génération Gezi » cohérente, partageant des idéaux et des objectifs.
Télécharger l’éditorial pour le lire dans sa totalité :
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Génération Gezi ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa Russie, les Palestiniens et Gaza : ajustements après le 7 octobre
L'Union soviétique (URSS), puis la Fédération de Russie en tant que successeur légal internationalement reconnu, ont toujours cherché à jouer un rôle visible dans les efforts visant à résoudre le conflit israélo-palestinien.
Le Canada et la reconnaissance de l'État palestinien
Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
La République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.













