Les contradictions de la politique kurde d'Ankara : leçons tirées des grèves de la faim de 2012
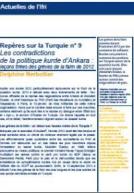
Les grèves de la faim menées durant l'automne 2012 par des centaines de militants kurdes ont polarisé à outrance les positions en Turquie autour de la question kurde. Mais elles ont aussi réussi à imposer auprès d'Ankara le leader du PKK Abdullah Öcalan, devenu depuis un acteur central dans la relance des négociations de paix.
Après une année 2012 particulièrement éprouvante sur le front de la question kurde, 2013 a débuté avec deux événements de taille : l’annonce officielle de la reprise des négociations entre Ankara et Abdullah Öcalan, le chef historique du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et l’assassinat, à Paris, le 10 janvier, de trois militantes de cette même organisation. Alors que la lumière reste encore à faire sur ces meurtres, certains estiment qu’ils sont liés à la reprise du dialogue entre l’État turc et « Apo », le surnom d’Öcalan en Turquie. Ce drame rappelle en tout cas, s’il le fallait, l’extrême tension régnant autour du dossier kurde.
Les grèves de la faim : un retour aux heures noires de la Turquie ?
Marquée par le scandale d’Uludere, l’année 2012 avait été très tendue et s’est achevée dans un climat de violence rarement égalé par le passé. Les affrontements quasi quotidiens entre les combattants du PKK et l’armée ont débouché sur un des bilans les plus meurtriers depuis l’arrestation du leader kurde, Abdullah Öcalan, en 1999. Même paroxysme au niveau politique, le premier ministre Recep Tayyip Erdoğan multipliant les salves contre le parti pro kurde du BDP (Barış ve Demokrasi Partisi, Parti pour la paix et la démocratie) tandis que les arrestations de sympathisants kurdes mis en cause dans le cadre de l’affaire dite du KCK se poursuivaient. Enfin, le 12 septembre 2012 a débuté l’une des grèves de la faim les plus longues et les plus suivies de ces quinze dernières années en Turquie.
Une soixantaine de prisonniers kurdes ont mené cette action durant 68 jours et 600 autres personnes ont rejoint le mouvement en cours de route, mettant fin à leur action le 17 novembre, à l’appel d’Abdullah Öcalan. Le choix d’un tel mode d’action collectif a replongé le pays dans les décennies noires de 1980 et 1990 lorsque les grèves de la faim étaient devenues le principal moyen de revendication des détenus kurdes et militants d’extrême gauche dénonçant leurs conditions de détention et la pratique de la torture. Le retour des grèves de la faim a aussi focalisé l’attention sur la manière dont les autorités turques allaient gérer la crise, les précédents mouvements de ce genre s’étant soldés par de véritables fiascos.
Les grèves de la faim de 2012 sont la conséquence directe de la stagnation politique de la question kurde depuis 2009, les demandes des grévistes étant toutes liées à des dossiers bloqués depuis cette date. C’est le cas du droit à la défense en langue maternelle : depuis 2009, la plupart des audiences liées à l’affaire KCK ont été repoussées face au refus des juges d’entendre les prévenus se défendre en employant la langue kurde. Le dossier s’est enfin dénoué au Parlement courant janvier 2013. Même problème autour du droit à l’enseignement en kurde, débattu sans résultat par la commission parlementaire chargée de rédiger une nouvelle constitution. Quant aux conditions de détention d’Abdullah Öcalan, fondateur du PKK emprisonné à vie sur l’île d’İmralı, elles se sont dégradées depuis l’échec en mai 2011 des négociations de paix menées en secret, en Norvège, entre l’État turc et le PKK. Apo ne reçoit plus la visite de ses avocats, accusés de relayer sa propagande, et dont la plupart ont été incarcérés.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les contradictions de la politique kurde d'Ankara : leçons tirées des grèves de la faim de 2012
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa Russie, les Palestiniens et Gaza : ajustements après le 7 octobre
L'Union soviétique (URSS), puis la Fédération de Russie en tant que successeur légal internationalement reconnu, ont toujours cherché à jouer un rôle visible dans les efforts visant à résoudre le conflit israélo-palestinien.
Le Canada et la reconnaissance de l'État palestinien
Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
La République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.













