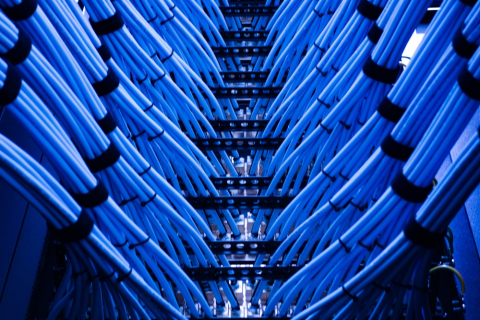Soldats français morts au Mali : les enjeux de Barkhane
Cinq soldats français sont morts au Mali, en une semaine, au cours de l’opération Barkhane. Elie Tenenbaum, expert en relations internationales (Ifri), en explique les enjeux.

La double attaque contre la force française Barkhane au Mali envoie un signal d’intransigeance des groupes jihadistes à l’heure de possibles négociations avec certains d’entre eux, estime le chercheur Elie Tenenbaum, spécialiste des questions de défense à l’Institut français de Relations internationales (Ifri). Trois soldats français ont été tués, lundi, dans le centre du Mali, dans une attaque à l’engin explosif artisanal, revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, et deux autres l’ont été, samedi, dans des circonstances similaires.
Quel message ces deux attaques envoient-elles, alors que la France se dit ouverte à des négociations avec certaines composantes du GSIM, mais pas avec sa direction, dont Iyad Ag Ghali, trop lié, selon elle, à la hiérarchie centrale d’Al-Qaïda ?
Au regard du contexte général, il semble que cibler spécifiquement Barkhane, pour le GSIM, est une façon de réaffirmer la condition, énoncée par Iyad Ag Ghaly, en mars, du retrait des forces internationales, Minusma (Onu) et Barkhane, comme préalable à toute négociation avec le gouvernement de Bamako.
En outre, l’attaque, samedi, à Ménaka (centre) est intervenue près d’un site qui doit accueillir les forces tchèques, dans le cadre de la mission européenne (de forces spéciales) Takouba. Depuis un an, celle-ci est devenue la vitrine, mise en avant, systématiquement, par la France. Après avoir vendu, pendant trois ans, la force conjointe du G5 Sahel, qui a peiné à démontrer ses résultats, le narratif dominant est désormais celui de l’européanisation. Barkhane s’est aussi davantage retournée contre le GSIM ces derniers temps, après avoir désigné l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) comme sa cible principale. Il y a donc eu un rééquilibrage, à l’automne, de la part des forces françaises qui ont davantage ciblé le GSIM, ce qui peut aussi expliquer ce genre de réactions.
Quelle est la position des différents acteurs concernant de possibles négociations ?
Côté français, Paris était, initialement, assez réticent sur les négociations. Il a un peu assoupli son discours lorsqu’il a compris qu’il fallait monter à bord du train. La pression de l’Élysée pour une réduction des effectifs déployés va aussi dans ce sens. La question centrale est de savoir avec qui négocier, où passe la ligne rouge, qui est sur une liste de non-réconciliables pour Paris et Bamako. Des personnalités comme Iyad Ag Ghaly ou Amadou Koufa, chef de la katiba Macina dans le centre du Mali, bien que sous sanctions internationales, peuvent-ils être considérés comme des interlocuteurs acceptables ? Ce n’était, pour l’instant, clairement pas le cas vu de Paris, alors que les gouvernements successifs à Bamako semblaient nettement plus ouverts.
S’achemine-t-on vers un processus de négociations comparable à celui engagé en Afghanistan, qui s’est conclu par un accord entre États-Unis et talibans en février 2020 à Doha ?
Le retrait des forces américaines a été la condition des talibans pendant des années. C’est ce qui a défini les contours de l’accord de Doha. C’est clairement le modèle que le GSIM a aujourd’hui en tête. Pour qu’un tel accord se réalise il faudra, toutefois, voir quelles contreparties le GSIM est prêt à donner, notamment en termes de distanciation vis-à-vis d’Al-Qaïda. Les talibans ont promis de renoncer à leurs liens avec les groupes terroristes internationaux - qu’on les croie ou non. Par ailleurs, à la différence des négociations de Doha où les Américains avaient conduit les négociations, la France n’est pas du tout à la tête du processus, lancé à l’initiative du gouvernement malien depuis un an.
> Lire l'interview dans son intégralité sur le site du Télégramme.

Média
Partager