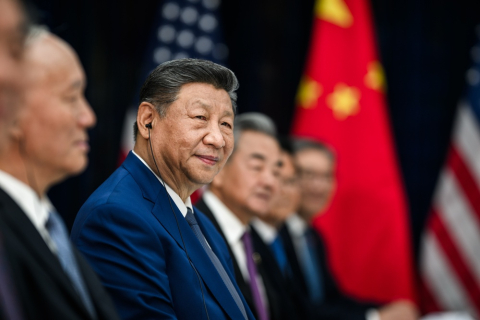La stratégie guerrière de Benyamin Nétanyahou à l’épreuve du temps
Depuis le 7 octobre, le premier ministre israélien a réaffirmé son pays comme la puissance militaire dominante de la région. Y compris au mépris du droit international. Alors que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre lui, sa politique peut-elle encore perdurer ? Au lendemain des massacres du 7 octobre, l’une des pires défaillances sécuritaires d’Israël depuis la guerre de Kippour en 1973, son gouvernement s’est lancé dans une démonstration de force multiforme, visant à prouver sa suprématie militaire dans tous les domaines.

Le pays a démontré ses capacités aériennes, en adoptant une stratégie de «choc et effroi» à travers des campagnes de bombardements intensives à Gaza, où près de 70% du bâti est aujourd’hui détruit. Ces frappes, conduites à un rythme intensif, inconnu dans les opérations militaires modernes, ont été rendues possibles grâce aux algorithmes avancés Lavender, Habsora et Where’s Daddy –une première utilisation massive de l’intelligence artificielle dans un conflit.
De même, Israël a démontré sa capacité de projection militaire en frappant des cibles stratégiques à plus de 1700kilomètres, comme le port de Hodeïda, au Yémen, contre les Houthis, en juillet 2024, ou en Iran, en détruisant les batteries antiaériennes S300, laissant le territoire iranien vulnérable à toute incursion aérienne et mettant donc à découvert son programme nucléaire. À terre, les forces terrestres, appuyées par les chars Merkava, ont été déployées au sud pour reprendre le contrôle de Gaza, et au nord pour neutraliser les caches d’armes ainsi que les infrastructures stratégiques du Hezbollah.
Enfin, le renseignement : un facteur clé dans un État qui, du fait de son manque de profondeur stratégique, avait sérieusement été mis à mal par l’incapacité de prévenir l’attaque du Hamas. Les coups d’éclat des explosions des bipeurs et des talkies-walkies, de même que le ciblage d’Hassan Nasrallah à Beyrouth, illustrent le retour en force de ces capacités.
La résilience israélienne mise à l’épreuve
Malgré ces succès tactiques, des doutes subsistent quant à la capacité d’Israël à soutenir cet effort militaire sur le long terme, notamment si ses opérations militaires se transforment en une guerre d’attrition («d’usure»). C’est cette considération qui avait conduit au retrait israélien de Gaza sous Ariel Sharon en 2005. Les pertes militaires s’élèvent à 376 soldat·es et 5 404 blessé·es. L’armée israélienne rencontre également des difficultés à régénérer ses forces, d’où le débat sur la conscription des ultraorthodoxes, exempts de service militaire depuis 1948. Alors qu’ils étaient seulement 400 étudiants à l’époque, ils sont aujourd’hui 66000, ce qui crée une réserve de recrues dont l’armée pourrait avoir besoin, dans un contexte où, après un an de guerre, de nombreux réservistes hésitent à répondre à l’appel, obligeant Israël à maquiller les chiffres en proposant des formes de service partiel pour maintenir l’illusion d’une mobilisation continue.
69 200 habitants ont quitté Israël pendant les six premiers mois de 2024
À ces défis militaires s’ajoute la question de la résilience économique de l’État après plus d’un an de guerre. Fin septembre, l’agence de notation Moody’s a abaissé la note d’Israël, pour la deuxième fois en 2024, de A2 à Baa1, et l’a assortie d’une perspective négative, signalant ainsi qu’elle envisageait de l’abaisser de nouveau à court terme. La guerre pèse sur les exportations et les investissements, entraînant une inflation. En outre, les perturbations liées au conflit pèsent sur la vie quotidienne du pays: lors des alertes, les commerces ferment, les cours dans les écoles sont fréquemment interrompus. Cependant, Israël a pour lui un atout de taille: une croissance démographique impressionnante. Le Bureau central des statistiques a récemment annoncé que le pays compte désormais 10 millions d’habitant·es. Ce chiffre contraste fortement avec la tendance au vieillissement démographique observée dans d’autres régions, notamment en Europe.
Cet optimisme démographique est toutefois tempéré par la vague de départs, les yeridot (descente, en opposition à l’alya, immigration juive en Israël). Depuis 2021, les départs d’Israéliens augmentent fortement, passant de 38 000 en 2022 à 55 300 en 2023, puis à 69 200 sur le seul premier semestre 2024. Parallèlement, les nouvelles arrivées chutent de 42 % en 2024, selon l’Agence juive.
Les deux piliers de la «stratégie Nétanyahou»
En dépit de ces difficultés profondes, la conjoncture politique nationale et internationale rend incertaine un changement de stratégie de la part du gouvernement. Conforté par l’élection de Donald Trump aux États-Unis, Benyamin Nétanyahou continue sa politique, qui peut se résumer en deux piliers: la lutte contre l’Iran et l’annexion des terres palestiniennes. Sur le premier point, la victoire du candidat républicain est pour le chef du Likoud une excellente nouvelle. Cette guerre a montré la forte dépendance d’Israël à l’aide américaine, qui s’élève à 23 milliards de dollars en 2024, soit un dixième du total de l’aide accordée depuis la création de l’État. Alors qu’Israël craignait un possible embargo sur les armes en cas de victoire démocrate, le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier permettra de traiter le problème principal de Nétanyahou: la possibilité d’un Iran nucléaire.
Dans cette perspective, deux options se dessinent: une opération conjointe américano-israélienne pour neutraliser le programme nucléaire iranien, disséminé et enterré dans l’immensité du territoire iranien, ou, dans le cas où Israël n’aurait pas le soutien explicite des États-Unis, des frappes ciblées visant à déstabiliser le régime de Téhéran et à retarder son programme nucléaire. Certains faucons à Washington partagent avec la droite israélienne l’espoir d’un changement de régime, alors que l’Iran donne des signes d’un changement de stratégie vers plus d’ouverture vis-à-vis de l’Occident. Les récentes confrontations militaires avec Israël, ainsi que les évolutions régionales, ont montré les limites de la stratégie iranienne de «cercle de feu» («ring of fire») reposant sur ses alliés non étatiques (Hamas, Hezbollah, Houthis, milices irakiennes, positions en Syrie). Et souligné la nécessité pour Téhéran de réévaluer sa stratégie sécuritaire, avec des ajustements possibles concernant sa doctrine nucléaire, alors même que se pose la question de la succession du guide suprême Khamenei.
Cependant, l’ambition de Nétanyahou de se débarrasser coûte que coûte du programme nucléaire iranien est mise à l’épreuve du temps, et principalement au regard de l’évolution des paramètres de la stratégie globale des États-Unis. Sous Trump, une priorité pourrait être donnée à la résolution de la crise ukrainienne, promesse phare de sa campagne, reléguant le Moyen-Orient au second plan.
L’annexion des terres palestiniennes
Concernant le deuxième pilier de la stratégie de Nétanyahou, l’annexion des terres palestiniennes et la réalisation, à terme, d’un « grand Israël », la victoire de Trump est également un bon signe. Mike Huckabee, ancien gouverneur de l’Arkansas et nouvel ambassadeur américain auprès d’Israël, défend ouvertement l’annexion de la Cisjordanie, qu’il nomme «Judée Samarie». À ce titre, les Palestinien·nes de Cisjordanie sont eux aussi dans une situation critique. Depuis le 7 octobre, ils font face aux violences renouvelées des colons qui agissent en toute impunité, et ce alors que la répression militaire s’est intensifiée: le nombre de détenus palestiniens est passé de 5500 avant le 7 octobre à 10 000 aujourd’hui.
À Gaza, «le jour d’après» ressemble de plus en plus à une occupation militaire de l’enclave, supposant un vaste triage de la population palestinienne. Des responsables politiques israéliens demandent ouvertement l’expulsion des Palestiniens vers l’Égypte, une ligne rouge pour Abdel Fattah al-Sissi –ou vers l’Europe, via Chypre.
À ces funestes projets s’ajoute l’épineuse question de la reconstruction de l’enclave. Alors que la France a récemment levé des fonds pour le Liban, aucune initiative comparable n’existe à ce jour pour Gaza.
Israël a besoin des pays du Golfe et des États-Unis
Cette stratégie de l’annexion et de la destruction du programme nucléaire iranien nécessite deux soutiens principaux. D’abord, celui des puissances du Golfe, qui sont la clé de la vision du Moyen-Orient développée par Nétanyahou, entre États «bénis» et États «maudits». Les accords d’Abraham sont son grand œuvre avec Donald Trump, et une manière de contourner la question palestinienne. Survivront-ils à une annexion de Gaza et de la Cisjordanie, ainsi qu’à des frappes contre l’Iran?
Pour l’heure, les puissances du Golfe ont été très timides sur le sujet, à l’exception du Qatar, historiquement allié du Hamas. L’Arabie saoudite, quant à elle, demeure un acteur-clé très attendu. Pour l’heure, le Royaume n’a pas pris de position décisive et reste concentré sur sa Vision 2030, son ambitieux programme de transformation économique.
Dans les milieux économiques, une volonté de développer des échanges commerciaux avec Israël dans une perspective de normalisation existe. Toutefois, cette ambition rencontre des réticences au sein des milieux politiques et diplomatiques saoudiens. Un facteur complexe s’ajoute à ce tableau: l’investissement de près de 2milliards de dollars de Mohammed ben Salmane (MBS) dans Affinity Partners, un fonds d’investissement géré par Jared Kushner, gendre de Donald Trump et architecte des accords d’Abraham.
Cet investissement, qui doit en partie financer des projets en Israël pour ouvrir la voie à une normalisation entre les deux pays, illustre les subtilités des relations entre l’Arabie saoudite, les États-Unis et Israël. Le jeu de Riyad dans la région ne se limite pas à Israël. Le rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran, amorcé en mars 2023, a conduit à des exercices militaires conjoints entre les deux pays, témoignant d’une nouvelle dynamique régionale. Si Israël poursuit une politique d’annexion en Cisjordanie, cela pourrait avoir des conséquences géopolitiques majeures. L’Arabie saoudite, sous pression interne et externe, pourrait être poussée à renforcer ses liens avec l’Iran, ce qui marquerait un tournant stratégique dans les équilibres régionaux. Par ailleurs, l’Arabie saoudite était présente lors du dernier sommet des Brics, à Kazan, en Russie, du 24 au 27 octobre. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Iran, Égypte, Émirats arabes unis et Éthiopie ont, dans leur communiqué final, dénoncé les actions israéliennes à Gaza et au Liban.
La situation intérieure: un coup d’État dans un coup d’État ?
Deuxième inconnue dans la possibilité de mener la stratégie de Nétanyahou sur le temps long: la réaction de la démocratie israélienne, et du camp libéral, face à cette politique. Avant le 7-Octobre, Israël était déjà en proie à des tensions internes majeures du fait de son glissement vers la démocratie illibérale.
Depuis, les dynamiques se sont encore détériorées, exacerbées par des luttes de pouvoir au sein même de l’appareil d’État. Lors de la nuit électorale aux États-Unis, Benyamin Nétanyahou a limogé le ministre de la défense, Yoav Gallant. Ce dernier a récemment dénoncé le recours à des entreprises privées pour distribuer l’aide humanitaire à Gaza, qu’il considère comme un «blanchiment» de l’occupation militaire.
Le gouvernement refuse toujours la création d’une commission d’enquête indépendante sur le 7 octobre. D’autres figures-clés sont dans le viseur du gouvernement, notamment Ronen Bar, chef du Shin Bet, et Gali Baharav-Miara, procureure générale d’Israël, cible d’une campagne de dénigrement virulente. Des affiches hostiles à son encontre ont été placardées à Tel-Aviv, malgré son alignement partiel avec l’agenda du gouvernement.
Cette chasse aux opposant·es s’inscrit dans un climat d’affaires judiciaires sensibles. Des fuites de documents confidentiels, relayées par des médias étrangers tels que Bild et The Jewish Chronicle, ont conduit à l’arrestation d’un réserviste et d’un collaborateur du gouvernement, Eli Feldstein. Il aurait transmis ces documents afin de faire un contre-feu à la suite de la mort de six otages israéliens. Nétanyahou faisait alors face à de fortes protestations dans l’opinion publique, l’accusant d’avoir refusé tout accord ou cessez-le-feu avec le Hamas et d’avoir ainsi sacrifié la vie des otages.
En parallèle, des accusations émergent sur des falsifications dans les rapports gouvernementaux des premières heures après le 7-Octobre. Le gouvernement refuse toujours la création d’une commission d’enquête indépendante, suscitant de vives critiques. Jusqu’à présent, seul le général Yossi Sariel, responsable de l’unité 8200, a démissionné (en septembre).
La justice internationale
La pression internationale s’intensifie également, avec un rôle croissant de la justice internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a approuvé les demandes de mandats d’arrêt émis par le procureur Karim Khan contre Benyamin Nétanyahou, l’ancien ministre de la défense Yoav Gallant, et Mohammed Deïf, figure du Hamas tuée par Israël en juillet (un décès non reconnu par le Hamas). Ces mandats, désormais émis, empêchent Nétanyahou de voyager dans les 120 États signataires du Statut de Rome, dont la totalité de l’Union européenne. Sans surprise, les États-Unis, opposants de longue date à toute forme de justice pénale internationale, ont annoncé un projet de loi visant à sanctionner la CPI en cas de poursuites contre des responsables israéliens.
Dans l’Union européenne, la Hongrie de Viktor Orbán a d’ores et déjà annoncé sa volonté de passer outre. Plus largement, si, depuis les accords d’Oslo, l’Europe maintient un consensus en faveur d’un État palestinien, son attitude face à Israël est aujourd’hui marquée par des divisions. Une fracture générationnelle se dessine également. Les jeunes générations occidentales, particulièrement actives sur les réseaux sociaux, sont révoltées par les images en provenance de Gaza. Cette indignation contribue à polariser davantage les sociétés européennes, comme en témoignent les récents débats enflammés autour d’incidents survenus lors d’un match de football à Amsterdam.
Le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis est un nouveau test pour la capacité de l’Union européenne à s’affirmer face à la montée de l’illibéralisme. Cette situation soulève une question cruciale. L’Europe dispose-t-elle encore des moyens politiques et moraux pour incarner une position cohérente et unifiée sur ces sujets? Le soutien à la Cour pénale internationale offre à l’Union une chance historique de montrer son attachement à ses valeurs.
> Lire l'article sur le site de Mediapart

Média

Journaliste(s):
Nom de l'émission
Format
Partager