La Première Guerre mondiale et la balkanisation du Moyen-Orient
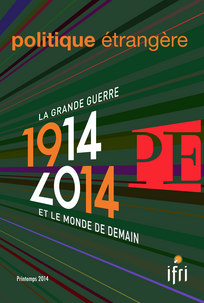
La Première Guerre mondiale a eu des conséquences tragiques pour le Moyen-Orient. Elle a conduit au dépècement de l’Empire ottoman et à une balkanisation de la région. La France et la Grande-Bretagne ont semé les graines de conflits futurs en faisant des promesses contradictoires aux notabilités et dirigeants locaux. L’instabilité que l’on observe aujourd’hui au Moyen-Orient puise ses racines dans les découpages qui ont fait suite à la Grande Guerre. Une nouvelle conflagration régionale est à craindre.

La commémoration du centenaire du début de la Première Guerre mondiale est l’occasion de revenir sur les conséquences de ce conflit majeur qui a ouvert le XXe siècle et entraîné des bouleversements considérables. Ce retour est d’autant plus nécessaire que nous pourrions bien être à la veille d’une nouvelle conflagration dont l’épicentre serait le Moyen-Orient. Les tensions – dont beaucoup trouvent leur origine, directement ou indirectement, dans la Première Guerre mondiale – y sont en effet intenses.
S’il est courant de considérer que ce conflit a planté en Europe même les germes de la Seconde Guerre mondiale, il est plus rare d’en évoquer les conséquences dramatiques sur le Moyen-Orient depuis l’effondrement de l’Empire ottoman qu’il a directement entraîné. On sait en effet que les lourdes conditions imposées par les vainqueurs français et anglais sur l’Allemagne ne sont pas étrangères à la montée du nazisme en Europe. À quoi il faut ajouter que cette guerre a précipité la Russie dans la guerre civile, avec la victoire du parti bolchevique et, en conséquence, le développement rapide de nombreux partis communistes en Europe, au Moyen-Orient, ainsi qu’en Extrême-Orient. C’est ainsi qu’a été créé le contexte historique propice à la déflagration de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci s’est prolongée dans la guerre froide et les innombrables conflits que cette dernière a attisés dans les pays du tiers-monde. L’effondrement de l’URSS en 1989-1990 n’a guère mis fin aux tourments du Moyen-Orient, et plus particulièrement des pays arabes.
Le Moyen-Orient a en effet continué d’être déchiré par des violences et affrontements militaires majeurs dont les sources se trouvent dans les séquelles de la Première Guerre mondiale, amplifiées par le conflit de 1939-1945 et la guerre froide. Certes, l’histoire ne se répète jamais, mais derrière les continuités et les ruptures qu’elle offre à l’observateur superficiel, il est des contextes qui restent favorables au maintien de situations conflictuelles. Dans le cas du Moyen-Orient et, plus spécialement, du monde arabe, les conséquences de la Première Guerre mondiale et ses suites immédiates refont surface aujourd’hui à l’occasion des révoltes qui secouent la région. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Le dramatique dépècement de l’Empire ottoman et ses conséquences
- Les promesses inconciliables des Alliés
- Ex-provinces arabes de l’Empire : une balkanisation géographique et politique
- La création du « vide de puissance » dans le monde arabe
- Le Moyen-Orient, nouvelle « poudrière » d’un conflit mondial
Georges Corm est professeur à l’Institut des sciences politiques de l’université Saint-Joseph à Beyrouth. Il a été ministre des Finances du Liban (1998-2000) et a notamment publié Le Proche-Orient éclaté (Paris, Gallimard, 2012, 7e édition).
Article publié dans Politique étrangère, vol. 79, n° 1, printemps 2014

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La Première Guerre mondiale et la balkanisation du Moyen-Orient
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Turquie 2050 - Corridors ; Communauté LGBTI ; Turquie - Chypre Nord
Repères sur la Turquie n° 33 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Comment relancer l'économie en Syrie : le rôle des entrepreneurs syriens en Turquie
Ce rapport examine le rôle potentiel des entreprises partenaires syriennes opérant en Turquie dans le soutien à la reprise économique et aux efforts de reconstruction en Syrie. À partir de données recueillies grâce à des recherches de terrain et à des enquêtes menées par la Fondation pour la recherche en politique économique de Turquie (TEPAV), le rapport dresse un portrait général des caractéristiques des entreprises, de leur répartition sectorielle ainsi que de leurs activités économiques transfrontalières. Il explore comment cette dynamique entrepreneuriale pourrait contribuer à la restauration des chaînes d’approvisionnement, à la relance de la production locale et à la création d’emplois.













