Les questions allemandes au XXe siècle : identité, démocratie, équilibre européen
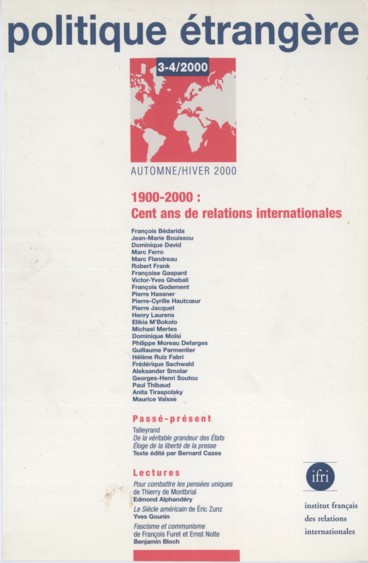
Ce que nous appelons « la question allemande » regroupe en réalité un ensemble de problèmes de politique intérieure et extérieure dont toutes les solutions proposées sont interdépendantes. Ces problèmes peuvent être ramenés à trois notions clefs : l’identité nationale, la démocratie libérale et l’équilibre européen. Au cours du XXe siècle, la question allemande a tenu en haleine l’Europe et la planète, les précipitant même dans des abîmes et façonnant pour un siècle la carte du monde. Elles ont fini par trouver une réponse durable avec la réunification pacifique de l’Allemagne, le 3 octobre 1990, et l’intégration réussie de la République fédérale dans une Europe occidentale enfin pacifiée.
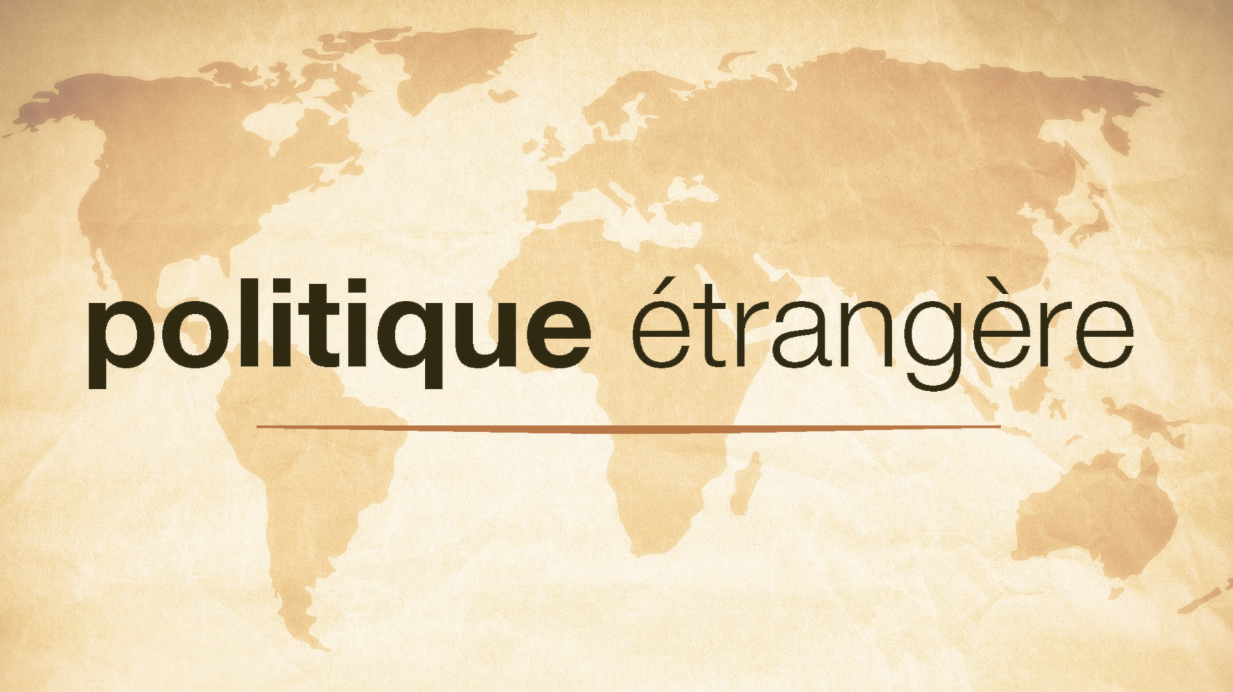
Depuis l'Empire jusqu'à la République fédérale d'aujourd'hui, l'aspiration de l'Allemagne à être placée sur un pied d'égalité en Europe et dans le monde fut une des constantes de la politique étrangère allemande - exception faite du IIIe Reich qui visait l'asservissement de l'Europe voire de toute la planète. Mais si l'Allemagne de Guillaume II se comportait en nouveau riche n'ayant pas encore trouvé sa place dans le club des gens distingués et cherchant à masquer un certain manque d'assurance par l'étalage bruyant de sa force, l'Allemagne d'Adenauer, de Brandt et de Kohi, en revanche, apprit à atteindre ses objectifs sans faire de bruit, en « tirant habilement le plus large profit possible d'une souveraineté limitée ». En cette ère de mondialisation qui restreint la souveraineté des États, ce savoir- faire particulier pourrait bien servir d'atout à l'Allemagne de demain.
Quoi qu'il en soit, la question allemande ne peut être correctement comprise qu'à condition de ne pas en dissocier les aspects intérieurs et extérieurs ; ceux-ci doivent au contraire être considérés dans leur intégralité et comme des éléments interdépendants. Depuis la fin du Saint Empire romain germanique, en 1806, et celle des guerres napoléoniennes, en 1815, le cœur même de la question allemande s'est en effet cristallisé autour de trois grands thèmes : identité nationale, démocratie libérale, équilibre européen, qui sont autant de grandes questions :
— Y a-t-il adéquation totale entre l'Allemagne État et l'Allemagne nation, entre la citoyenneté et la nationalité allemande ?
— Un État national allemand est-il compatible avec une constitution libérale-démocrate ?
— Enfin, l'unité nationale des Allemands peut-elle se faire sans perturber l'équilibre des forces en Europe ?
Ces trois problèmes peuvent servir de fil conducteur tout au long de l'histoire complexe de l'Allemagne du XXe siècle. Le deutsches Reich (1871-1918) et la république de Weimar (1919-1933) n'en ont donné qu'une solution partielle. Le IIIe Reich (1933-1945) les a aggravés de façon inimaginable. Et paradoxalement, c'est la division de l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide qui a préparé les réponses permettant d'y apporter des solutions durables. [...]
PLAN DE L’ARTICLE
- Du deutsches Reich au IIIe Reich
- Le deutsches Reich (1871-1918)
- La République de Weimar (1919-1933)
- La dictature national-socialiste (1933-1945)
- De la division à l'unité
- Mais qu'en était-il de la question allemande ?
L'Allemagne unifiée
Figures
Michael Mertes est rédacteur en chef adjoint de l’hebdomadaire Rheinischer Merkur (Bonn).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les questions allemandes au XXe siècle : identité, démocratie, équilibre européen
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesAvant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères.








