D'hier à demain : penser l'international (1936-2006)
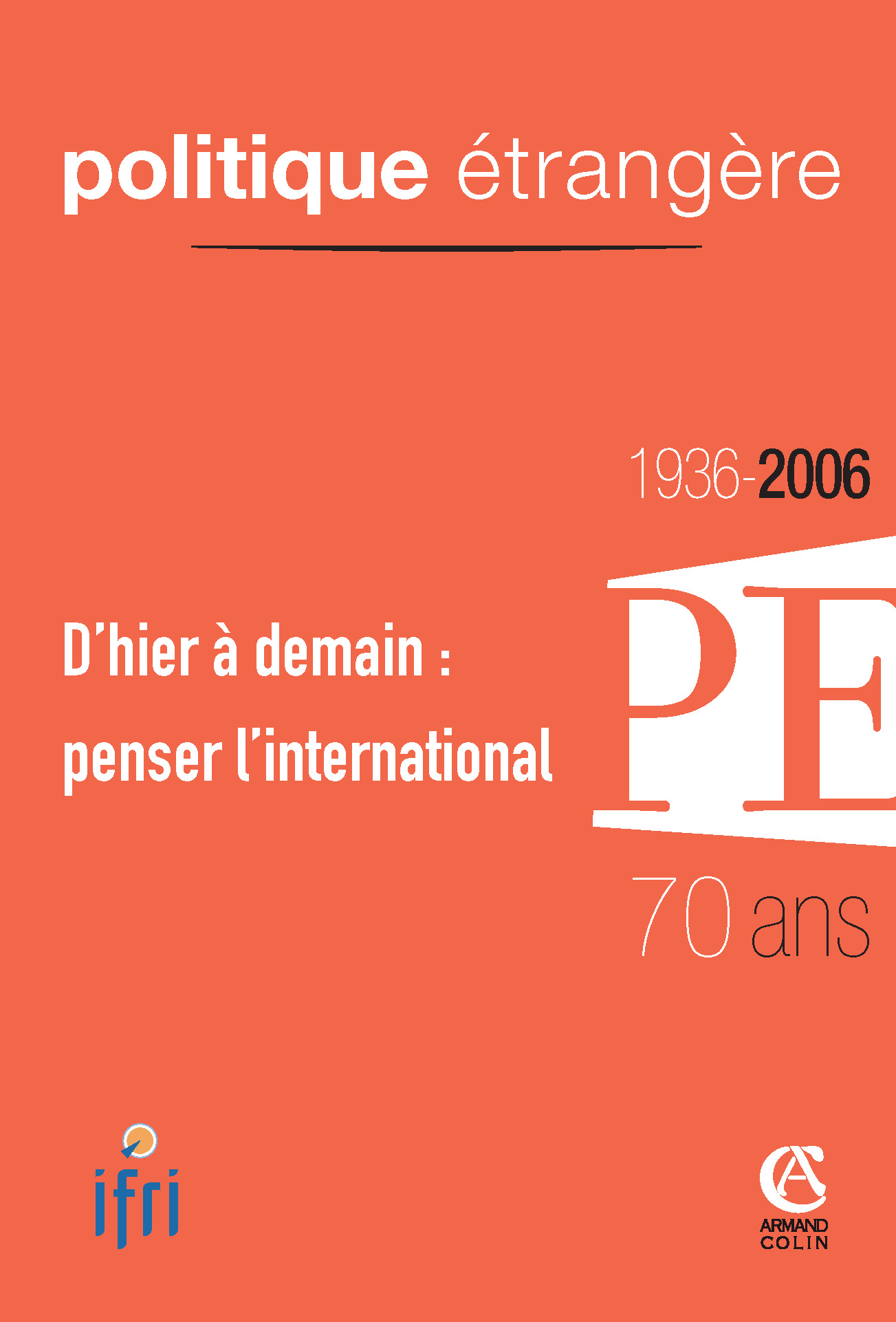
Ce numéro anniversaire célèbre les 70 ans d'existence de la revue Politique étrangère, créée en 1936.
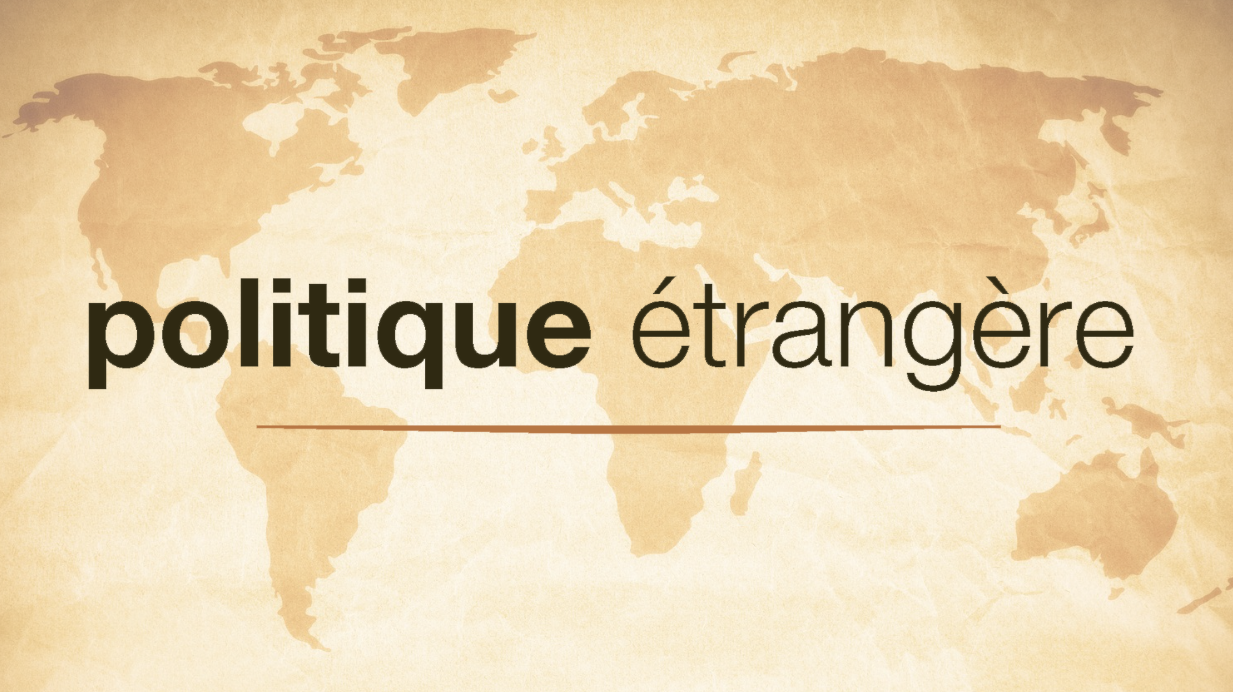
« "On ne s’arrête plus", soupirait un Chateaubriand au terme de son âge, "on ne s’arrête plus pour écouter les échos des vieux malheurs"… Révérence gardée, contredisons l’Enchanteur : trop de mondes sont passés sur les soixante-dix ans de Politique étrangère, pour que nous puissions délaisser le retour sur l’histoire.
70 ans : en 1936 l’Espagne était républicaine, la Tchécoslovaquie existait encore, la Russie était soviétique, et l’Europe au centre du jeu… Quelques guerres – de toutes ampleurs – et quelques effondrements d’empires plus tard, le XXᵉ siècle quitte la scène dans un temps mal lisible, où le désordre de l’esprit, la confusion des analyses, semblent l’écho d’une certaine déconstruction du monde. Du moins de ce monde des grands affrontements, des États, des frontières. Que peuvent donc avoir en commun un numéro de PE de la fin des années 1930, et un numéro du début du XXIᵉ siècle ?
Il fallait, pour le savoir, recourir à une mise en scène des idées, ordonner entre hier et aujourd’hui un dialogue de thématiques et de compétences. Sans vouloir faire comparaître des morts, il fallait puiser dans la richesse des auteurs de Politique étrangère pour ordonner une sorte de polyphonie, mêlant plusieurs âges de la réflexion. Et découvrir – est-ce une surprise ? – que beaucoup de problématiques, à défaut des solutions proposées, traversent ces âges.
Les interrogations de Raymond Aron, que décrit Stanley Hoffmann, ou de Marcel Merle, sur le système international, ses acteurs, ses dynamiques, sont-elles si éloignées des analyses de Thierry de Montbrial ou de Pierre de Senarclens, qui prennent pourtant d’abord en compte les formidables bouleversements politiques et techniques de la fin du siècle dernier ? Les belles pages de Richard Coudenhove-Kalergi, écrites au seuil de la Seconde Guerre mondiale, sur la construction de la paix à venir, sont-elles autre chose qu’une méditation sur la construction européenne, et un multilatéralisme à reconstruire – multilatéralisme qu’approchent, chacun dans sa logique, Abdou Diouf et Lakhdar Brahimi ? Quant aux énoncés de Louis Massignon sur la primauté de l’empathie culturelle, ils s’inscrivent naturellement dans les errances actuelles des relations que l’Occident entretient avec les pays d’islam. On passera donc aisément de ces réflexions mystiques aux commentaires politiques de Koïchiro Matsuura sur les permanences et les incarnations variées du facteur culturel dans les relations internationales, et de Jonathan Fox sur la rémanence d’un facteur religieux trop vite marginalisé par les dogmes laïques du XXᵉ siècle. [...] »
(Extrait de l'Éditorial, par Dominique David)
SOMMAIRE
Grands paradigmes et théories des relations internationales
[Pour l'histoire] Raymond Aron et la théorie des relations internationales, par Stanley Hoffmann
Le « système international » : approches et dynamiques, par Thierry de Montbrial
Théories et pratiques des relations internationales depuis la fin de la guerre froide, Pierre de Senarclens
Organisations et interventions internationales
[Pour l'histoire] La paix de demain, par Richard N. Coudenhove-Kalergi
L'ONU survivra-t-elle en 2034 ?, par Lakhdar Brahimi
Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation, par Abdou Diouf
Gouvernance internationale : entre justice et droit
[Pour l'histoire] Le système mondial : réalité et crise, par Marcel Merle
Justice et économie mondiale, par Ethan B. Kapstein
Succès et échecs de la maîtrise des armements, par Jozef Goldblat
Dimensions actuelles du militaire
[Pour l'histoire] L'organisation de la sécurité et les progrès des armes nouvelles, par Charles Ailleret
Les impasses de la contre-insurrection, par Edward N. Luttwak
Vers la fin de la guerre ?, par John Mueller
Nouveaux enjeux de sécurité
[Pour l'histoire] Politique de dissuasion et guerre limitée, par Bernard Brodie
Le terrorisme en perspective, par Daniel Benjamin
La sécurité humaine : un concept pertinent ?, par Mary Kaldor
Mondialisation et rapports Nord/Sud
[Pour l'histoire] Développement du Tiers-Monde et nouvel ordre économique international, par Bernard Chadenet
Comment la globalisation façonne le monde, par Pierre-Noël Giraud
Les enjeux de l'aide publique au développement, par Pierre Jacquet
Prospective énergétique et climats
[Pour l'histoire] L'énergie et l'économie mondiale, par Jacques de Larosière
L'avenir de l'énergie, par John Browne
Climat et longue durée : la variable vendémiologique, par Emmanuel Le Roy Ladurie
Dynamiques démographiques
[Pour l'histoire] L'Europe et ses populations excédentaires, par Robert Rochefort
1935-2035, un siècle de ruptures démographiques, par Jean-Claude Chasteland et Jean-Claude Chesnais
Afrique du Nord et Moyen-Orient : des migrations en quête d'une politique, par Philippe Fargues
Poids des enjeux culturels et religieux
[Pour l'histoire] L'Occident devant l'Orient : primauté d'une solution culturelle, par Louis Massignon
L'enjeu culturel au cœur des relations internationales, par Koïchiro Matsuura
Religion et relations internationales : perceptions et réalités, par Jonathan Fox
***
Mythologies de l'international, par Chantal Delsol

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









