Les Afro-Asiatiques : acteurs ou enjeux de la scène politique internationale ?
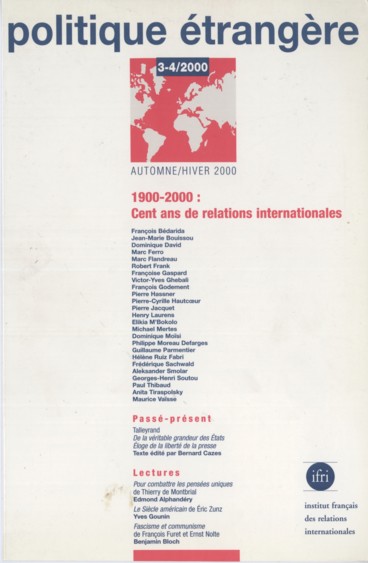
Né à la conférence de Bandung, en 1955, l’afro-asiatisme marqua de son empreinte la seconde moitié du XXᵉ siècle. «Mythe politique inspirateur d’actions», il favorisa la décolonisation et permit l’émergence du Tiers-Monde sur la scène internationale, derrière les figures de Nasser, Nehru, Sukarno et Zhou Enlaï. Pris dans l’étau de la guerre froide, il ne put cependant résoudre certaines contradictions, entre non-alignement et pro-communisme, discours libérateur et régime autoritaire, indépendance politique et dépendance économique. En définitive, l’expérience afro-asiatique se sera surtout distinguée par sa contribution décisive à la démocratisation des relations internationales.
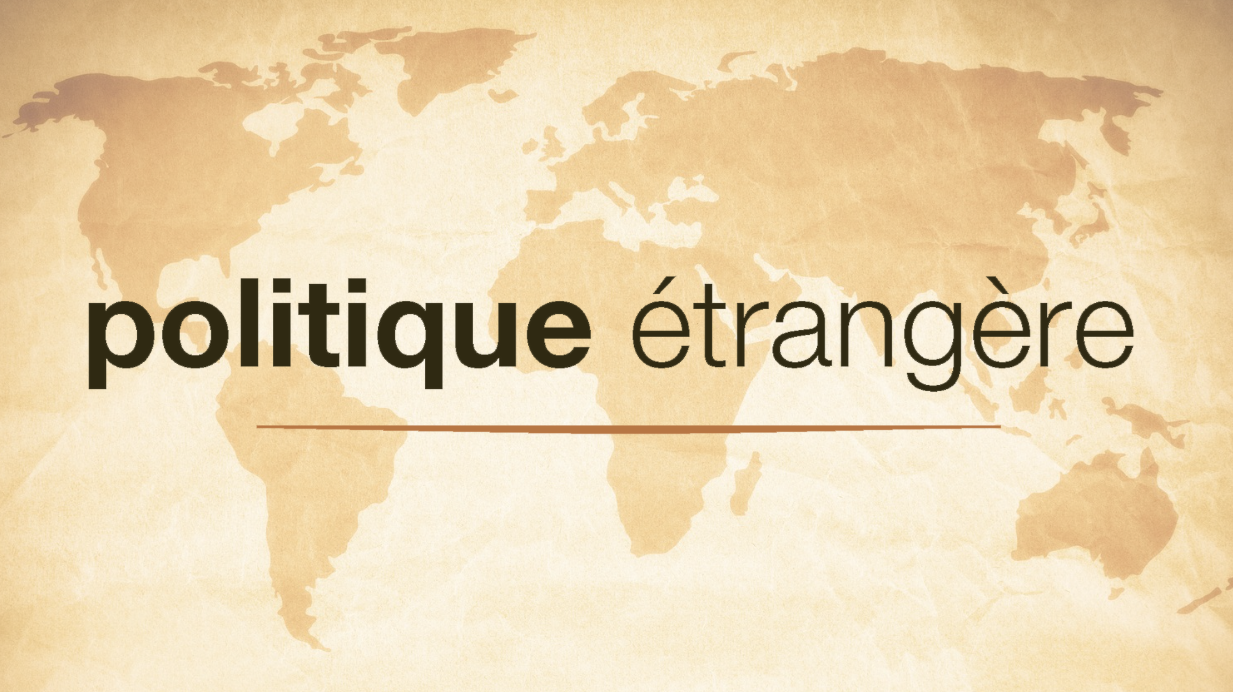
Généalogie de l'afro-asiatisme
L'âge des Empires vit l'achèvement de la domination européenne sur la totalité de l'Ancien Monde et de l'Afrique noire. Car si cette domination fut largement assurée dans les premières décennies du XIXᵉ siècle, la prise de contrôle direct d'immenses territoires en Afrique et en Asie fut surtout le fait du demi-siècle qui précéda la guerre de 1914-1918 et que l'on peut définir comme le temps de la première mondialisation. Parallèlement, et en dépit des rivalités impériales, les colonisateurs ressentirent très tôt la nécessité d'une solidarité commune face aux révoltes des peuples soumis. On le voit bien dans les expéditions militaires collectives menées en Chine. Cette peur occidentale fut le symétrique de l'idéologie qui se développait alors parmi les peuples colonisés. Une idéologie qui reconnaissait la différence, établie par l'Occident, entre « eux » et « nous », et postulait que le mouvement naturel de l'histoire allait dans le sens d'une réappropriation, par les peuples colonisés, des catégories inventées pour les désigner. Les non-Blancs se trouvaient ainsi en position d'incarner à leur profit la « mission de l'homme blanc ».
Dès les années 1870, les élites des peuples dominés prirent donc conscience de cette communauté de destin qui les unissait face au pouvoir blanc. Le premier mouvement de résistance à l'impérialisme d'une certaine ampleur fut, à la fin du XIXᵉ siècle, le panislamisme (le terme apparaît en 1880-1881). Il se renouvela régulièrement tout au long du XXᵉ siècle, suscitant, bien avant 1914, la première peur de l'Occident. Cette peur fut bientôt relayée par le « péril jaune » qui, curieusement, inquiétait surtout des États peu présents en Asie, comme l'Allemagne impériale. Celle-ci tenta, néanmoins, pendant la Grande Guerre, de susciter la révolte des peuples des Empires coloniaux français et britanniques. Ces derniers répliquèrent en encourageant l'émergence d'un mouvement panarabe d'abord limité à l'Asie, mais qui ne tarda pas à exercer son attraction sur le nord de l'Afrique. Il eut un prolongement immédiat en Russie soviétique, avec le célèbre congrès, à Bakou, de l'Internationale communiste. Le soutien aux mouvements révolutionnaires, même bourgeois, devint un mot d'ordre. Durant la Seconde Guerre mondiale, enfin, ce fut au tour du Japon de se faire le héraut du mouvement panasiatique, à l'intérieur de son propre système impérial en voie de constitution.
PLAN DE L’ARTICLE
- Généalogie de l’afro-asiatisme
- Les origines de la décolonisation
- L’anti-impérialisme
- Alignement et neutralisme
- La conférence de Bandung
- La thématique de l’afro-asiatisme
- Droits de l’Homme et Tiers Monde
- Suez, succès majeur de l’afro-asiatisme
- Les impasses de l’afro-asiatisme
- Vers le non-alignement progressiste
- Conclusion
Henry Laurens est professeur des universités à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les Afro-Asiatiques : acteurs ou enjeux de la scène politique internationale ?
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









