L'OTAN et les armes nucléaires
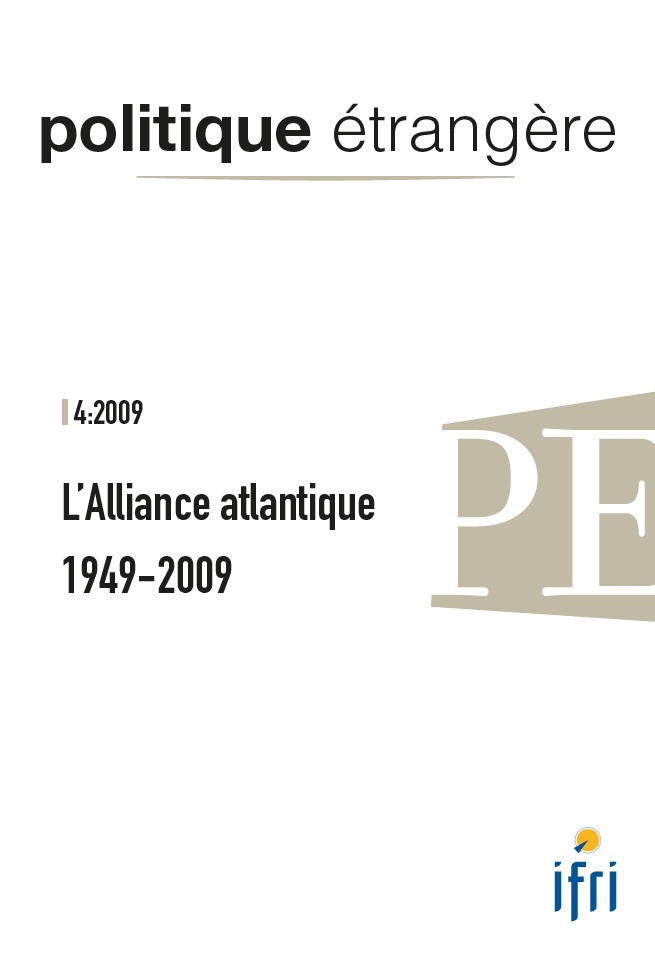
Le dispositif dissuasif de l’Alliance issu de la guerre froide ne peut qu’évoluer avec l’environnement actuel. Les éléments de la stratégie nucléaire de l’OTAN doivent donc être revus. Quel rôle ont désormais les armes affectées à l’Alliance ? Comment serait prise une décision en temps de crise et comment seraient utilisées ces armes ? Les accords de partage demeurent-ils pertinents ? Et comment arriver à un accord avec Moscou sur la disparition des armes nucléaires à courte portée ?

Le concept stratégique de 1999 a été en son temps décrit comme un ordre de mission fondamental pour l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). L’actuel secrétaire général de l’Alliance, Anders Fogh Rasmussen, a mis en place un groupe d’experts pour poser les bases d’un nouveau concept, et ses résultats feront l’objet d’une consultation à la fois entre les membres de l’Alliance, et en interne pour chacun d’eux, avant que n’aient lieu les discussions intergouvernementales. Ce processus devrait mener à un nouveau concept stratégique d’ici à la fin de l’année 2010.
Entre autres domaines, le concept stratégique pose les paramètres essentiels de la politique nucléaire de l’OTAN. Il semble que ce concept doive être révisé approximativement tous les dix ans ; la tâche est donc d’établir les principes qui guideront la politique nucléaire de l’Alliance dans la prochaine décennie.
Au moment où ces lignes sont écrites, le Département de la défense américain révise sa posture nucléaire, processus qui devrait s’achever en fin d’année 2009. Parallèlement au travail du groupe d’experts, l’OTAN a entrepris un examen des exigences de la dissuasion nucléaire au XXIᵉ siècle. Le rôle, le volume, la configuration des forces nucléaires sont donc soumis à évaluation, dans les pays clés de l’OTAN, et dans le cadre de l’Alliance.
Les États-Unis tentent de créer un environnement favorable à de nouvelles avancées dans le domaine du contrôle des armements. Dans son discours de Prague (avril 2009), le président Barack Obama a remis en relation les questions de non-prolifération nucléaire et de désarmement, et a insisté sur l’urgence qu’il y a à réduire la place des armes nucléaires dans le maintien de la sécurité internationale. Son Administration a également donné un nouveau souffle aux négociations bilatérales avec la Russie, et a proposé un sommet de responsables de haut niveau, en 2010, pour parler de la sécurité des matières nucléaires dans le monde. Fin septembre 2009, B. Obama a présidé une réunion du Conseil de sécurité sur le contrôle des armements nucléaires dont le point culminant a été le soutien unanime à une résolution appelant au renforcement des règles de contrôle des armes nucléaires. L’Administration américaine a également affirmé sa volonté de dialoguer avec les États considérés comme problématiques pour ce contrôle.
PLAN DE L’ARTICLE
- La menace et la réponse nucléaire de l’OTAN
- Les armes nucléaires à courte portée dans la stratégie de l’Alliance
- La relation à la Russie et l’avenir des armes nucléaires à courte portée
Ian Anthony, coordinateur de recherches, dirige le programme sur le contrôle des armements et la non-prolifération au Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Parmi ses dernières publications, on peut lire : Reforming Nuclear Export Controls: The Future of the Nuclear Suppliers Group (Stockholm, SIPRI, « Research Report » n° 22, 2007).
Texte traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Thomas Richard.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'OTAN et les armes nucléaires
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








