La France et l'OTAN : une histoire
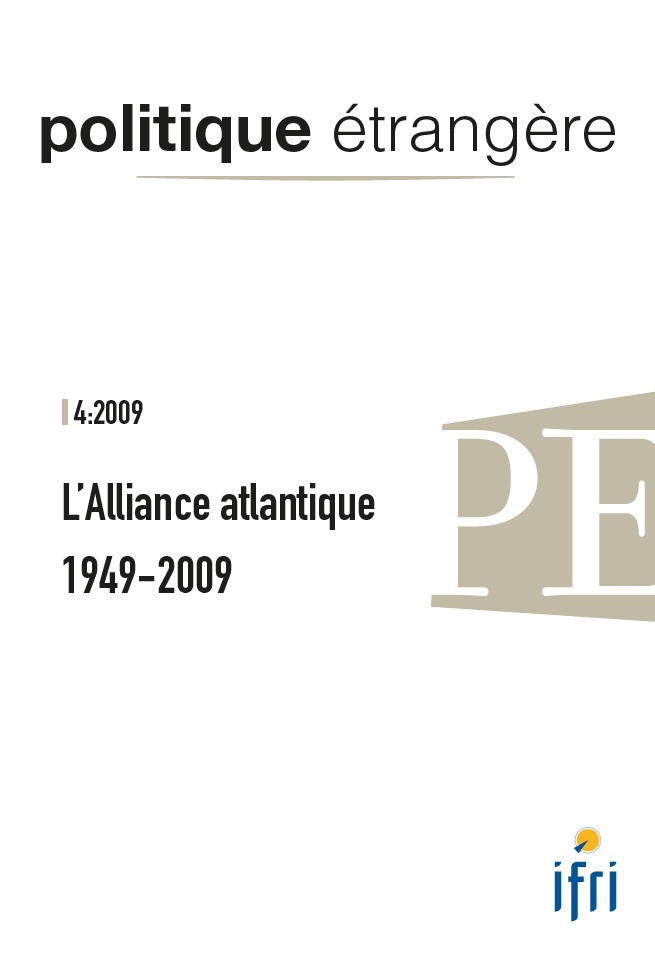
Cofondatrice de l’Alliance, la France adopte en 1966 une position qui prend acte de son échec à la réformer de l’intérieur et qui garantit son indépendance. Les décisions récentes de réintégration sont les héritières de trois facteurs : des bouleversements géopolitiques redéfinissant le rôle de l’Alliance ; un rapprochement continu dans la gestion des crises depuis les années 1990 ; et la volonté de construire une Europe de la défense, qui ne peut être que complémentaire de l’OTAN.

Le sommet du 60e anniversaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), les 3 et 4 avril 2009, a consacré le retour de la France dans les structures du commandement intégré, annoncé par le président Nicolas Sarkozy le 17 juin 2008, lors de la présentation du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale : « Rien ne s’oppose à ce que nous participions aux structures militaires de l’OTAN ». Cela faisait 43 ans que la France avait rompu avec l’intégration. On a parlé de « trahison », du retour du fils prodigue, de la fin de l’exception française... Qu’en est-il exactement ? En fait les relations de la France avec l’OTAN ont été sinusoïdales : membre fondateur de l’Alliance, puis contestataire au sein du système, la France se place ensuite en marge de l’OTAN, avant le retour au bercail.
Un rôle fondateur dans le nouvel ordre atlantique
Après 1945, soumise à la contrainte de la guerre froide, la France obtient ce qu’elle avait souhaité lors des deux guerres mondiales : un engagement précoce des États-Unis en Europe. Face à la menace soviétique, elle constate son impuissance et l’insuffisance de ses moyens militaires, même dans le cadre d’une Union occidentale trop inféodée à l’impérieuse Albion, et préfère s’en remettre au grand allié américain, qui – dès le temps de paix – accepte de se lier aux pays européens dans une Alliance restreinte à l’Atlantique-nord. En signant le traité de Washington le 4 avril 1949, la France est donc un des membres fondateurs de l’Alliance atlantique, et la transformation de l’Alliance en organisation au début des années 1950 en fait, grâce à sa situation de carrefour géographique, un membre essentiel : des bases américaines et canadiennes sont installées sur son territoire, ainsi que les organes de commandement, comme les Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), dirigés par un général américain – le Supreme Allied Commander Europe (SACEUR).
Confrontés au même moment à la décolonisation, les dirigeants de la IVe République ne cessent de réclamer que la solidarité entre Alliés ne soit pas restreinte au domaine atlantique, mais étendue partout où les intérêts de l’Occident sont en cause, en particulier en Méditerranée et au Proche-Orient. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Un rôle fondateur dans le nouvel ordre atlantique
- Le choix de l’indépendance : l’émergence de la sécurité atlantique moderne
- Europe atlantique vs. Europe de la Défense
- La France et l’Alliance atlantique : une intégration à géométrie variable ?
Maurice Vaïsse, professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris en histoire des relations internationales, est responsable de la plus récente série des « Documents diplomatiques français ». Il est l’auteur, entre autres, de La Grandeur, Politique étrangère du général de Gaulle 1958-1969 (Paris, Fayard, 1998) et de La Puissance ou l’influence ? La France dans le monde depuis 1958 (Paris, Fayard, 2009).

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La France et l'OTAN : une histoire
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








