Le "retour" de la France dans l'OTAN : une décision inopportune
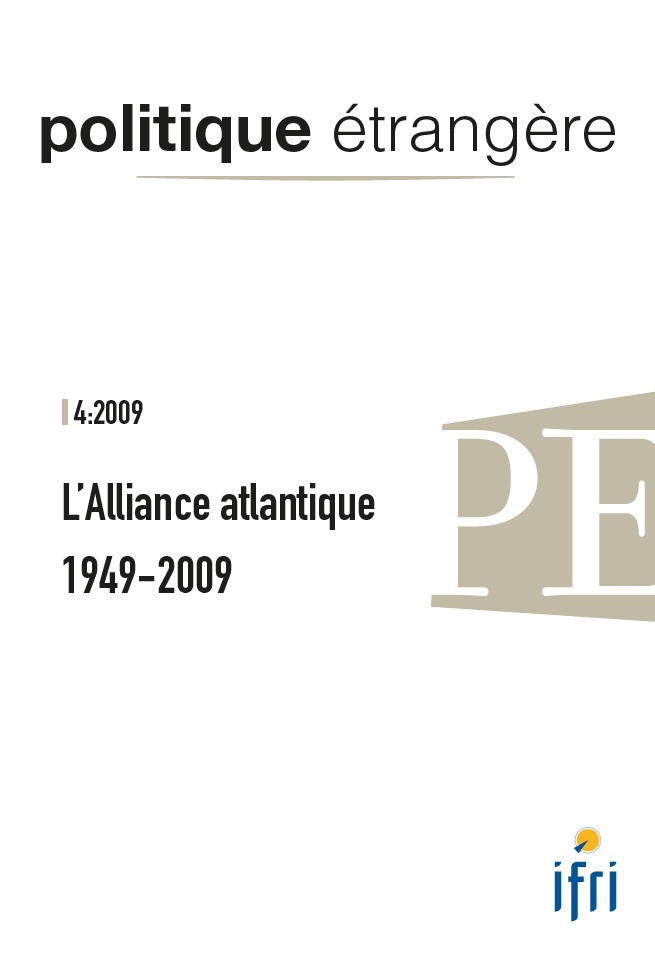
La décision de la France de rejoindre la structure intégrée de l’OTAN confirme des évolutions déjà anciennes. Elle n’en est pas moins contestable. Symbolique, elle affecte l’image du pays sur la scène internationale. Elle ne garantit nullement une évolution de l’Alliance correspondant à nos intérêts de nation, et n’aide pas à lever les ambiguïtés sur son propre avenir. Elle risque enfin de réduire progressivement à néant la volonté de la France de se défendre par elle-même.

Il est vrai que, comme le font remarquer ses partisans, la décision prise par le président de la République française de rejoindre la structure militaire intégrée de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) entérine certaines évolutions déjà anciennes, dont on pouvait à l’époque discuter l’opportunité, mais qui sont, en quelque sorte, rentrées dans les mœurs.
La France a ainsi contribué à pérenniser l’OTAN, après la fin de la guerre froide, en acceptant qu’elle intervienne, en 1994-1995, en Bosnie-Herzégovine, puis en 1999, cette fois sans mandat de l’Organisation des Nations unies (ONU), au Kosovo, et plus généralement en Yougoslavie. Dès décembre 1995, la France a regagné le Comité militaire de l’OTAN. Nous avons accepté le « hors zone ».
L’Alliance atlantique, à laquelle nous n’avions jamais cessé de participer, était au départ une alliance défensive, cantonnée à la zone euro-atlantique. Elle est devenue, au fil des ans, et particulièrement depuis 1999 (Kosovo) et 2001 (Afghanistan), une alliance globale, engagée dans des opérations de stabilisation et de rétablissement de la paix. Il s’agit là d’un changement de nature. On nous présente maintenant l’OTAN comme un « bras armé de l’ONU », mais cela n’a pas toujours été le cas. Pendant la guerre du Kosovo, et pour bombarder les villes yougoslaves, l’OTAN a agi en se substituant à l’ONU, et sans mandat du Conseil de sécurité. Espérons que ce fâcheux précédent ne se reproduira pas. Constatons toutefois qu’il a ouvert la voie, quatre ans plus tard, à l’invasion de l’Irak par une « coalition de volontaires » regroupés autour des États-Unis et, pour la plupart, membres de l’OTAN, anciens ou nouveaux. La France, sur sa ligne d’opposition à l’invasion de l’Irak, était alors loin d’être majoritaire au sein de l’Organisation que dominent les États-Unis, aussi bien d’ailleurs qu’au sein de l’Union européenne (UE).
Par ailleurs, nous sommes devenus l’un des principaux contributeurs de ces « opérations de stabilisation » de l’OTAN. Fallait-il aller plus loin, en rejoignant le Comité des plans de défense (DPC) ainsi que les états-majors de l’OTAN, bref la structure militaire intégrée qui reste placée, du point de vue opérationnel, sous le commandement suprême d’un général américain ? La justification de cette décision n’est pas évidente car c’est là une décision politique et symbolique dont l’importance ne saurait être sous-estimée. [...]
PLAN DE L’ARTICLE
- Quels intérêts communs ?
- L’Alliance face aux défis d’aujourd’hui
- Un danger pour la France ?
Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre d’État de la Recherche, de l’Éducation nationale, de la Défense et de l’Intérieur, est sénateur du territoire de Belfort et président de la Fondation de recherche Res publica.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le "retour" de la France dans l'OTAN : une décision inopportune
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








