Les fragilités du Kurdistan irakien
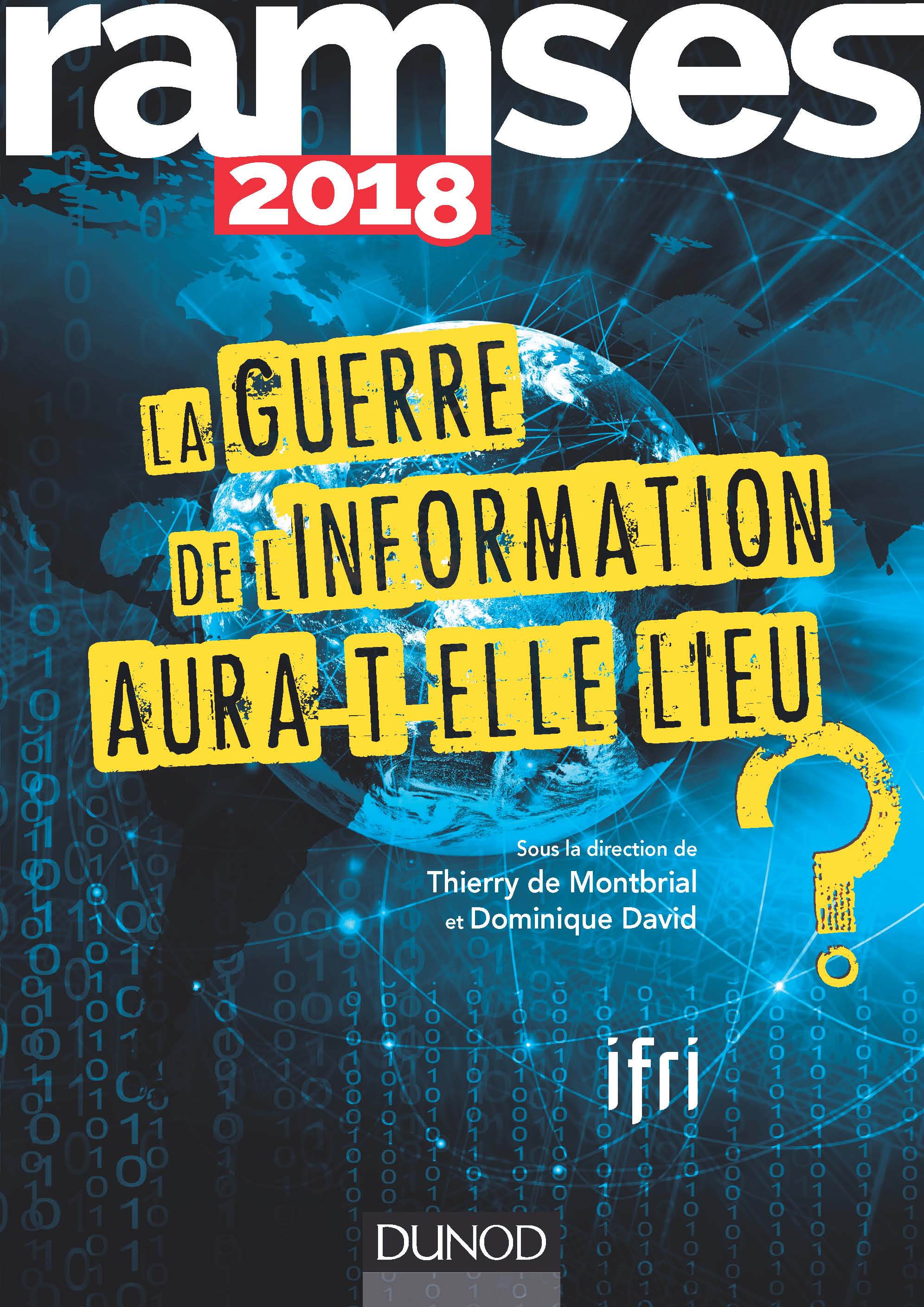
Le Kurdistan irakien arbore les institutions d’un État. Mais ses divisions politiques et ses faiblesses économiques minent ses prétentions à plus d’autonomie. Ses relations avec les acteurs de la région et au-delà ne semblent guère pouvoir concrétiser un appui à une marche vers l’indépendance qui demeure incertaine.
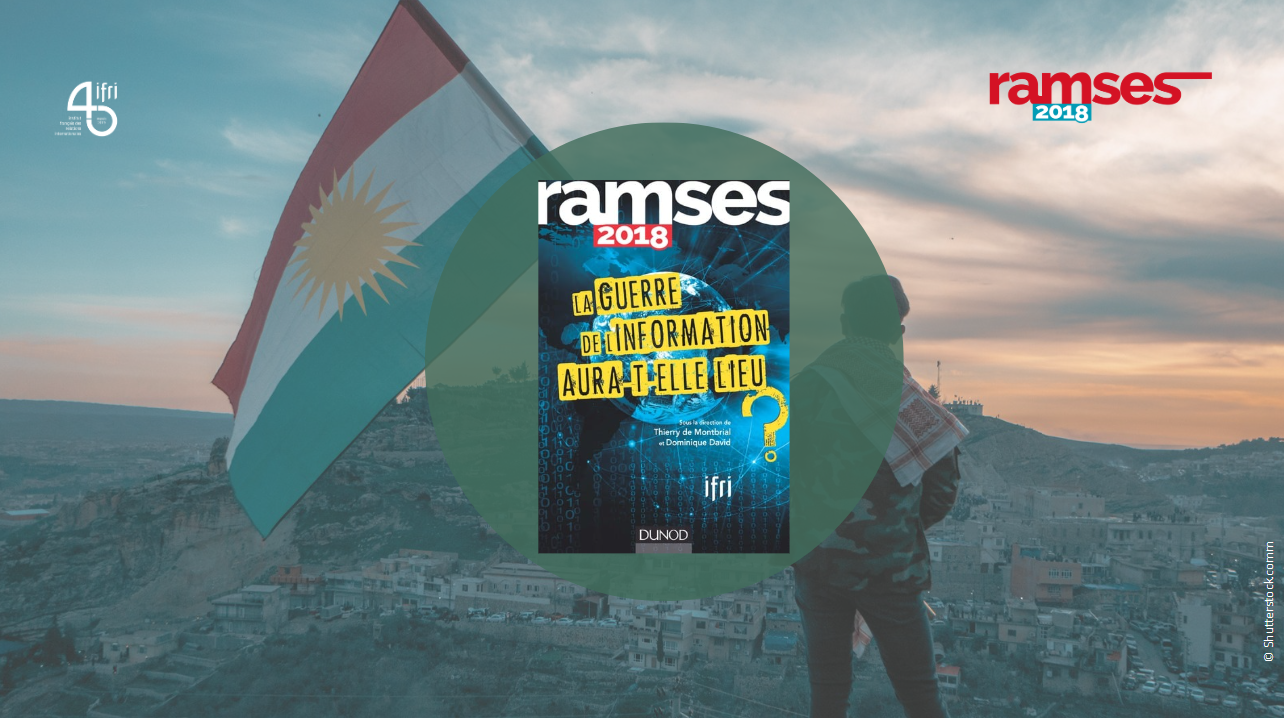
Le 2 avril 2017, Massoud Barzani, président du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK), a réuni à Erbil les deux bureaux politiques du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK). Le lendemain, un communiqué commun était publié : « En cette année 2017, nous allons organiser un référendum sur l’indépendance du Kurdistan. » La même semaine, Barzani envoyait à Bagdad une délégation représentant les deux partis pour rencontrer le président irakien Fouad Massoum, le Premier ministre Haïder Al-Abadi et le président de l’Assemblée nationale Salim Al-Jabouri. Une semaine plus tôt, le 28 mars 2017, le conseil provincial de Kirkouk avait approuvé à la majorité le placement du drapeau kurde sur les bâtiments gouvernementaux de la ville, grâce aux 25 voix des conseillers kurdes, les 16 conseillers arabes et turkmènes n’ayant pas participé au scrutin. Cela, en dépit des multiples menaces de Recep Tayyip Erdogan : « Que les propriétaires de ce drapeau sachent qu’ils font du séparatisme [...]. Je m’adresse au gouvernement régional du Kurdistan irakien : revenez sans attendre sur cette erreur. » ; ou « Abaissez ces drapeaux, poursuivez votre chemin avec le seul drapeau national irakien. Sinon, excusez-moi, mais vous serez contraints de faire marche arrière. » ; ou encore « En ce moment, nos relations se portent bien, ne brouillez pas ces relations. » Et pourtant, le drapeau kurde flotte toujours, non seulement sur Kirkouk, mais aussi sur l’ensemble des zones disputées entre Erbil et Bagdad. Sommes-nous à la veille de l’indépendance de ce que certains appelaient le « havre de paix » ?
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les fragilités du Kurdistan irakien
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Canada et la reconnaissance de l'État palestinien
Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
La République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Turquie 2050 - Corridors ; Communauté LGBTI ; Turquie - Chypre Nord
Repères sur la Turquie n° 33 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.














