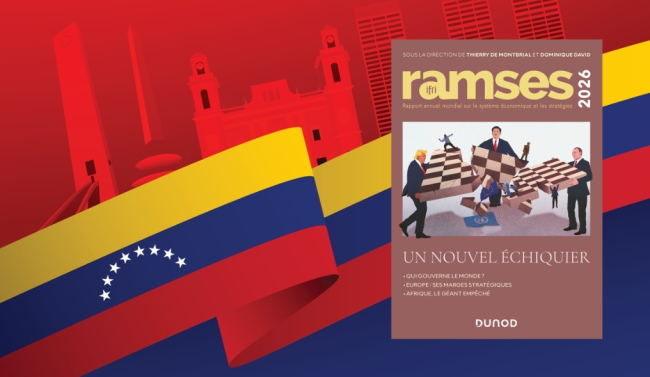États-Unis : la liberté d’expression face aux attaques du mouvement MAGA

La séquence ouverte par l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk le 10 septembre 2025 illustre l’importance et la relative fragilité du principe de liberté d’expression dans la société américaine.

Dès l’après-midi du drame, les responsables de l’administration, Donald Trump en tête, ont engagé une rhétorique de vengeance aux accents furieux contre les « dingues de gauche » (lunatic left), accusés d’avoir incité le meurtrier à commettre son acte. Un site de délation en ligne à été mis en place pour signaler les auteurs de propos jugés douteux sur la mort de C. Kirk et les faire licencier le cas échéant ; le présentateur vedette Jimmy Kimmel a été suspendu par son network ABC (propriété de Disney) pour avoir tenu de tels propos.
Ces événements invitent à rappeler le cadre juridique très particulier de la liberté d’expression aux États-Unis et à analyser les évolutions récentes de son exercice dans un contexte marqué par la polarisation politique et les guerres culturelles.
Un principe constitutionnel solidement protégé
La liberté d’expression est inscrite dans le Premier amendement à la Constitution (1791), c’est-à-dire au cœur de l’état de droit américain. L’amendement interdit explicitement aux autorités fédérales de limiter la liberté d’expression, ainsi que la liberté de la presse et la liberté de culte.
La Cour suprême a confirmé ce principe de manière continue. Ainsi, dans Schenck v. United States (1919), la Cour introduit la notion de « danger clair et immédiat » (clear and present danger) pour définir les seules limites possibles à la liberté d’expression. Ce critère est précisé en 1969 avec Brandenburg v. Ohio, qui ne permet de restreindre la parole que si cette dernière cherche à provoquer une « action illégale imminente » (imminent lawless action). Avec New York Times v. Sullivan, en 1964, la diffamation est également protégée, sauf en cas de « malveillance avérée » (actual malice). Cette forte protection a pour corollaire la tolérance de formes d’expression très controversées, telles qu’un défilé de militants néonazis (National Socialist Party of America v. Village of Skokie) en 1977, ou la destruction par le feu du drapeau américain (Texas v. Johnson) en 1989.
L’émergence d’internet et des contenus en ligne n’a pas fait varier la Cour suprême de cette ligne pour l’instant. Ainsi, en 1997, dans l’arrêt Reno v. American Civil Liberties Union, la Cour décide que les mesures de protection contre la pornographie en ligne contenues dans le Communications Decency Act voté l’année précédente sont inconstitutionnelles. Les plateformes ne seront pas tenues de modérer ces contenus, aussi problématiques soient-ils…
Une approche qui diffère de la nôtre
Si la liberté d’expression est un principe fondamental en droit français, elle est cependant encadrée par de multiples limites légales : l’incitation à la haine raciale ou religieuse est un délit, de même que l’expression publique de propos antisémites, racistes ou homophobes, ou l’apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.
Cette différence s’explique par des références philosophiques et des trajectoires historiques distinctes. N’ayant jamais connu de véritable dictature sur leur sol, les États-Unis ont eu le loisir, jusqu’à présent, de maintenir l’idéal libéral formulé par John Stuart Mill au XIXe siècle : l’espace public doit exister comme un « marché des idées » (marketplace of ideas), où la libre confrontation des différentes opinions doit permettre l’émergence non seulement des meilleures idées, mais aussi de la vérité.
Aussi naïve que l’on puisse la juger, cette vision conduit aussi à des excès dans des champs adjacents tels que le financement de la vie politique. Avec Citizens United v. FEC, 2010, la Cour suprême a en effet considéré que les personnes morales (entreprises, syndicats, associations) avaient elles aussi droit à la liberté d’expression, et que par ailleurs, l’argent constituait une forme de parole (money is speech). Ainsi, le financement des campagnes électorales par le secteur privé ne peut être plafonné dans le système politique américain. Le coût des campagnes présidentielles démocrates et républicaines dépasse désormais pour chacune le milliard de dollars.
Une première remise en cause venue de la société civile
Depuis les années 1980, la pratique de la liberté d’expression a été profondément marquée par l’essor des mobilisations sociales et les mutations technologiques.
Inspirée par la French theory des années 1960, l’exigence de tenir des propos « politiquement correct » est apparue dans les années 1980 – restant alors bien souvent la cible de railleries. Cette exigence a pris une dimension plus conflictuelle avec l’élection de Donald Trump en 2016, puis le meurtre de George Floyd en 2020 : en l’absence de limites juridiques suffisantes, c’est la société civile qui s’est chargée d’interdire dans le débat public tout ce qui pouvait relever du racisme et du colonialisme, du sexisme ou de la transphobie. C’est l’époque où les candidats à l’université ont été invités à rédiger des déclarations personnelles (personal statements) démontrant leur expérience de discrimination et où se sont multiplié les anecdotes montrant que des personnes avaient été brutalement licenciées pour avoir rédigé des tweets jugés inappropriés, aboutissant à des pratiques généralisées d’autocensure. Les réseaux sociaux ont amplifié les phénomènes de dénonciation et de mobilisation en ligne, favorisant une dynamique de « meute numérique ». Un facteur générationnel était également à l’œuvre puisque l’exemplarité sur les questions sociétales était particulièrement exigée par les étudiants progressistes sur les campus, les plus jeunes salariés des grands journaux, des entreprises de la tech ou des ONG.
Dans ce contexte, les conservateurs ont dénoncé une atteinte à la liberté d’expression exercée par la gauche « woke » - terme qui a succédé à celui de « politiquement correct ». Charlie Kirk avait d’ailleurs fait de cette dénonciation un thème central de ses interventions publiques, notamment à travers ses débats sur les campus universitaires.
La droite MAGA désormais contre la liberté d’expression
Au-delà d’un basculement entre la gauche et la droite, l’actualité montre aussi un changement de nature dans les attaques contre la liberté d’expression. À l’automne 2025, en effet, celles-ci ne proviennent plus de mobilisations sociales venues de la base, mais du plus haut sommet de l’État. À l’occasion des cérémonies en hommage à Charlie Kirk, le dimanche 21 septembre, le vice-président J. D. Vance et le président Donald Trump se sont ainsi exprimés pour réclamer vengeance. Derrière eux, toute l’administration, dont la procureure générale Pam Bondi ou le conseiller idéologue MAGA Stephen Miller, est à la manœuvre. L’affaire Jimmy Kimmel illustre cette évolution : sa suspension par Disney a été motivée par des menaces directes de Brendan Carr, président de la Federal Communications Commission (FCC), dans un registre assimilé à une intimidation mafieuse.
Le courant MAGA n’appelle donc pas à revenir à une neutralité des expressions publiques dans le pays, mais à rendre la pareille à une gauche accusée, non seulement d’avoir provoqué le meurtre de Charlie Kirk, mais plus largement d’avoir fait régner ces dernières années une atmosphère de conformisme intellectuel progressiste. Il serait juste à ses yeux qu’au wokisme de gauche succède désormais un « wokisme de droite ». Cette attitude peut surprendre, si l’on se rappelle les propos qu’avait tenus le vice-président Vance lors de son discours à la conférence de Munich en février 2025 : il avait rudement chapitré les Européens sur leurs propres manquements à la liberté d’expression, citant entre autre la condamnation d’opposants à l’IVG en Grande-Bretagne.
Sur fond de violence politique préoccupante
Les responsables trumpistes dénoncent également une violence politique qui viendrait uniquement de la gauche, listant les émeutes de Black Lives Matter en 2020, les nombreux propos et actes antisémites au lendemain du 7 octobre 2023, les deux tentatives d’assassinat contre Donald Trump à l’été 2024, et enfin le meurtre de Charlie Kirk en septembre 2025. Des exemples marquants de violence politique venue de l’extrême droite existent pourtant bel et bien, tels que l’agression à son domicile de Paul Pelosi, mari de Nancy Pelosi, alors speaker de la Chambre des représentants, en octobre 2022 ; ou l’assassinat de l’élue du Minnesota Melissa Hortman en juin 2025. Il reste vain toutefois de vouloir tenir un décompte des violences commises de part et d’autre, d’autant plus que le positionnement politique des auteurs de ces crimes est le plus souvent très difficile à démêler.
Les motivations de l’assassin de Kirk restent d’ailleurs peu claires. il semble qu’il appartenait à une famille conservatrice, mais les médias rapportent qu’il s’était récemment rapproché des causes progressistes, notamment la défense des droits LGBTQ+. Il se peut finalement que le meurtrier relève plutôt de ce que le FBI appelle l’« extrémisme violent nihiliste » (NVE), une catégorie créée récemment par l’agence pour désigner les individus violents dénués d’idéologie cohérente.
Les contre-pouvoirs n’ont pas disparu
Dans un contexte politique très tendu, l’opinion publique et les considérations économiques restent cependant des contre-pouvoirs puissants. Ainsi, la mobilisation de nombreuses personnalités d’Hollywood et de syndicats de scénaristes, ainsi que la perte en quelques jours d’environ 5 milliards de dollars de capitalisation boursière pour Disney, ont a finalement permis le retour de Jimmy Kimmel à l’antenne dès le 23 septembre.
Qui plus est, l’unanimité n’est pas acquise au sein même du mouvement MAGA. Des personnalités conservatrices influentes, telles le sénateur du Texas Ted Cruz, l’ancien présentateur de Fox News Tucker Carlson ou la journaliste conservatrice Megyn Kelly continuent de défendre une conception extensive de la liberté d’expression. D’autres, pour des raisons religieuses, appellent au pardon plutôt qu’à la vengeance contre l’autre camp, comme l’a fait la veuve de Charlie Kirk lors de la cérémonie du 21 septembre.
L’ensemble dessine un système paradoxal. Aux États-Unis, la loi encadre très peu la liberté d’expression ; ce sont les forces sociales et politiques qui imposent des limites au demeurant fluctuantes. L’équilibre du débat public dépend donc davantage de rapports de force culturels, médiatiques et économiques que d’un cadre juridique clair et stable.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
États-Unis : la liberté d’expression face aux attaques du mouvement MAGA
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesVenezuela : un pouvoir affermi
Nicolás Maduro semble plus impopulaire que jamais dans la population vénézuélienne, mais il verrouille aussi de manière toujours plus affirmée le système politique et institutionnel du pays. À l’extérieur, Donald Trump semble engager un nouveau bras de fer avec le gouvernement vénézuélien, dans une logique qui paraît très imprévisible.
De l'IRA à l'OBBA : les entreprises françaises de l'énergie aux États-Unis
Adopté en 2022 sous l’administration Biden, l’Inflation Reduction Act (IRA) a marqué un tournant historique dans la politique énergétique américaine, offrant une visibilité supposée de long terme et attirant les investissements. De 2022 à 2024, les investissements américains dans les énergies propres ont atteint près de 500 milliards de dollars (+ 71 % en deux ans).
Le Brésil à un an des élections générales d’octobre 2026
Les élections générales brésiliennes auront lieu le 4 octobre 2026 afin d’élire le président, le vice-président, les membres du Congrès national, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les assemblées législatives des états de la fédération. Pour les élections du président et des gouverneurs, un second tour sera organisé le 25 octobre si aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages au premier tour.
Visite de Trump au Royaume-Uni : la « relation spéciale » à l’épreuve des faits
La visite d’État du président des États-Unis au Royaume-Uni, du 16 au 18 septembre 2025, a été perçue comme historique avant même d’avoir eu lieu.