Le gouvernement NPP au Sri Lanka : d'un changement de système à une conformité structurelle
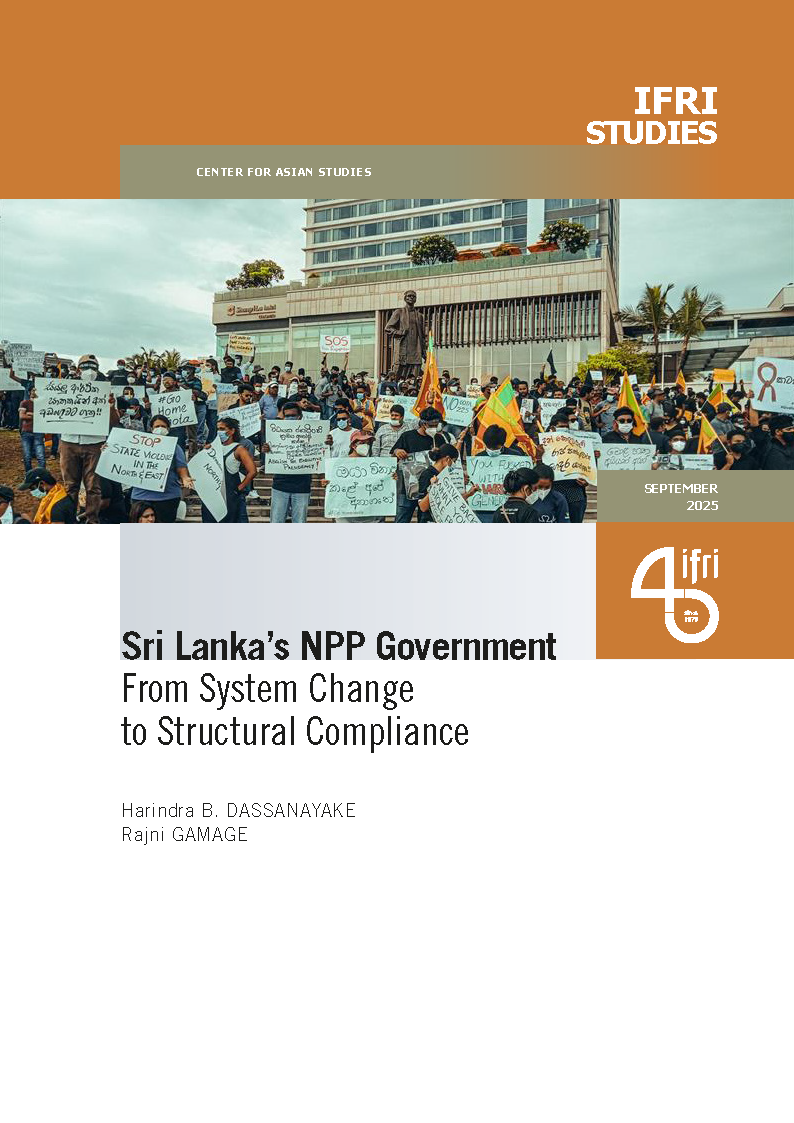
En septembre 2024, Anura Kumara Dissanayake, un outsider relatif dans le système politique sri-lankais dominé par deux partis, a remporté les élections présidentielles. Le mouvement populiste anti-establishment qu'il représentait, le National People's Power (NPP), a ensuite obtenu un mandat écrasant lors des élections générales de novembre 2024, remportant 159 sièges sur les 225 que compte le parlement.

Le National People's Power (NPP) est arrivé au pouvoir lors de la crise économique et des manifestations de 2022, obtenant le soutien massif de la population en présentant la corruption comme la cause profonde du problème. Cela a trouvé un écho auprès de la classe moyenne émergente, fortement anti-establishment, dont les aspirations au développement ont été perturbées par la crise économique.
Lors des élections de novembre 2024, le NPP a remporté une majorité des deux tiers, marquant le déclin rapide de la vieille garde politique dans un contexte d'opposition fragmentée. Les partis minoritaires tamouls et musulmans du nord et de l'est ont perdu du terrain, indiquant un abandon de la politique ethnique au profit d'une arène nationale plus large où les partis s'affrontent entre les communautés. Le succès électoral du NPP repose sur le remplacement des discours ethno-nationalistes par un axe de polarisation politique opposant corruption et lutte contre la corruption.
La situation post-crise économique a facilité un consensus libéral entre les principaux camps politiques en faveur de réformes économiques de marché ouvert menées par le Fonds monétaire international (FMI). La réduction de l'espace réservé aux discours alternatifs a alimenté la montée de la politique populiste.
En décembre 2024, le Sri Lanka a achevé la restructuration bilatérale de sa dette et reporté son remboursement à 2028. Le plus grand créancier bilatéral d'un seul pays est la Chine (4,8 milliards de dollars), suivie des membres du Club de Paris, dont l'Inde (5,8 milliards de dollars). Cependant, la majeure partie de la dette extérieure du Sri Lanka se présente sous la forme d'obligations souveraines internationales (12,5 milliards de dollars).
Le gouvernement intérimaire de 2022-2024 a lancé une période intense de réformes, dont beaucoup ont été formulées en termes technocratiques ; la reprise s'est concentrée exclusivement sur des objectifs budgétaires. Ces réformes ont souvent été mises en œuvre de manière stratégique afin de minimiser l'opposition démocratique. Le gouvernement du NPP poursuit ces réformes, mais à un rythme plus lent.
La croissance fondée sur des infrastructures financées par l'endettement n'étant plus viable, le modèle clientéliste du Sri Lanka est mis à rude épreuve. La capacité limitée de l'État à fournir des ressources par le biais de subventions ou de permis fait que les attentes croissantes d'une classe moyenne ambitieuse ne sont pas satisfaites. Cela risque d'alimenter une plus grande instabilité politique et/ou un autoritarisme accru pour gérer le mécontentement public.
Le gouvernement du NPP a largement poursuivi les politiques macroéconomiques de l'administration précédente. Le programme économique du NPP reflète un discours étatiste axé sur l'industrialisation et la fabrication tirées par les exportations, mais sa faisabilité risque d'être compromise par la pénurie de main-d'œuvre et la volatilité accrue des régimes tarifaires mondiaux sous la présidence américaine de Donald Trump.
Le rôle de l'État sri-lankais dans le développement humain s'amenuise dans le contexte des réformes menées par le FMI et de l'aggravation des inégalités. La pauvreté, l'insécurité alimentaire et la malnutrition infantile se sont aggravées depuis la crise de 2022. Parallèlement, les gouvernements n'ont pas réussi à libérer de l'espace budgétaire pour la protection sociale en réformant l'armée surdimensionnée et les entreprises publiques déficitaires.
La promesse du NPP d'un « changement de système » fait référence à l'établissement d'un nouveau contrat social fondé sur la bonne gouvernance, notamment la responsabilité, la transparence, la lutte contre la corruption et l'État de droit. Son programme phare, Clean Sri Lanka, est conçu pour mettre en œuvre ce programme. Cette promesse d'apporter un changement systémique comprend une nouvelle constitution avec des réformes structurelles clés, telles que l'abolition de la présidence exécutive, des réformes électorales et un partage accru du pouvoir.
La position du gouvernement du NPP sur la responsabilité des crimes de guerre présumés semble privilégier les mécanismes nationaux, reflétant une orientation nationaliste qui donne la priorité à la souveraineté nationale. Le gouvernement a poursuivi sa politique d'opposition à toute résolution internationale visant à impliquer des juges étrangers ou des mécanismes de collecte de preuves.
Les engagements de la politique étrangère du Sri Lanka reflètent les discours concurrents « démocratie contre résultats » bien ancrés au niveau national, alternant entre des gouvernements orientés vers l'Occident, libéraux et démocratiques, favorables au libre marché (axe Inde, Occident et Japon) et ceux favorisant un modèle de développement de type « tigres d'Asie de l'Est », caractérisé par une forte centralisation de l'État (Chine et Singapour).
Les relations étrangères du Sri Lanka avec l'Inde se sont approfondies depuis la crise économique, ouvrant la voie à davantage d'investissements indiens. Cela a conduit à une certaine campagne nationaliste alarmiste menée par un puissant lobby anti-indien, dans la lignée du renouveau des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) et des menaces pesant sur l'État unitaire. Dans le même temps, la réaction de la Chine au rapprochement du Sri Lanka avec l'Inde, notamment à un nouvel accord bilatéral de défense dont les détails n'ont pas été divulgués, n'est pas encore évidente ; toutefois, on observe que la Chine passe de grands projets d'infrastructure à un engagement au niveau communautaire.
L'imposition d'un droit de douane « réciproque » de 20 % par les États-Unis et l'obligation de présenter une nouvelle demande pour bénéficier des avantages commerciaux du système de préférences généralisées plus (SPG+) de l'Union européenne en 2026 remettent en question la dépendance du Sri Lanka à l'égard du commerce et de l'aide occidentaux, dans un contexte d'endettement et de stagnation du développement. Alors que les économies avancées se replient de plus en plus sur elles-mêmes, délaissant la démocratie et le multilatéralisme, le modèle traditionnel de développement axé sur l'aide est remplacé par un discours sécuritaire, qui se reflète dans les tensions géopolitiques croissantes dans l'océan Indien.
Dans un contexte d'intensification des rivalités mondiales entre les puissances, les petits États du Sud, tels que le Sri Lanka, sont confrontés à des discours internes contradictoires, certains prônant un protectionnisme accru, d'autres une intégration plus ouverte vers l'extérieur. Le Sri Lanka participe activement à des forums régionaux tels que l'Association des pays riverains de l'océan Indien (IORA) et l'Initiative du golfe du Bengale pour la coopération technique et économique multisectorielle (BIMSTEC). Cependant, bien que le Sri Lanka ait autrefois défendu des régionalismes alternatifs, tels que la Conférence de Bandung et le Mouvement des pays non alignés, sa fragilité économique actuelle et sa crise de légitimité limitent son influence.
> Cette étude est uniquement disponible en anglais.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesCrise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.

Ouverture du G7 à la Corée du Sud : relever les défis mondiaux contemporains
L'influence mondiale du G7 s'est affaiblie à mesure que des puissances telles que la Chine remodèlent la gouvernance internationale à travers des initiatives telles que les BRICS et l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). Le G7 ne représentant plus aujourd'hui que 10 % de la population mondiale et 28 % du PIB mondial, sa pertinence est de plus en plus remise en question.
Cambodge-Thaïlande : un accord de paix en trompe-l’oeil
Après le Moyen-Orient, Donald Trump a vu en Asie du Sud-Est une nouvelle opportunité de consolider son image de président faiseur de paix. Confirmée à la dernière minute par la Maison-Blanche, sa participation au sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) a ainsi été conditionnée à l’organisation en grande pompe d’une cérémonie de signature d’un accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande.
Le rôle clé de la Chine dans les chaînes de valeur des minerais critiques
La Chine occupe aujourd’hui une position dominante dans les chaînes de valeur des minerais critiques, de l’extraction à la transformation jusqu’aux technologies en aval. Cette suprématie repose sur des décennies de politiques industrielles et lui confère une influence stratégique considérable sur la sécurité d’approvisionnement mondiale, notamment pour l’Union européenne.













