Sous le feu des normes : comment encadrer sans désarmer la défense européenne ?
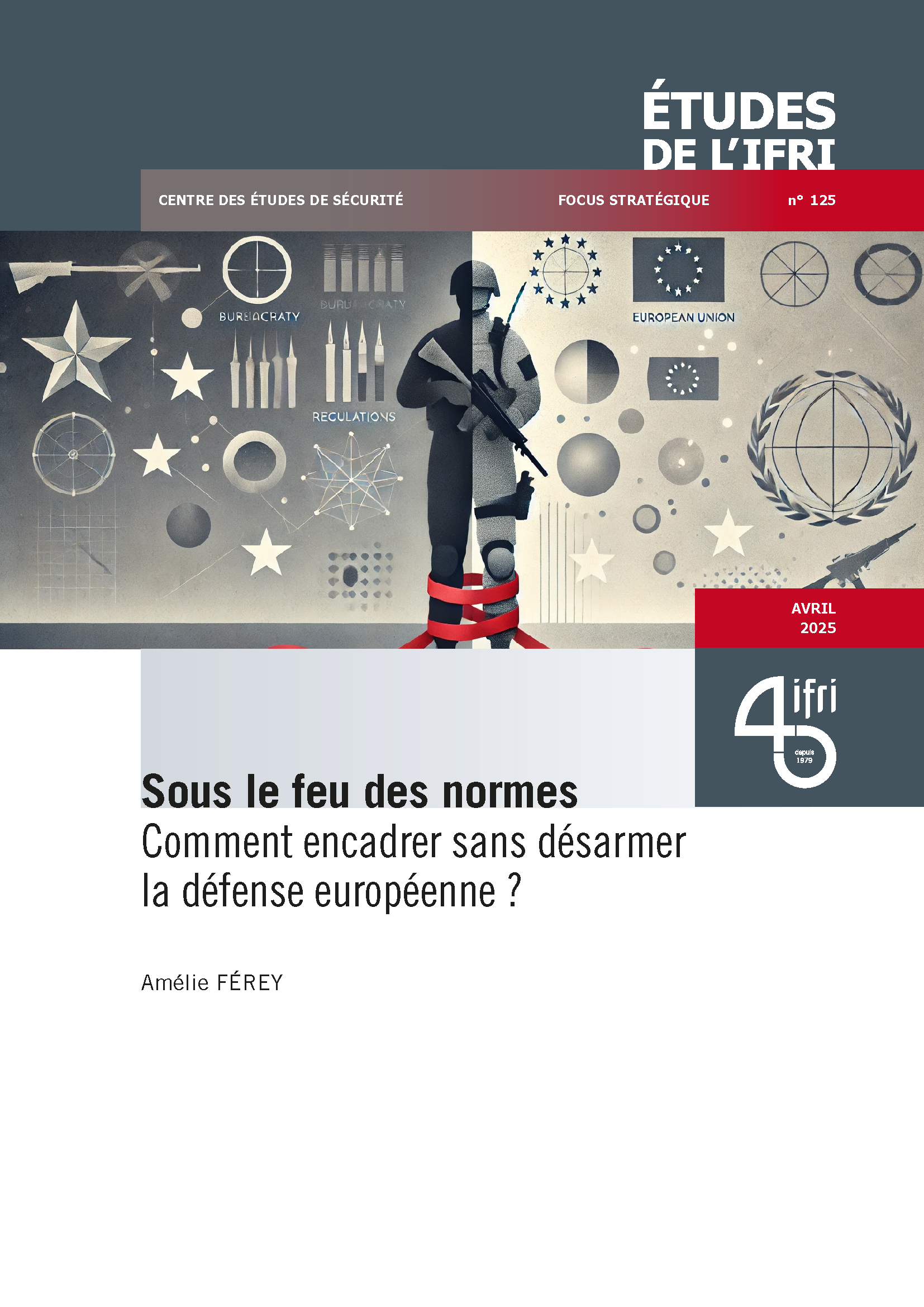
Face à la diversité et la complexité de l’environnement normatif, le secteur de la défense doit pouvoir faire valoir sa singularité militaire. Dépassant une approche par la seule simplification, qui a montré ses limites face au caractère incontournable des normes juridiques et techniques à l’international, un équilibre est nécessaire entre un « trop-plein normatif » et l’absence de normes.

L’une des difficultés réside dans la multiplicité des types de normes impactant le secteur de la défense. Il faut distinguer les normes obligatoires, dont le non-respect expose à des sanctions, des normes volontaires, majoritairement d’ordre technique. Ces dernières peuvent être élaborées dans des instances de normalisation telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou dans des organisations comme l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) et ces fameux STANAG. Les critères ESG/ISR sont quant à eux des incitations qui concernent le fléchage des financements vers des secteurs vertueux de l’économie. Ils sont cruciaux du fait de leur généralisation. Enfin, les labels permettent de signaler la conformité avec certaines normes et/ou valeurs, et complètent cet environnement.
Bien que critiquées dans leur ensemble pour leur rigidité et parfois même leur absurdité, les normes obligatoires et/ou volontaires, lorsqu’elles sont utilisées à bon escient, peuvent offrir des opportunités stratégiques. Elles sont indispensables pour un secteur de la défense compétitif et efficace, permettant l’interopérabilité et la fiabilité des équipements. Elles contribuent également à la légitimité des outils militaires, favorisent la compétitivité et même l’innovation en encourageant la collaboration entre les acteurs du secteur, par exemple dans les groupes de normalisation technique.
Dans un contexte de compétition internationale, le caractère stratégique de la normalisation du secteur de la défense est de plus en plus pris en compte. La France est proactive dans ce domaine, grâce à la coordination interministérielle, à l’aide de l’Agence d’appui à l’interopérabilité et à la normalisation de défense (A2IND), au sein des armées par la Task Force Simplification (TSF) ou en étant présente dans les arènes de normalisation à l’OTAN ou à l’Union européenne (UE). La norme de défense est ainsi appréhendée comme un moyen de promouvoir l’influence française.
D’autres États ont bien compris comment exploiter les normes à leur avantage pour les transformer en puissants instruments géopolitiques puissants, comme l’illustre l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) américain. Quant à elle, l’UE doit se doter d’un mécanisme similaire, exploitant son « effet Bruxelles » pour influencer les réglementations mondiales avec ses propres normes à l’heure où le secteur de la défense est une priorité stratégique pour la Commission.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Sous le feu des normes : comment encadrer sans désarmer la défense européenne ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesCartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est de tirer les enseignements que l'OTAN pourrait tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
L'Europe face au tournant de la DefTech. Repenser l'écosystème européen d'innovation de défense
« La façon dont je vois Iron Dome, c’est l’expression ultime de ce que sera le rôle des États-Unis dans les conflits futurs : non pas être les gendarmes du monde, mais en être l’armurerie », estimait en novembre 2023 Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, l’une des entreprises les plus en vue de la DefTech. L’ambition est claire : participer au réarmement mondial en capitalisant sur la qualité des innovations américaines et dominer le marché de l’armement, au moins occidental, par la maîtrise technologique.
Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.
Vers une nouvelle maîtrise des armements ? Défis et opportunités de l’expiration de New START
Signé en 2010 entre Barack Obama et Dmitri Medvedev pendant une période de détente entre les deux grandes puissances, New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) devrait – sauf revirement de dernière minute – expirer le 5 février 2026. Héritier des grands traités de réduction des armements stratégiques de la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, ce traité a permis de réduire les arsenaux nucléaires russes et américains de plus de 30 % par rapport au début du XXIe siècle, en instaurant des limites quantitatives sur le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées – c’est-à-dire immédiatement utilisables – et des mécanismes de transparence et de vérification mutuelles.















