Comprendre les villes intermédiaires au Nigeria. Les cas d'Ibadan et d'Abeokuta
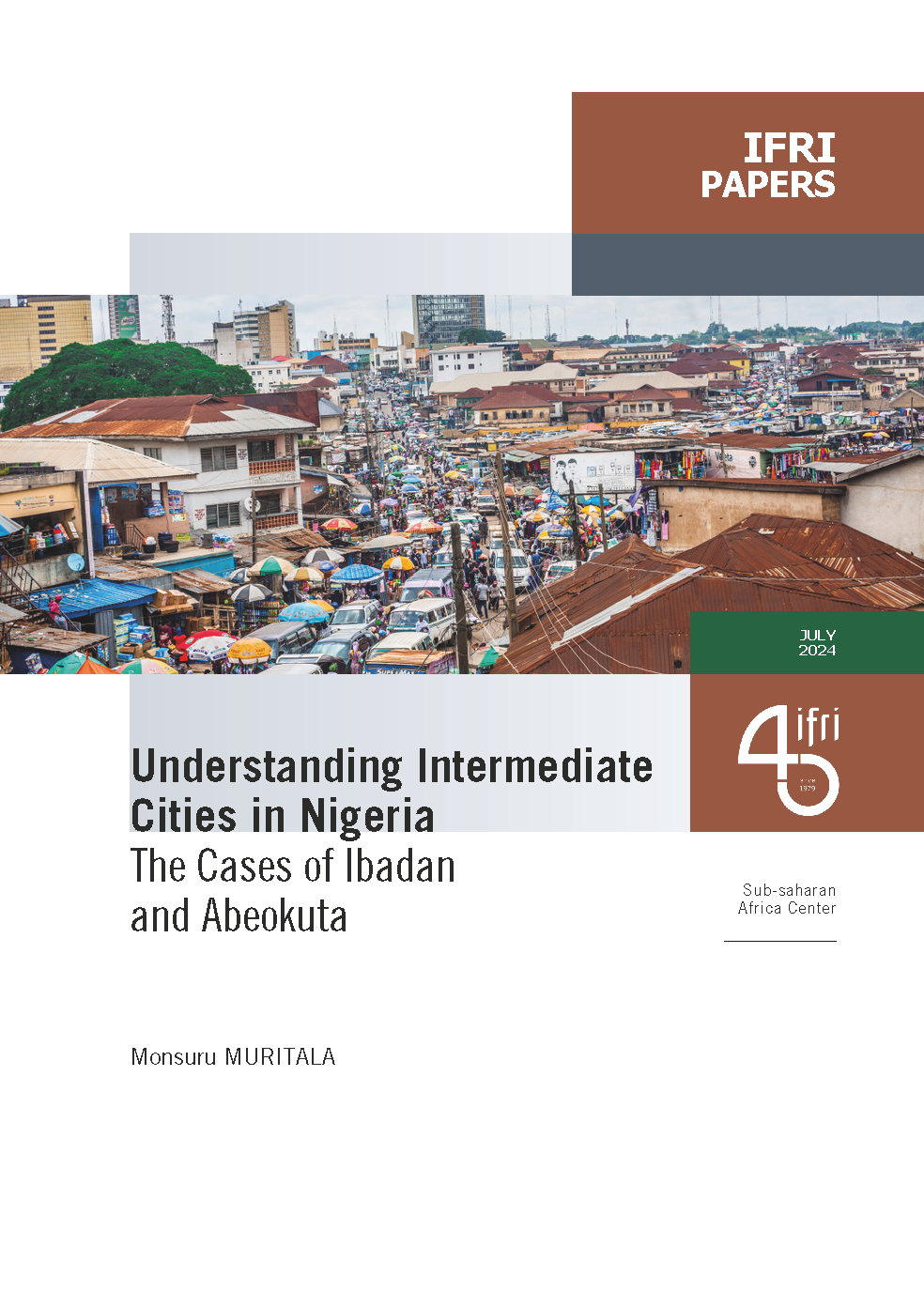
Le Nigeria est connu pour sa rapide croissance démographique et urbaine.

L’attention des médias et des chercheurs s’est concentrée sur l’expansion impressionnante de la mégalopole nigériane de Lagos, dont la population devrait passer de 16 millions d’habitants en 2024 à environ 40 millions en 2035. Par conséquent, il existe moins de données sur les autres catégories de villes au Nigeria, telles que les villes intermédiaires ou secondaires. Pourtant, des recherches plus récentes sur la dynamique de l’urbanisation en Afrique ont mis en évidence les taux de croissance urbaine relativement plus élevés dans les villes dites « intermédiaires ».
Cet papier contribue au débat et vise à fournir une perspective différente sur l’urbanisation au Nigeria : basée sur une approche historique, cette Note de l’Ifri évalue le développement de deux villes-satellites intermédiaires de Lagos : Abeokuta et Ibadan. Elle soutient que Lagos n’est pas une ville autonome mais qu’elle s’appuie sur un réseau urbain plus large composé de villes intermédiaires.
Le papier présente le développement historique d’Ibadan et d’Abeokuta, dont l’évolution est allée de pair avec la croissance de Lagos. Il montre que les infrastructures de transport, établies depuis la période coloniale, ont joué un rôle clé dans les relations entre ces villes.
Cette publication est disponible uniquement en anglais : Understanding Intermediate Cities in Nigeria: The Cases of Ibadan and Abeokuta.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa politique russe de recrutement de combattants et d’ouvrières en Afrique subsaharienne
La guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022, s’est rapidement internationalisée. La Russie et l’Ukraine se sont très vite efforcées de mobiliser leurs alliés afin d’obtenir un soutien politique et diplomatique, ainsi que des ressources militaires et économiques. Mais les deux belligérants ont aussi cherché à recruter des étrangers à titre privé pour soutenir leurs efforts de guerre respectifs. Cette politique est globale et s’étend de l’Amérique latine à l’Extrême-Orient. L’Afrique subsaharienne, dans ce panorama, présente un intérêt particulier car elle constitue un vivier de recrutement vaste et facilement accessible, en raison de taux de pauvreté élevés dans la plupart des pays de la zone conjugués à un important désir d’émigration.
Jeunesses et mobilisations en ligne au Mozambique : vers une redéfinition de l’espace public ?
Cette recherche explore la manière dont les jeunesses mozambicaines investissent les espaces numériques pour contourner les canaux traditionnels de participation politique et sociale. À travers une analyse des mobilisations en ligne, notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et WhatsApp, il met en lumière les nouvelles formes d’engagement qui remettent en question le monopole de l’État sur la parole publique et l’agenda politique.
Revendiquer “le peuple” : explosions démographiques de la jeunesse, dirigeants autoritaires affaiblis et politiques “populistes” au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie
Cette étude analyse l’émergence de tendances politiques qualifiées de « populistes » dans trois pays d’Afrique de l’Est : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Elle s’ancre dans une discussion plus large autour de la notion de « populisme », en interrogeant son usage et sa pertinence dans les contextes africains (et plus spécifiquement est-africains), avant d’examiner les dynamiques propres à trois cas emblématiques : la victoire électorale de William Ruto en 2022 au Kenya et sa rhétorique de la « Hustler Nation » ; l’opposition portée par Bobi Wine face à Yoweri Museveni en Ouganda ; et le style de gouvernement fortement personnalisé de John Magufuli en Tanzanie.
Gabon : un modèle politique issu d’une transition (presque) exemplaire ?
Les 27 septembre et 11 octobre 2025, les citoyens gabonais élisent dans un scrutin à deux tours à la fois les pouvoirs municipaux et les députés de la nouvelle Assemblée nationale. Il s’agit de l’étape presque ultime d’une transition politique qui s’approche de sa fin, un peu plus de deux ans après le coup d’État ayant renversé le régime dynastique plus que trentenaire des Bongo, celui du père, Omar, mort au pouvoir en 2009, puis celui de son fils, Ali, maintenant en exil.













