Incursion de drones russes : « L’OTAN a une nouvelle ambition : passer de la logique de police du ciel à celle de défense aérienne »
La chercheuse Amélie Zima expose, dans une tribune au « Monde », les solutions dont dispose l’Alliance atlantique face à la violation de l’espace aérien européen par des engins russes, afin d’adopter une réponse ferme face à la Russie, sans pour autant entraîner d’escalade.
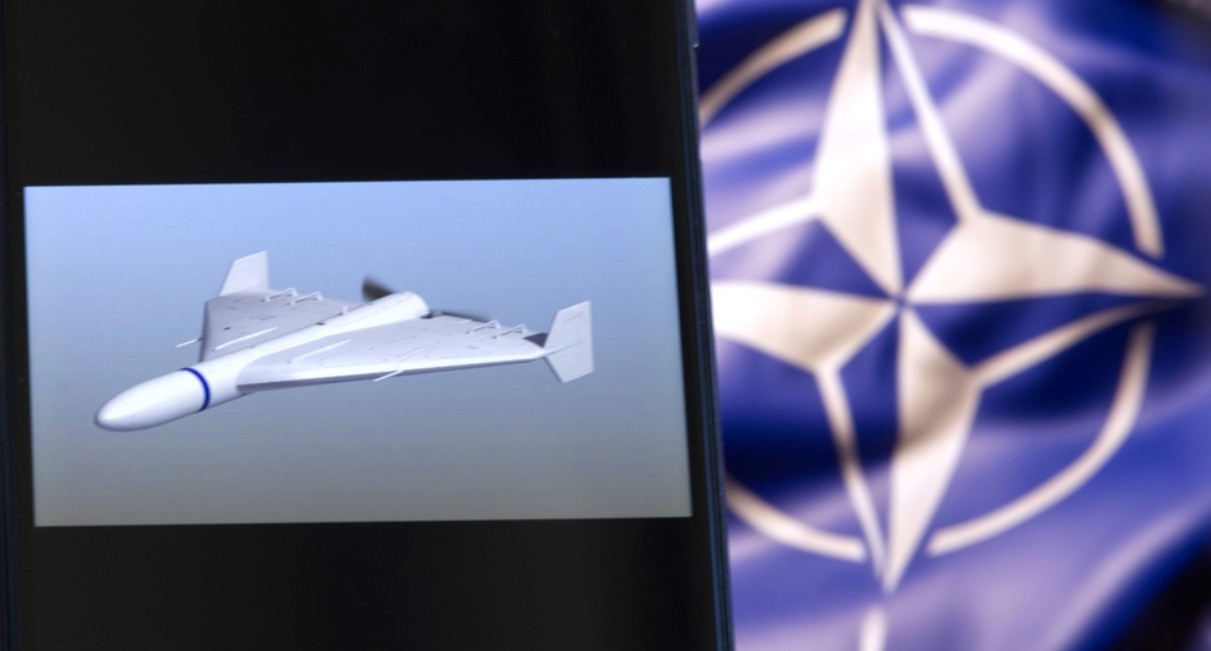
Les incursions et violations de l’espace aérien des pays d’Europe centrale et orientale par des aéronefs russes interrogent le rôle de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et ses missions de dissuasion conventionnelle et de protection. Est-elle outillée pour répondre à ces atteintes répétées à la souveraineté de ses Etats membres ? Comment faire évoluer et adapter ses missions afin que la dissuasion garde toute sa pertinence ?
Face à ces infractions, il s’agit d’abord de déterminer ce qui est du ressort de l’OTAN. Le survol de l’aéroport de Copenhague par des quadrirotors ne relève pas de la défense aérienne de l’Alliance, mais d’une mission de police. La violation de l’espace aérien estonien par des avions de chasse russes, elle, est clairement du ressort de l’OTAN pour une mission qualifiée de « police du ciel ».
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que les incursions, les violations et les vols sans transpondeurs d’aéronefs russes sont récurrents dans tous les pays de l’Est européen depuis plus d’une quinzaine d’années. Il ne s’agit donc pas de provocations inédites mais d’une accélération, d’autant plus qu’elles ont été suivies par d’autres violations, en Belgique et en Allemagne.
Posture de dissuasion efficace
D’autre part, il est nécessaire de rappeler le cadre d’action de l’OTAN. L’Alliance atlantique n’est pas en guerre et respecte donc les règles d’engagement du temps de paix. De fait, lorsqu’un aéronef russe viole l’espace aérien d’un Etat membre, la réponse immédiate n’est pas le tir mais la prise d’informations sur l’intrus, la tentative de dialogue et l’escorte hors de l’espace aérien. Il est à noter qu’aucune situation n’a justifié des actions supplémentaires telles que des tirs de sommation et, a fortiori, l’ouverture du feu.
Ces actions de l’OTAN s’inscrivent par conséquent dans le cadre de la police du ciel. Mise en en place en 2004 pour les États baltes lorsque ces derniers sont devenus membres de l’Alliance, elle a été renforcée en 2014, puis en 2022. Face à la dégradation de l’environnement de sécurité européen consécutive à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie cette année-là, d’autres missions ont été instaurées dans la région telles « Baltic Sentry » et « Eastern Sentry », dans le but de maintenir une posture de dissuasion efficace.
Désormais, l’OTAN affiche une nouvelle ambition : changer de posture en passant d’une logique de police du ciel à une posture de défense aérienne. Perceptible dans les discours du nouveau commandant suprême des forces alliées en Europe, le général américain Alexus G. Grynkewich, ce changement n’est pas purement rhétorique mais suppose deux évolutions très concrètes.
D’abord, harmoniser les règles d’engagement de la myriade de missions OTAN sur le flanc est de l’Europe et, ensuite, libérer les restrictions établies par les Etats membres. Ces derniers peuvent en effet établir des limites à l’action de l’OTAN, qu’ils soient nation contributrice, par exemple un État qui affecte ses avions de chasse pour les missions de police du ciel, ou nation hôte, capable de réglementer l’ouverture du feu sur son territoire terrestre, aérien ou maritime.
Actions concrètes
Le changement de logique supposerait de passer d’une autorisation au cas par cas à une autorisation permanente, avec droit de veto de l’Etat contributeur et de la nation hôte. Ces transferts de souveraineté des Etats vers l’organisation dont ils sont membres donneraient davantage de latitude à l’action de l’OTAN. La posture plus ferme de l’OTAN correspond aussi aux attentes des pays de l’Est. Ainsi le premier ministre polonais, Donald Tusk, qui avait demandé l’activation de l’article 4 de l’OTAN suite aux incursions de drones, ne voulait pas que le soutien de l’Alliance soit uniquement rhétorique mais demandait des actions concrètes.
Enfin, le dernier volet de la réponse OTAN suppose une évolution capacitaire. L’utilisation d’avions de chasse de la police du ciel, des F-35 néerlandais, et de l’armée de l’air polonaise, des F-16, pour contrer l’incursion d’au moins 19 drones a pu être critiquée au vu de la disproportion des coûts entre l’offensive – les drones russes – et la défensive – des aéronefs et missiles occidentaux pour un coût total de plusieurs millions d’euros. Cette réponse a néanmoins démontré la détermination de l’Alliance atlantique. Il fallait un signal politique et symbolique fort d’unité et de solidarité face à l’agression, quitte à « y mettre les moyens ». Mais cette option est insoutenable à moyen terme : un rythme soutenu de violations serait économiquement ruineux et pourrait conduire à vider les arsenaux de munitions complexes.
[...]
Amélie Zima est docteure en science politique et responsable du programme sécurité européenne et transatlantique de l’Institut français des relations internationales.
> Lire la tribune dans son intégralité sur le site du Monde.

Média
Format
Partager








