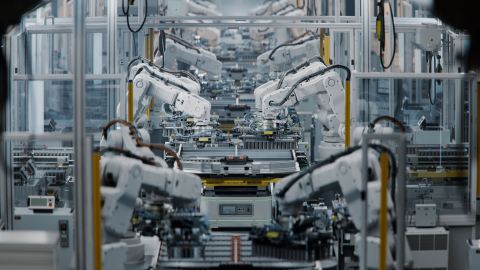Trump, Poutine, l’Europe, l’IA : Thomas Gomart et Giuliano da Empoli et décryptent le chaos du monde
À l’occasion du bicentenaire du Figaro, Thomas Gomart, directeur de l'Ifri, et l'écrivain Giuliano da Empoli étaient réunis au Grand Palais pour une conversation sur la nouvelle donne géopolitique. Face aux velléités néo-impériales de Donald Trump, à la menace russe et aux prédateurs de la tech, ils dessinent les contours d’un possible réveil européen.

*Écrivain, Giuliano da Empoli a notamment publié « Le Mage du Kremlin » (Gallimard, 2022, grand prix du roman de l’Académie française) et « L’Heure des prédateurs » (Gallimard, 2025).
Directeur de l’Institut français des relations internationales (Ifri), Thomas Gomart publie le 22 janvier « Qui contrôle qui : les nouveaux rapports de force mondiaux » (Tallandier).
LE FIGARO. - Vous qui observez de près la marche du monde : en Iran, au Groenland, à Gaza, en Ukraine… Que vous inspire la situation actuelle ? Comment qualifieriez-vous l’état du monde ?
GIULIANO DA EMPOLI. - Nous assistons au retour de la prime à l’offensive. Dans l’histoire, il y a des phases dans lesquelles - et c’est en partie lié au développement de la technologie - c’est l’offensive qui prime, c’est-à-dire la transgression, le fait de casser les codes, de briser les règles ou encore de passer à l’attaque. A contrario, il y a des phases où il est avantageux d’être sur la défensive, et ces dernières sont évidemment plus stables. Étant italien moi-même, cette période me fait penser au début du XVIe siècle en Italie, lorsque tous les petits États très civilisés de la Renaissance ont été balayés. C’est l’époque des prédateurs que Machiavel a décrite. Il me semble qu’aujourd’hui, même si les circonstances sont différentes et plus globales, nous sommes à nouveau plongés dans une phase de ce type.
"Nous faisons face à un moment très particulier de collusion idéologique entre la Maison-Blanche et le Kremlin, qui produit un schisme transatlantique auquel nous ne sommes absolument pas préparés et qui rebat complètement les cartes", Thomas Gomart
On retient les mots de « transgression », de « prédateurs ». Pour vous, Thomas Gomart, comment se caractérise la situation actuelle ?
THOMAS GOMART. - Tout est sous contrôle ! C’est évidemment une mauvaise plaisanterie. Je répondrai en m’appuyant davantage sur mon expérience que sur la théorie. J’ai fait mes armes en Russie et aujourd’hui, lorsque je suis aux États-Unis, à Washington - j’y ai fait une longue mission au mois de décembre -, j’entends l’écho de nos discussions à Moscou en 2012. C’est-à-dire, au fond, une remise en cause assez fondamentale, avec un discours de la sphère Maga qui consiste à dire : « L’Europe est déviante. Nous devons vous sauver de vous-mêmes. »
Nous faisons face à un moment très particulier de collusion idéologique entre la Maison-Blanche et le Kremlin, qui produit un schisme transatlantique auquel nous ne sommes absolument pas préparés et qui rebat complètement les cartes. Dans ce contexte de « prime à l’offensive », il faut essayer de comprendre la nouvelle chimie entre le monde réel et le monde numérique : où sont les interfaces et comment ces interfaces entre le réel et le numérique fonctionnent-elles ? Surtout, qui les contrôle ?
Ce que vous décrivez est aussi une transgression par rapport à l’ordre transatlantique établi. Mais qui dirige le monde aujourd’hui ? Est-ce Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine ? Ou bien est-ce une erreur de perspective que de penser cela ?
G. D. E. - Aujourd’hui, aux côtés des acteurs politiques que vous avez évoqués, il est indispensable de prendre également en compte les acteurs de la tech. Ces derniers sont, il me semble, tout aussi importants : ils sont d’ailleurs de plus en plus présents dans les questions géopolitiques, dans la guerre et dans le renseignement.
Ils sont même les maîtres de la nouvelle réalité. Au cours des dernières décennies, ce ne sont pas seulement la vie politique et le débat public qui ont évolué, mais l’ensemble de nos vies. Notre quotidien, nos habitudes, nos modes de consommation et nos relations ont basculé dans le numérique. Ce dernier peut aujourd’hui être vu et compris comme un autre territoire qui se superpose et devient parfois plus important que le territoire physique. Et ce sont bien les géants de la tech qui le contrôlent et qui en déterminent les règles.
Comment ces acteurs ont-ils rejoint le camp des prédateurs ?
G. D. E. - On pourrait croire qu’aujourd’hui les acteurs du numérique sont proches de Trump car Trump est au pouvoir, comme ils l’étaient auparavant d’Obama. Dans cette perspective, ces derniers constitueraient simplement de nouvelles élites économiques, comme c’est arrivé à toute époque, qui essayent de s’accorder et de trouver un équilibre avec le pouvoir politique. Mais il y a quelque chose en plus. Ces nouveaux acteurs politiques, Trump en premier lieu, et les gens de la tech sont le fruit de la même révolution, du même processus qui fait que l’on modifie les règles du jeu, que l’on mise sur l’agression, la disruption, la vitesse. C’est d’ailleurs ce qui fait le charme ou la force de Trump : c’est quelqu’un qui, dans des contextes qui semblent bloqués ou immobiles, agit. Et les acteurs de la tech rêvent comme lui d’un système à l’intérieur duquel leurs actions ne seraient pas entravées par des lenteurs, des contre-pouvoirs, des procédures - soit tout ce qui constitue la démocratie libérale telle que nous la connaissons.
Thomas Gomart, entre les empereurs traditionnels et ces nouveaux seigneurs de la tech, qui contrôle qui ?
T. G. - Il y a aujourd’hui 1,8 milliard de propriétaires d’iPhone et 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Ce simple chiffre montre que le couple homme-machine, que l’on voyait comme un sujet de science-fiction, est déjà là. La maîtrise de la technologie est donc, à mon avis, l’un des points les plus importants à prendre en compte pour savoir qui contrôle qui.
Ce qui distingue les empereurs, au sens politique du terme, des grands de la technologie, ce sont les éléments de puissance étatique, et leur capacité de passage à l’acte. Vladimir Poutine est passé à l’acte : il l’avait annoncé, on ne l’a pas écouté et il a agi. Idem pour Donald Trump, même si cela est fait très différemment. L’effet produit par la capture de Maduro, à mon sens, n’est pas du tout le même que celui qui a suivi la décision prise par Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine en février 2022. Le président Xi va-t-il passer à l’acte dans ce registre ou dans un autre ? C’est évidemment une question à laquelle nous réfléchissons.
Et en ce qui concerne les patrons de la tech - Evgeny Morozov les appelle les « intellectuels- oligarques » -, il y a quelque chose de fascinant à observer : c’est la prétention philosophique d’un certain nombre d’entre eux. Peter Thiel, le fondateur de Palantir, un homme absolument clé dans l’ascension du vice-président américain J.D. Vance, a une prétention philosophique et se réclame de René Girard. Alex Karp, l’actuel patron de Palantir, a également une formation philosophique et se réclame de Habermas. Or, quand vous avez autant d’argent, autant de prétentions et de tels moyens de communication, ça vous donne beaucoup de contrôle sur les autres.
Peter Thiel, en 2009, doutait du fait que la liberté et la démocratie puissent être compatibles. Dans cet écosystème, où est le populisme ? Quel rôle joue-t-il dans cette nouvelle chimie du pouvoir ?
G. D. E. - L’agenda des populistes et celui des seigneurs de la tech ne sont pas les mêmes. On le constate très clairement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Il y a seulement quelques semaines de cela, s’est tenu à Londres un grand rassemblement d’admirateurs de Tommy Robinson - un leader national-populiste très radical et raciste. Elon Musk, qui participait au meeting à distance, y a fait un discours. Il a d’abord déclaré que face à la violence de ses adversaires politiques il fallait réagir, c’est-à-dire dissoudre le gouvernement, le Parlement, et faire une véritable révolution populaire. Mais lorsqu’on lui a demandé ce qu’il imaginait pour le futur, il a parlé de robots omniprésents et a évoqué une sorte de futur à la Star Trek. Le public, qui était plutôt nationaliste et traditionaliste, n’a évidemment pas été emballé par la vision du futur de Musk.
Ce partage, on le retrouve aux États-Unis, où les soutiens de Trump se divisent : il y a les populistes qui le soutiennent pour le retour à une certaine forme de tradition, d’autorité, de valeurs ; et puis il y a les gens de la tech. Eux ne sont pas du tout là-dedans, à quelques exceptions près. En règle générale, ils sont déjà post-humains et ne pensent pas à l’avenir des nations en ces termes.
L’horizon n’a donc pas beaucoup d’importance. Lorsque plusieurs personnes veulent faire la révolution, ils ont certainement des objectifs différents, mais ce qui compte surtout est l’objet à abattre. Dans ce cas précis, tous veulent abattre les vieilles élites, les vieux politiques - c’est-à-dire les démocrates mais aussi le vieil establishment républicain -, les contre-pouvoirs, les médias traditionnels et un certain nombre de règles et de lois. Pour l’heure, c’est cette convergence qui fait leur force.
Est-ce que le populisme mène nécessairement à l’autoritarisme ?
T. G. - Si l’on se focalise un instant sur les patrons de la tech et leur traduction politique, on comprend qu’ils parlent à une multitude connectée d’où émergera un petit nombre d’élus augmentés. Un phénomène de séparatisme d’en haut est en train de se créer et cela a des effets politiques pour le monde d’en bas. La force politique de Donald Trump réside dans le fait d’avoir réussi à construire un discours futuro-identitaire. Concrètement, il a senti à quel point sa base électorale était déclassée par la mondialisation telle que cette dernière a fonctionné. Son alliance avec Musk et compagnie, c’est encore une nouvelle frontière, c’est-à-dire, une écriture du futur, une projection dans le futur - avec Mars par exemple -, même si cela nous paraît irréel.
En Europe, on retrouve la dimension identitaire et les forces populistes, mais on n’a pas cette dimension futuriste, ou alors avec un discours très défensif. La raison à cela est assez simple : on ne contrôle pas les outils qui nous permettraient d’écrire ce futur. C’est une différence fondamentale.
Selon vous, l’Europe est donc hors jeu dans cette nouvelle mécanique du pouvoir ?
T. G. - Il est toujours facile de critiquer l’Europe, en raison de son mode de fonctionnement institutionnel. Et en même temps - nous avons réalisé récemment des travaux à ce sujet - il n’y a pas d’innovation technologique aux États-Unis qui, d’une manière ou d’une autre, ne passe par l’Europe. Lorsque vous regardez où recrutent Palantir ou d’autres entreprises de la tech, une quantité significative de talents vient d’Europe. Cette dernière a de vraies capacités technologiques et scientifiques, à condition de continuer à investir. Et à condition de continuer à former aux mathématiques et aux humanités…
Il y a aussi de grandes différences de niveau d’investissement dans l’intelligence artificielle. Les États-Unis sont très loin devant le reste du monde, y compris la Chine.
T. G. - Oui, mais vous pouvez avoir beaucoup d’argent et mal l’utiliser. Le vrai sujet peut être résumé ainsi : lorsqu’on a de la ressource, comment doit-on l’orienter pour la rendre la plus efficace possible ? Les volumes, c’est évidemment important car ce sont des ordres de grandeur, mais il ne faut pas être paralysé par des graphes impressionnants. L’Europe continue à produire de la science et de la technologie et à mon avis, elle doit valoriser sa plasticité. Mais l’investissement requiert de croire dans le futur.
Il y a tout de même un effort assez transparent de vassalisation de l’Europe de la part de l’Administration américaine. Giuliano da Empoli, notre vassalisation est-elle devenue simplement officielle ou s’est-elle aggravée ?
G. D. E. - C’est un peu des deux. Quelque chose d’implicite est devenu progressivement explicite : nous étions déjà dépendants et déjà vassalisés sur le plan militaire et sur le plan technologique, mais nous mettions les formes, ce qui n’est plus le cas. Parallèlement, nous constatons aussi une accélération du processus.
On peut y voir un projet néo-impérial, mais pas seulement. Pour Trump, l’Europe est, d’une certaine façon, une extension de la guerre culturelle intérieure. Dans son acharnement, il n’y a pas qu’une composante rationnelle. Si l’Administration américaine sait raison garder avec d’autres parties du monde, qu’elle traite de façon plus équilibrée, elle a avec l’Europe une attitude fortement dictée par l’idéologie. C’est lié au fait qu’ils la voient comme une extension de ce qu’ils combattent à l’intérieur de leur pays. L’Europe devient à leurs yeux l’extension des démocrates américains, des vieilles élites américaines et même des élites républicaines qui sont traditionnellement transatlantiques. C’est pourquoi l’issue de ce combat en Europe sera fortement liée à ce qui se passera à l’intérieur du système politique américain, où des choses assez radicales peuvent se produire.
« Je pense que les Européens sont faibles » car « ils veulent être trop politiquement corrects » et « ne savent donc pas quoi faire » , affirme d’un côté Donald Trump, quand Vladimir Poutine parle des « porcelets européens » qui « se sont joints à l’ancienne Administration américaine dans l’espoir de tirer profit de l’effondrement » de la Russie. Ces deux visions de l’Europe se font écho finalement. Est-ce qu’il faut nous en inquiéter ou est-ce l’écume des choses ?
T. G. - Il faut évidemment s’en inquiéter et analyser ces deux visions ensemble, mais sans les mettre sur le même plan. En comparant l’efficacité militaire de la Russie et l’efficacité militaire d’Israël, le président Poutine devrait être plus prudent dans son expression : prendre au bout de quatre ans un cinquième du territoire ukrainien avec 1,2 million de pertes - tués, blessés et disparus -, n’est pas forcément un exemple de puissance. Ou alors c’est un usage de la puissance qui se rattache à une vieille tradition russe et soviétique qui considère que le soldat russe est une denrée inépuisable.
En dépit de leur collusion idéologique, c’est une erreur de mettre sur le même plan la Russie d’aujourd’hui et les États-Unis. Donald Trump fait quelque chose d’assez redoutable pour les « autoritaires » et ce qu’on appelle improprement le « Sud global » - je préfère l’appeler le « Sud transactionnel » - : il les prive de l’argument de l’hypocrisie occidentale. La diplomatie russe a beaucoup insisté sur le fameux deux poids, deux mesures. Aujourd’hui, il n’y a plus de deux poids, deux mesures car Trump fait ce qu’il dit et il passe à l’acte de manière obscène. Cela trouble tout l’argumentaire construit ces dernières décennies sur l’hypocrisie occidentale. Les États-Unis ne sont plus hypocrites, mais peut-être que les Européens le demeurent.
Les Européens persistent à dire qu’ils ne sont pas en guerre avec la Russie alors que Poutine ne cesse de dire qu’il est en guerre avec les Européens. Vit-on dans un monde virtuel ou doit-on camper sur cette ligne de non-agressivité ?
T. G. - En Ukraine, il y a aujourd’hui quatre belligérants : la Russie, dans sa posture d’agression, l’Ukraine, la Biélorussie et la Corée du Nord. Les pays européens ne sont pas en guerre, ils sont obligés de se préparer, de soutenir l’Ukraine dans son droit à légitime défense. J’appartiens à ceux qui considèrent que nous n’avons pas su lire l’annexion de la Crimée en 2014 dans ce qu’elle indiquait du changement de trajectoire de la Russie, avec le retour au Kremlin de Vladimir Poutine en 2012 et le changement constitutionnel. Dans Le Mage du Kremlin, Giuliano da Empoli décrit de manière extrêmement fine le système russe dans son mode de fonctionnement : ce pays a toujours été dirigé par ceux qui le possédaient au sens physique et financier du terme. Avec Vladimir Poutine, il y a aussi cette acceptation des pertes humaines et le ciblage des civils ; en bref, un retour assumé à la violence physique. C’est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour nous, Européens, qui avons écarté les questions militaires depuis maintenant plusieurs décennies. Nous sommes stupéfaits et cela explique notre très grande difficulté à réagir : nous donnons l’impression de craindre davantage une escalade avec la Russie, qu’une défaite de l’Ukraine.
On entend cette phrase à Moscou : « Notre vraie guerre est contre les Occidentaux, contre les Européens » . Giuliano da Empoli, faut-il prendre cela au pied de la lettre ?
G. D. E. - En vérité, dans le parcours de Poutine, la guerre joue un rôle fondateur. Poutine n’aurait pas acquis son statut de chef vertical et d’autorité en Russie s’il n’y avait pas eu, dès le départ, la menace du terrorisme tchétchène à Moscou et la guerre de Tchétchénie. D’ailleurs, le personnage dont je me suis inspiré dans Le Mage du Kremlin et qui existe réellement, Vladislav Sourkov, avait fait un entretien peu avant le déclenchement de l’invasion d’Ukraine fin 2021 où il expliquait que chaque système clos produit de l’entropie. Chaque système politique est ainsi destiné d’une certaine manière à produire son propre chaos. Et les empires gèrent cela en exportant le chaos aux frontières - cela est vrai pour tous les empires dans l’histoire. Poutine l’a fait, et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est difficile d’imaginer qu’il s’arrête.
L’Europe est remise en cause dans son essence : cette entité, construite comme un soft power triomphant, commercial, culturel, doit-elle donc se remettre en question ?
T. G. - C’est certain, et urgemment. En Europe, nous avons oublié la vitesse et la rigueur d’exécution. Nous sommes à plus de quatre ans depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022 : le réveil a déjà sonné à plusieurs reprises. Il va donc falloir être capable de penser notre relation avec la Russie, avec Poutine et après Poutine. Car ce qu’il propose aujourd’hui à son peuple, c’est la continuation de la Grande Guerre patriotique. Or, la Russie est aujourd’hui le centre de gravité de l’insécurité de l’Europe. Quand on voit un tel niveau de violence infligé au corps social ukrainien, et indirectement au corps social russe, on sait que cela va irradier pendant au moins une ou deux décennies. Les anciens combattants, à la fois en Ukraine et en Russie, vont jouer un rôle majeur. Tout le monde en Europe espère un arrêt du conflit. Pour l’heure, Poutine refuse un cessez-le-feu.
Pour les Européens, les décennies de désarmement structurel coûtent cher. Nous désarmons depuis le début des années 1970. Nos dépenses militaires représentaient alors 3 % à 4 % du PIB et nous devons tout à coup faire un effort très important. Cet effort n’est pas exigé seulement par Trump mais aussi par les Administrations américaines précédentes. Le message est clair : il va falloir que vous assumiez davantage votre sécurité et votre défense, tout en restant sous contrôle.
L’argument est assez imparable : comment se fait-il que 500 millions de personnes, parmi les plus riches au monde, comptent sur 350 millions d’Américains pour se protéger contre 140 millions de Russes ? Tant que les Européens ne comprendront pas que leur destinée réside surtout dans le fait d’être capables de produire leur propre sécurité, ils resteront dans une situation de vassalisation.
Quid de la menace américaine ? Les deux mots sont un peu contre-intuitifs, mais on voit les Européens dépêcher quelques uniformes sur la banquise au Groenland dans l’espoir de dissuader Donald Trump de prendre de force ce territoire…
G. D. E. - Une chose m’embête dans la situation européenne actuelle. Curtis Yarvin, qui est un penseur assez influent, un peu étrange, qui gravite dans le monde de Trump, a une image pour décrire le comportement de Trump. Il explique que la stratégie de Trump au cours de cette dernière année est comparable à celle de quelqu’un qui entre dans une salle avec toute une série d’interlocuteurs et qui se comporte comme s’il avait tous les droits et tous les pouvoirs.
Si vous agissez ainsi, il est tout à fait possible que les gens se comportent comme si c’était vrai et qu’ils se plient à votre volonté. Il me semble que, s’agissant d’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, c’est exactement le contraire. Concrètement, sur toute une série de sujets conflictuels – comme le commerce international ou la régulation du numérique – elle a beaucoup plus de pouvoir que ce qu’elle n’exerce. Ce que je souhaiterais, même si c’est un rêve, c’est qu’elle les exerce. Cette incapacité de la décision est presque intrinsèque au système européen, car c’est un système de consensus, de règles, un système à 27 et qui ne peut donc avoir l’immédiateté de la décision Trump.
Comment l’Europe doit-elle renforcer son pouvoir ?
T. G. - Bon nombre de dirigeants européens ont mis en place une stratégie de prosternation. Seul un petit territoire de 500 mètres carrés, au cœur de Rome, le Vatican, a été capable de construire une opposition intellectuelle aux États-Unis de Donald Trump. Rappelons qu’au cours de son premier mandat, le président américain avait été reçu par le pape François, qui lui avait réservé un accueil glacial. En février 2025, sa lettre aux évêques américains sur les questions migratoires est une opposition morale fondamentale. En retour, le vice-président des États-Unis, J. D. Vance, catholique converti, avait tenté, de manière symbolique, de forcer les portes du Vatican pour être reçu par le pape François la veille de sa mort. Entre les dirigeants occidentaux et le souverain pontife, nous assistons au choc de deux temporalités. Et aujourd’hui Léon XIV, 267e pape élu, produit un discours sur l’humanisme à l’ère numérique qui s’adresse aux fidèles mais aussi aux seigneurs de la tech.
Le contraste avec l’Europe est saisissant : le spectacle qu’on y voit est parfois navrant. L’accord de Turnberry signé avec les États-Unis en juillet dernier revêt une symbolique très lourde pour les Européens. Il y a un grand chantier intellectuel à mener pour se demander quel type d’humanisme nous voulons à l’ère numérique et ce que nous sommes capables de produire comme philosophie, fiction et imaginaire par rapport à cette vague qui nous vient des États-Unis. Et je pense que le Vatican a un rôle clé à jouer.
G. D. E. - Le pape et le Vatican sont effectivement dans une temporalité longue. C’est le handicap le plus important auquel nos démocraties sont confrontées aujourd’hui. Les empereurs comme Poutine et les grands entrepreneurs de la tech sont à la tête de fortunes et de machines de plus en plus puissantes. Et ils réfléchissent tous sur le long terme. Or, dans nos débats politiques nationaux, nous sommes sans arrêt dans une réflexion très conjoncturelle.
"Combattre l’intelligence artificielle en soi n’a évidemment aucun sens. Ce serait comme se battre contre l’électricité. Face à un tel instrument, il faut se poser la question sur le plan de la gouvernance, du pouvoir, des responsabilités, et des limites", Giuliano da Empoli
Diriez-vous que l’intelligence artificielle lance aujourd’hui un défi à la démocratie ?
T. G. - Rappelons que l’IA est incapable de prévoir le résultat d’un conclave ! En ce qui concerne l’évolution des espaces publics sous l’influence de l’IA, il y a trois sujets majeurs. Le premier est la maîtrise des algorithmes. Comprend-on comment ces algorithmes sont construits ? D’un point de vue de citoyen européen, la réponse est non. Ensuite, il y a la question de la désinformation. Utilisateur de X (ex-Twitter) depuis 2008, je suis impressionné par l’évolution du contenu. Enfin, il y a la question du monde de l’entreprise et de l’hyperconcentration de la richesse et des personnes. La richesse est concentrée dans un petit nombre de mains, et les personnes capables de produire des ruptures technologiques sont également très peu nombreuses. Une partie de ceux qui composent cette hypercouche technologique est formée en Europe. Donc la formation des jeunes qui vont faire le choix de se lancer dans l’intelligence artificielle doit être l’objet d’un fort investissement.
G. D. E. - Combattre l’intelligence artificielle en soi n’a évidemment aucun sens. Ce serait comme se battre contre l’électricité. Face à un tel instrument, il faut se poser la question sur le plan de la gouvernance, du pouvoir, des responsabilités, et des limites. Nous ne devons pas reproduire l’erreur que nous avons commise sur le numérique à l’époque où sont apparus ces jeunes hommes « en sweat à capuche » qui créaient des start-up technologiques sur internet. En nous contentant de dire qu’il s’agissait là de « simples » entreprises qui ne faisaient que se développer, nous n’avons pas bien analysé le phénomène. Nous avons sous-estimé le fait qu’il s’agissait d’une façon différente de concevoir les relations entre les êtres et le fonctionnement d’une société, avec des conséquences économiques, politiques et sociales colossales. Nous n’avons pas bien géré cette arrivée du numérique. Face à la trajectoire similaire qu’emprunte l’IA, il y a urgence à changer notre façon de faire.
Aux États-Unis, il y a une très forte résistance à cette régulation que vous prônez en bons Européens rationnels…
G. D. E. - La technologie n’est pas un phénomène divin. Il suffit pour le comprendre de comparer le développement d’internet à celui de l’imprimerie. Au XVIe siècle, la technologie de l’imprimerie était la même en Chine, dans l’Europe de la Réforme et dans le monde islamique des califats. Dans trois contextes complètement différents, elle a produit des effets culturels, sociaux, politiques et économiques tout à fait distincts. Il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement au sujet du numérique et de l’intelligence artificielle. Le fonctionnement du modèle chinois est connu désormais. Le modèle américain se dévoile progressivement et devient toujours plus puissant. Il manque un modèle qui pourrait être européen ou plus large : celui des sociétés qui veulent rester des démocraties et développer ces technologies dans un cadre démocratique.
T. G. - Il ne faut pas négliger le modèle chinois, qui est porté par le Parti communiste, fort de ses 90 millions de membres et de ses 20 millions de cadres. C’est une organisation léniniste dans sa matrice. Dans les discours du président Xi, les références à cette idéologie sont fréquentes. Or qu’est-ce que le léninisme, fondamentalement ? C’est l’idée selon laquelle la politique sert à détruire son adversaire, par opposition à une vision libérale où cette dernière sert à tenir à distance le tyran. Aujourd’hui, il y a une convergence très visible entre la vision du Parti communiste chinois en termes technologiques et certaines positions exprimées depuis la Silicon Valley, notamment en ce qui concerne le prétendu assujettissement à la technologie auquel on ne pourrait pas échapper. En Chine, cela passe par des formes très poussées avec le crédit social. Cette pratique est un des grands sujets pour l’élaboration des algorithmes. Car ils créent des bulles pour permettre à chacun d’être heureux en tant que consommateur. Mais ces bulles ont surtout pour effet d’empêcher l’expression politique au sens collectif du terme.
[...]
Lire l'interview sur le site du Figaro
Titre Edito
Replay du débat au Grand Palais
Replay du débat au Grand Palais

Média

Journaliste(s):
Format
Partager