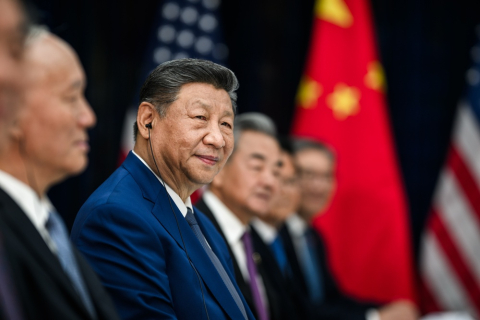Washington-Téhéran : l'élection de Joe Biden change-t-elle la donne ?
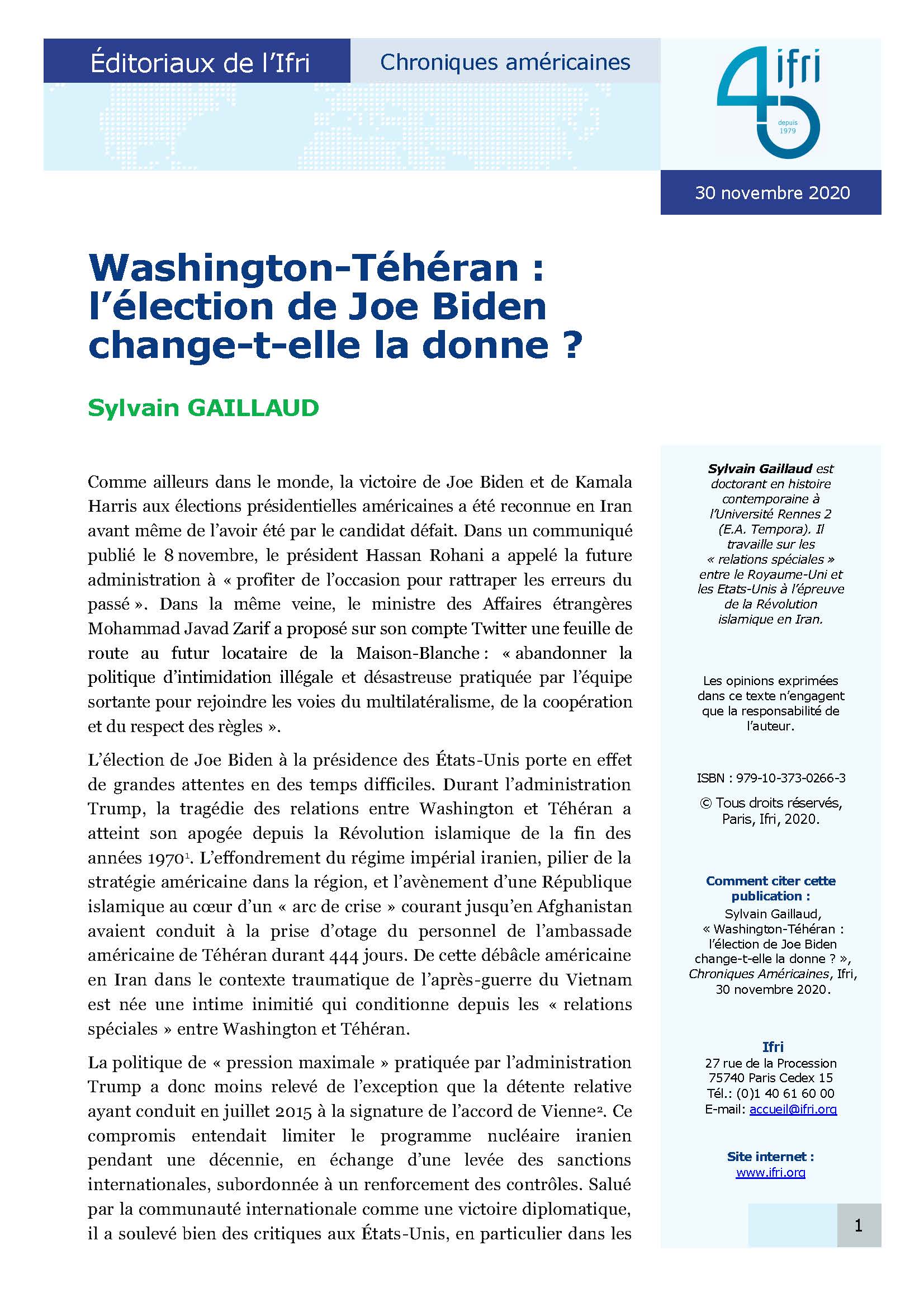
Après quatre années de « pression maximale » sous l'administration Trump, l'élection de Joe Biden porte de grandes attentes pour l'amélioration des relations entre les Etats-Unis et l'Iran.
Comme ailleurs dans le monde, la victoire de Joe Biden et de Kamala Harris aux élections présidentielles américaines a été reconnue en Iran avant même de l’avoir été par le candidat défait. Dans un communiqué publié le 8 novembre, le président Hassan Rohani a appelé la future administration à « profiter de l’occasion pour rattraper les erreurs du passé ». Dans la même veine, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a proposé sur son compte Twitter une feuille de route au futur locataire de la Maison-Blanche : « abandonner la politique d’intimidation illégale et désastreuse pratiquée par l’équipe sortante pour rejoindre les voies du multilatéralisme, de la coopération et du respect des règles ».
L’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis porte en effet de grandes attentes en des temps difficiles. Durant l’administration Trump, la tragédie des relations entre Washington et Téhéran a atteint son apogée depuis la Révolution islamique de la fin des années 1970[1]. L’effondrement du régime impérial iranien, pilier de la stratégie américaine dans la région, et l’avènement d’une République islamique au cœur d’un « arc de crise » courant jusqu’en Afghanistan avaient conduit à la prise d’otage du personnel de l’ambassade américaine de Téhéran durant 444 jours. De cette débâcle américaine en Iran dans le contexte traumatique de l’après-guerre du Vietnam est née une intime inimitié qui conditionne depuis les « relations spéciales » entre Washington et Téhéran.
La politique de « pression maximale » pratiquée par l’administration Trump a donc moins relevé de l’exception que la détente relative ayant conduit en juillet 2015 à la signature de l’accord de Vienne[2]. Ce compromis entendait limiter le programme nucléaire iranien pendant une décennie, en échange d’une levée des sanctions internationales, subordonnée à un renforcement des contrôles. Salué par la communauté internationale comme une victoire diplomatique, il a soulevé bien des critiques aux États-Unis, en particulier dans les rangs du Parti républicain, acquis à une position de fermeté contre la République islamique d’Iran.
Dans cet esprit, le président Trump retire les États-Unis de l’accord en mai 2018, prétextant que l’Iran ne respectait pas ses engagements, en dépit des déclarations contraires de l’Agence internationale pour l’énergie atomique. Le rétablissement de sanctions à portée extraterritoriale rend le texte lettre morte. En empêchant la République islamique d’obtenir les dividendes de ses engagements, il renforce la défiance iranienne pour la duplicité du « Grand Satan » américain : quels que soient les résultats des élections américaines, a déclaré sur Twitter le guide suprême Ali Khamenei le 3 novembre, la politique iranienne à l’égard des États-Unis ne changerait pas.
Le retour d’acteurs chevronnés
L’arrivée au pouvoir de Joe Biden passe pourtant pour la condition nécessaire d’un apaisement des tensions entre Washington et Téhéran. L’ancien vice-président de Barack Obama a rapidement fait savoir qu’il s’engagerait sur une « voie crédible pour retourner à la diplomatie » à son arrivée aux affaires. Cette volonté a été corroborée par l’identité des acteurs de son équipe de transition. Elle est confirmée par l’itinéraire des personnalités qui composeront son entourage de politique étrangère et de sécurité.
Le choix d’Antony Blinken pour la direction de la diplomatie américaine est celui d’un vétéran de la politique iranienne de l’administration Obama. Conseiller de Sécurité nationale du vice-président Biden, il devient adjoint à la conseillère de Sécurité nationale Susan Rice à l’époque de l’élaboration du compromis nucléaire et secrétaire d’État adjoint, principal collaborateur de John Kerry, lors de sa signature en juillet 2015.
La nomination de Jake Sullivan à la tête du conseil de Sécurité nationale confirme ce resserrement du cercle de politique étrangère autour des fidèles de l’ancien vice-président et des acteurs du rapprochement avec la République islamique. En novembre 2013, Sullivan avait participé à des rencontres confidentielles d’officiels américains avec des personnalités iraniennes dans le sultanat d’Oman[3]. Ces échanges avaient posé les jalons des négociations ayant abouti à la signature des accords de Vienne.
Ancienne directrice-adjointe de la Central Intelligence Agency (CIA) et principale adjointe au conseil de Sécurité nationale pendant l’administration Obama, Avril Haines devient aujourd’hui la première femme à la tête du renseignement national. Elle travaille dans les années 2000 à la Commission des Affaires étrangères du Sénat sous la direction de Biden, qui en est alors le président. Plus récemment, elle est entendue par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants lors d’un audit de la politique iranienne de l’administration Trump.
En amont de ces nominations, l’équipe Biden s’est par ailleurs rapprochée des membres de l’entourage de l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis[4]. Celui-ci avait démissionné fin 2018 en désaccord avec certaines évolutions de la politique étrangère de Donald Trump, en particulier le retrait unilatéral du texte de 2015. Parmi ces vétérans de l’administration sortante pressentis pour travailler avec le président élu figure Michael Mulroy, alors en charge du Moyen-Orient au Pentagone. Il y a fondé un Bureau stratégique pour l’Iran afin de coordonner une politique d’« approche calibrée » qui a sans doute permis de limiter les conséquences de l’escalade diplomatique de l’année 2019 dans le golfe Persique[5].
La persistance de nombreux obstacles
Toutes nécessaires qu’elles soient, ces conditions seront loin d’être suffisantes pour panser les plaies rouvertes par la politique de « pression maximale ». Le revers électoral du président sortant a semblé d’ailleurs le conforter dans la volonté urgente de la faire aboutir. Après avoir remercié son secrétaire à la Défense Mark Esper, il a sollicité des options de bombardement d’un site nucléaire iranien, ce dont l’ont dissuadé ses principaux conseillers de politique étrangère, parmi lesquels le vice-président Mike Pence et le secrétaire d’État Mike Pompeo[6]. Ce dernier n’en a pas moins fait la promotion de sanctions économiques renforcées contre Téhéran auprès de ses interlocuteurs lors de sa tournée d’adieu en Europe et au Moyen-Orient.
Contraints au départ par la sanction électorale, les hérauts de la « pression maximale » s’appliquent ainsi à semer d’embûches les voies incertaines d’un rapprochement. Ce dernier devra d’ailleurs trouver sa place dans un agenda déjà considérablement chargé pour le président élu. La nomination de Ron Klain au Secrétariat général de la Maison-Blanche indique que la priorité de la nouvelle administration sera la lutte contre la pandémie de COVID-19, laissée en héritage par l’incurie de l’administration sortante. De plus, à l’échelle internationale, le retour de Washington dans les accords de Paris sur le climat semble plus aisé que la résurrection du compromis de Vienne, dont les défenseurs iraniens ont perdu bien du crédit auprès de leurs électeurs et de leurs adversaires politiques.
Mohammad Javad Zarif a beau jeu de déclarer que la République islamique serait prête à revenir au strict respect de ses engagements quand les États-Unis honoreraient à nouveau les leurs sans contrepartie. Un pareil scénario est illusoire. Un ancien conseiller des présidents démocrates Jimmy Carter et Bill Clinton, consulté par l’équipe Biden, confirme que la volonté américaine de revenir dans l’accord ne conduirait pas à la suppression automatique des sanctions, espérée par Téhéran. Les États-Unis n’entendent pas faire l’économie de négociations visant à limiter les velléités de prolifération nucléaire et de déstabilisation régionale que le texte de 2015 prévoyait d’encadrer dès 2030. Un pareil agenda sera difficile à accepter par des négociateurs iraniens, même dans l’hypothèse, aujourd’hui peu probable, de la victoire d’un candidat ouvert à l’idée d’un dialogue lors des élections présidentielles iraniennes de juin 2021.
Convaincus de la duplicité perpétuelle du « Grand Satan américain », les Iraniens réclameront en outre des garanties interdisant une nouvelle sortie unilatérale du compromis négocié. Or, l’entérinement des engagements dans un traité nécessiterait sa ratification par le Sénat américain. Il faudrait donc d’abord que le Parti démocrate arrache en janvier prochain une égalité de sièges permettant à la vice-présidente de départager les votes. Cependant, même dans ce cadre politique favorable, rien n’assure que tous les sénateurs démocrates acceptent de dépasser les sirènes d’une hostilité diffuse envers la République islamique.
Le 27 novembre, l’assassinat du scientifique Mohsen Fakhrizadeh, figure historique du programme nucléaire iranien, est le dernier avatar d’une campagne de déstabilisation menée contre l’Iran par ses adversaires autoproclamés. L’événement fait ainsi écho à l’assassinat, le 3 janvier dernier, du général Qassem Soleimani, commandant des forces Al-Qods, chargées des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, à l’issue d’une frappe de drone ciblée ordonnée par les États-Unis. Il arrive opportunément après l’abandon par le président Trump de son intention de bombarder un site nucléaire iranien à la mi-novembre.
Les autorités de la République islamique ont rapidement attribué la responsabilité de l’assassinat à Israël, le président Rohani allant jusqu’à qualifier ses commanditaires de « mercenaires des États-Unis ». L’État hébreu ne cache d’ailleurs par son intention de peser de tout son poids pour rendre plus difficile la reprise des négociations nucléaires entre Washington et Téhéran, faisant ainsi le jeu des opposants iraniens au retour du dialogue.
À quelques mois du scrutin présidentiel iranien, les effets conjugués de la politique de « pression maximale » et de la pandémie de COVID-19 font néanmoins peser des temps difficiles sur une République islamique économiquement exsangue et socialement excédée. Acculé, le régime pourrait de ce fait se résoudre à la réouverture du dialogue avec un partenaire qui montrerait son attachement à dépasser les passifs du passé. Dans la tragédie des relations entre Washington et Téhéran, ces temps difficiles pourraient ainsi paradoxalement permettre de concrétiser les grandes attentes que porte l’alternance présidentielle américaine.
[1]. J. A. Bill, The Eagle and the Lion: The Tragedy of American-Iranian Relations, New Haven, Ct., Yale University Press, 1988.
[2]. S. Gaillaud, « De fausses ruptures en retour du refoulé, la politique iranienne de Donald Trump », La Croix, 7-8 mai 2018.
[3]. J. Pace, « Vanishing Adviser Reappears as Iran Policy Player », AP, 24 décembre 2013.
[4]. L. Seligman, « Biden Team Reaching Out to Former Mattis Officials for Help with Transition », Politico, 12 novembre 2020
[5]. S. Gaillaud, « Des cendres en héritage : l’obsession iranienne des faucons du président renoue avec l’aventurisme américain au Moyen-Orient », L’Hétairie, n° 50, 24 juin 2019.
[6]. E. Schmitt, M. Haberman, D. E. Sanger, H. Cooper et L. Jakes, « Trump Has Considered a Strike on Iran Before He Leaves Office », The New York Times, 17 novembre 2020.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Washington-Téhéran : l'élection de Joe Biden change-t-elle la donne ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa base et les élites MAGA face à l’opération Epic Fury. Le soutien au président tiendra-t-il dans la durée?
Depuis la fin du mois de février, le Moyen-Orient est de nouveau déchiré par la guerre, à la suite de la vaste offensive aérienne menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran. L’opération, baptisée Epic Fury, a notamment permis, dès le premier jour, l’élimination de dizaines de hauts responsables iraniens.
South by Southwest 2026. Le festival texan au carrefour des visions de l’intelligence artificielle
Fin février 2026, l’administration Trump exige d’Anthropic, l’un des leaders mondiaux de l’intelligence artificielle (IA), créateur de Claude, un accès sans restrictions à ses modèles pour le Pentagone. Son P.-D. G., Dario Amodei, refuse au nom de « lignes rouges » éthiques – pas de surveillance de masse, pas d’armes totalement autonomes. Après l’échec de négociations, Anthropic se voit exclu des agences fédérales. Dans la foulée, OpenAI, son principal concurrent, signe avec le département de la Défense, tout en promettant de ne pas permettre un usage létal autonome.
Le Canada de Mark Carney, un an après
Début janvier 2025, le Premier ministre Justin Trudeau, en fin de course, est contraint à la démission et annonce de nouvelles élections, d’abord au sein du Parti libéral, ensuite à la Chambre des communes d’Ottawa. Battant des adversaires démotivés par l’avance du conservateur Pierre Poilievre dans les sondages, Mark Carney prend la tête du Parti libéral le 9 mars et remplace aussitôt Trudeau au poste de Premier ministre. Il profite alors du retournement des électeurs canadiens contre Pierre Poilievre, associé dans leur esprit à Donald Trump et aux propos prédateurs que tient ce dernier à propos du Canada depuis sa réélection fin 2024, et remporte les législatives du 28 avril.
L’administration Trump 2 et le nouveau capitalisme d’État américain
La politique économique du second mandat de Donald Trump s’inscrit partiellement dans la tradition néolibérale, cherchant à réduire le rôle de l’État perçu comme une entrave à l’initiative privée. L’administration adopte ainsi une orientation pro-business qui repose sur la dérégulation et les baisses d’impôt.