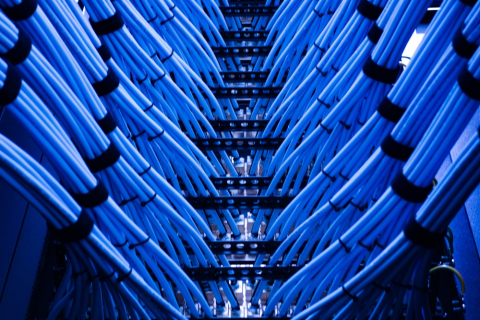Zimbabwe : engrenage de la violence et de la répression

Le 12 janvier dernier, en réponse aux pénuries persistantes de carburant au Zimbabwe et aux longues files d’attente devant les stations-service, le président Emmerson Mnangagwa a annoncé une hausse de 150 % du prix du carburant, faisant passer le prix du litre d’essence à 3,30 dollars.
L’objectif de cette hausse était de dissuader les Zimbabwéens de se rendre aux stations-service, d’employer des moyens de transport alternatifs et d’enrayer le commerce de carburant transfrontalier. Au lendemain de cette annonce, des organisations de la société civile ont relayé l’appel à la grève générale lancé par le Congrès zimbabwéen des syndicats (ZTCU, la principale centrale syndicale du pays). Mais dans un pays où l’emploi formel est très limité, ce sont des manifestations massives de Zimbabwéens qui ont été observées dans plusieurs villes (notamment à Harare, Bulawayo et Chitungwiza). Ceci confirme que les villes zimbabwéennes sont aujourd’hui les principaux bastions de l’opposition et foyers de la contestation[1]. Par ailleurs, ces mobilisations ont été violentes, ce qui est inhabituel au regard des manifestations organisées ces dernières années au Zimbabwe. Les manifestations du 1er août 2018, peu avant l’annonce des résultats des élections, étaient circonscrites à Harare et très loin d’atteindre ce niveau de violence. Cette fois-ci, de nombreux magasins ont été pillés, des voitures et des bâtiments publics ont été incendiés, et les autorités ont confirmé la mort d’un policier.
En réaction à ces mobilisations, la répression fut opérée par la police et l’armée. Il est difficile d’établir un bilan précis de ces affrontements en raison de la coupure d’internet durant les mobilisations qui a limité les possibilités de compiler des témoignages, mais aussi parce que de nombreuses victimes craignent de porter plainte pour dénoncer les forces de sécurité et ne se rendent pas dans les hôpitaux de peur d’être identifiées. Toutefois, une coalition d’organisations non gouvernementales zimbabwéennes (Zimbabwe Human Rights NGO Forum) a répertorié 1 803 cas de violations des droits de l’homme depuis le début des manifestations[2] dont : au moins 17 morts ; 17 viols ou agressions sexuelles ; 26 enlèvements ; 81 blessures par balles ; 586 cas d’agressions, de tortures ou de traitements inhumains et dégradants ; 954 arrestations et détentions arbitraires. En plus du pasteur Ewan Mawarire, figure de la contestation en 2016 et 2017, des militants syndicaux et de l’opposition ont été interpellés, dont le député du principal parti d’opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), Rusty Markham, et Japhet Moyo, le Secrétaire général du ZTCU.
Le gouvernement et les médias d’État accusent le MDC, les syndicats et les organisations de la société civile d’avoir planifié les manifestations dans le cadre d’un projet de changement de régime afin de renverser le gouvernement et porter au pouvoir Nelson Chamisa, le leader du MDC. Cette rhétorique complotiste n’est pas nouvelle : elle était régulièrement employée par Robert Mugabe sans que des preuves tangibles viennent étayer ces allégations.
Ces événements étaient-ils prévisibles ?
La colère contre le gouvernement s’accumulait depuis quelques mois déjà en raison de la dégradation de la situation économique. Le départ de Robert Mugabe avait suscité de profonds espoirs parmi la population qui espérait des changements concrets. Or ceux-ci sont peu visibles, et pour beaucoup, la situation s’est même dégradée. La grande majorité des Zimbabwéens est toujours exclue de l’économie formelle. En septembre 2018, une épidémie de choléra, indice d’une détérioration de l’infrastructure sanitaire, s’était propagée, principalement à Harare, faisant 50 morts[3]. Par ailleurs, d’après le Programme alimentaire mondial[4], 2,4 millions de personnes sont confrontées à l’insécurité alimentaire, et la situation pourrait empirer avec les épisodes de sécheresse qui devraient être de plus en plus fréquents dans les années à venir.
Par ailleurs, depuis quelques mois, les dollars en circulation sont de plus en plus rares et les prix des denrées de base comme le pain, l’eau et les médicaments ont connu de fortes augmentations. Les étals des supermarchés affichent aujourd’hui des prix proches de ceux de la période d’hyperinflation qui avait contraint le Zimbabwe à renoncer à sa monnaie nationale en 2009. De plus, l’inflation[5] érode fortement les salaires et l’épargne, appauvrissant davantage une population déjà en grande difficulté.
D’un point de vue macroéconomique, la situation du Zimbabwe est également précaire. À la thématique de l’endettement[6] s’ajoutent les effets de la mise au ban du Zimbabwe par les agences d’aide et les investisseurs étrangers, en raison de la situation politique du pays. Contrairement aux attentes des gouvernements zimbabwéens successifs, leur départ n’a pas été compensé par l’arrivée d’autres partenaires, comme la Chine, et l’économie zimbabwéenne pâtit de la faiblesse des investissements étrangers depuis deux décennies. En promettant des réformes économiques popularisées par le slogan « Zimbabwe is open for business » et en nommant Mthuli Ncube, une personnalité reconnue pour ses compétences, au poste de ministres des Finances, Emmerson Mnangagwa espérait restaurer la confiance des investisseurs étrangers et relancer l’économie du pays. Or, d’une part, il n’y a pas eu d’efforts majeurs pour lutter contre la corruption et la mainmise des dignitaires du parti au pouvoir sur des pans entiers de l’économie et, d’autre part, les élections de 2018 ainsi que la répression militaire[7] du 1er août 2018 ont largement refroidi de nombreux bailleurs qui étaient pourtant prêts à investir suite aux engagements et aux changements positifs observés entre l’arrivée au pouvoir d’Emmerson Mnangagwa, en novembre 2017, et la tenue des élections, fin juillet 2018.
Comment expliquer ce niveau de violence ?
Du côté de la population, il est très rare d’observer au Zimbabwe un tel niveau de pillage et de destruction. Cette violence collective témoigne de l’ampleur du désespoir d’une partie de la population, notamment des jeunes générations urbanisées, qui n’ont plus beaucoup à perdre et ont vu leurs espoirs de changement par les urnes déçus en 2018. Du côté du régime, l’explication principale repose sur le déploiement de l’armée pour réprimer les manifestants. C’était déjà le cas le 1er août 2018 lorsque des militaires avaient abattu six personnes à Harare pour maîtriser une manifestation de l’opposition. Quand Robert Mugabe était à la tête de l’État, c’était la police qui était principalement mobilisée pour gérer les manifestations, et les balles réelles n’étaient pas utilisées. Le nombre de victimes comptabilisées s’explique en grande partie par la présence de militaires qui ne sont pas formés pour gérer des foules mais pour neutraliser des adversaires.
Cette dérive sécuritaire reflète clairement le rôle majeur du pouvoir militaire dans le processus décisionnel gouvernemental. Le fait que les militaires s’arrogent des prérogatives de la police est à replacer dans le contexte du coup d’État de novembre 2017[8]. Sous Robert Mugabe, l’appareil sécuritaire reposait sur un équilibre des pouvoirs entre l’armée, les services de renseignements et la police. Lors du coup d’État, les militaires se sont retournés contre Robert Mugabe alors que les services de renseignements et la police sont restés loyaux à l’ancien dirigeant. En conséquence, depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmerson Mnangagwa, la police et les services de renseignements n’ont plus le même poids dans l’appareil sécuritaire du pays. Ces institutions sont désormais sous la tutelle de l’armée et un manque de confiance réciproque s’est cristallisé. En effet, malgré des changements de personnel[9], les militaires jugent les policiers inefficaces pour rétablir l’ordre et les soupçonnent de pouvoir prendre parti pour les opposants. On peut aussi supposer que des services de renseignements efficaces auraient pu anticiper la montée de la contestation et la juguler avant la flambée des violences. L’armée semble avoir été prise au dépourvu et a réprimé de manière forte pour étouffer la contestation.
Quelles perspectives d’apaisement ?
Le pays est fortement polarisé et les perspectives de solutions négociées sont minces. Le président Emmerson Mnangagwa a appelé à un dialogue national réunissant les candidats de la dernière élection présidentielle. Toutefois, ce dialogue organisé sous l’égide du gouvernement a peu de chance d’apaiser les tensions. En effet, le MDC refuse de reconnaître la légitimité du président car il considère que les élections de 2018 ont été frauduleuses, tandis que le gouvernement accuse l’opposition d’être antipatriotique et de promouvoir un agenda de changement de régime. D’autres instances pourraient faire office de médiateur. C’est notamment le cas des Églises qui s’impliquent dans le débat public et ont des relais à la fois au sein du gouvernement et de l’opposition. Le Conseil des Églises du Zimbabwe (ZCC) a ainsi entrepris une rencontre entre les leaders politiques. Nelson Chamisa s’y est rendu contrairement à Emmerson Mnangagwa qui fut seulement représenté, affichant ainsi son intérêt limité pour l’initiative.
À l’international, le Royaume-Uni est le pays qui a réagi le plus rapidement et clairement en condamnant les atteintes aux droits de l’homme et la réponse disproportionnée des forces de sécurité zimbabwéennes[10]. Cette prise de position traduit une évolution notable car le Royaume-Uni était le principal soutien d’Emmerson Mnangagwa depuis son arrivée au pouvoir et œuvrait pour encourager une normalisation des relations diplomatiques et économiques du Zimbabwe avec les organisations internationales, notamment avec l’Union européenne, le Fonds monétaire international et le Commonwealth. Contrairement au Royaume-Uni, d’autres pays et notamment les institutions régionales africaines, l’Union africaine ainsi que la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC, selon l’acronyme anglais), ont timidement réagi aux événements en cours au Zimbabwe. L’Afrique du Sud, historiquement liée au Zimbabwe, aurait pu avoir un rôle décisif pour condamner ou proposer une médiation mais Cyril Ramaphosa s’est contenté d’appeler au calme et de réclamer la levée des sanctions internationales contre son voisin. La SADC a publié un communiqué qui appelle également à la levée des sanctions et reprend la rhétorique complotiste des autorités zimbabwéennes en indiquant que des « groupes internes, en particulier les organisations non gouvernementales, soutenus par des forces extérieures, ont poursuivi leurs efforts pour déstabiliser le pays[11] ».
En l’absence de condamnation internationale univoque et de dialogue sincère entre le régime et ses opposants, l’évolution de la situation au Zimbabwe dépendra de la capacité du gouvernement à assurer une reprise économique durable et générale. À court terme, cela semble compromis car les quelques accords commerciaux noués à l’étranger[12] ne résoudront pas les problèmes économiques immédiats auxquels une majorité de Zimbabwéens est confrontée. Il est donc peu probable que les tensions se dissipent rapidement et de nouvelles confrontations sont à prévoir.
[1]. V. Magnani et T. Vircoulon, « Les élections 2018 au Zimbabwe. Radiographie d’un État fracturé », Notes de l’Ifri, Ifri, novembre 2018.
[2]. Zimbabwe Human Rights NGO Forum, « On the Days of Darkness in Zimbabwe – An Updated Report on the Human Rights Violations Committed between 14 January 2019 to 5 February 2019 », 6 février 2019, disponible sur : www.hrforumzim.org.
[3]. World Health Organization, « Cholera – Zimbabwe, Disease Outbreak News: Update », 5 octobre 2018, disponible sur : www.who.int.
[4]. Programme alimentaire mondial, Zimbawe. Plus d’informations sur : www1.wfp.org.
[5]. En janvier 2019, le taux d’inflation s’élevait à 56,9 % selon Trading Economics, le plus haut niveau atteint depuis décembre 2009. Détails disponibles sur : fr.tradingeconomics.com.
[6]. « Zimbabwe Domestic and Foreign Debt Total $16.9 Billion Says Finance Minister », Voice of America, 4 octobre 2018.
[7]. V. Magnani et T. Vircoulon, op. cit.
[8]. V. Magnani, « L’armée entre en scène au Zimbabwe. Coup de théâtre ou théâtre sans fin ? », Notes de l’Ifri, Ifri, avril 2018.
[9]. Isaac Moyo a pris la tête de l’Organisation centrale de renseignements (CIO) et Godwin Matanga a été nommé commissaire général de police (la plus haute fonction de la police zimbabwéenne) quelques jours après le départ de Robert Mugabe.
[10]. Déclaration de la ministre d'État pour l'Afrique, Harriett Baldwin, sur la situation au Zimbabwe, 17 janvier 2019, disponible sur : www.gov.uk.
[11]. Déclaration du président de la SADC, son Excellence G. Geingob, sur la situation au Zimbabwe, 11 février 2019, disponible sur : www.sadc.int.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Zimbabwe : engrenage de la violence et de la répression
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa politique russe de recrutement de combattants et d’ouvrières en Afrique subsaharienne
La guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022, s’est rapidement internationalisée. La Russie et l’Ukraine se sont très vite efforcées de mobiliser leurs alliés afin d’obtenir un soutien politique et diplomatique, ainsi que des ressources militaires et économiques. Mais les deux belligérants ont aussi cherché à recruter des étrangers à titre privé pour soutenir leurs efforts de guerre respectifs. Cette politique est globale et s’étend de l’Amérique latine à l’Extrême-Orient. L’Afrique subsaharienne, dans ce panorama, présente un intérêt particulier car elle constitue un vivier de recrutement vaste et facilement accessible, en raison de taux de pauvreté élevés dans la plupart des pays de la zone conjugués à un important désir d’émigration.
Jeunesses et mobilisations en ligne au Mozambique : vers une redéfinition de l’espace public ?
Cette recherche explore la manière dont les jeunesses mozambicaines investissent les espaces numériques pour contourner les canaux traditionnels de participation politique et sociale. À travers une analyse des mobilisations en ligne, notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et WhatsApp, il met en lumière les nouvelles formes d’engagement qui remettent en question le monopole de l’État sur la parole publique et l’agenda politique.
Revendiquer “le peuple” : explosions démographiques de la jeunesse, dirigeants autoritaires affaiblis et politiques “populistes” au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie
Cette étude analyse l’émergence de tendances politiques qualifiées de « populistes » dans trois pays d’Afrique de l’Est : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Elle s’ancre dans une discussion plus large autour de la notion de « populisme », en interrogeant son usage et sa pertinence dans les contextes africains (et plus spécifiquement est-africains), avant d’examiner les dynamiques propres à trois cas emblématiques : la victoire électorale de William Ruto en 2022 au Kenya et sa rhétorique de la « Hustler Nation » ; l’opposition portée par Bobi Wine face à Yoweri Museveni en Ouganda ; et le style de gouvernement fortement personnalisé de John Magufuli en Tanzanie.
Gabon : un modèle politique issu d’une transition (presque) exemplaire ?
Les 27 septembre et 11 octobre 2025, les citoyens gabonais élisent dans un scrutin à deux tours à la fois les pouvoirs municipaux et les députés de la nouvelle Assemblée nationale. Il s’agit de l’étape presque ultime d’une transition politique qui s’approche de sa fin, un peu plus de deux ans après le coup d’État ayant renversé le régime dynastique plus que trentenaire des Bongo, celui du père, Omar, mort au pouvoir en 2009, puis celui de son fils, Ali, maintenant en exil.