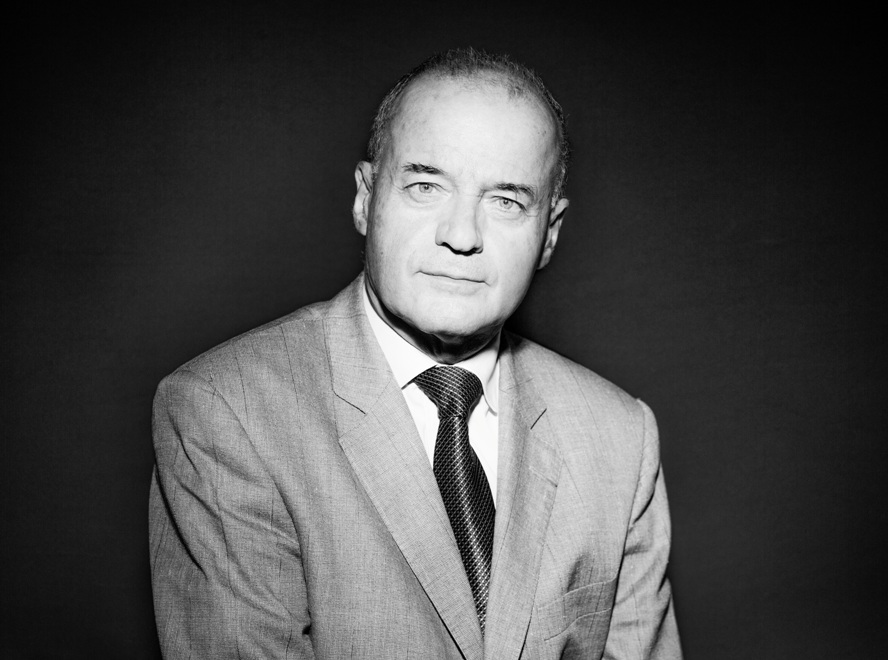Pour l'Ukraine : les yeux ouverts
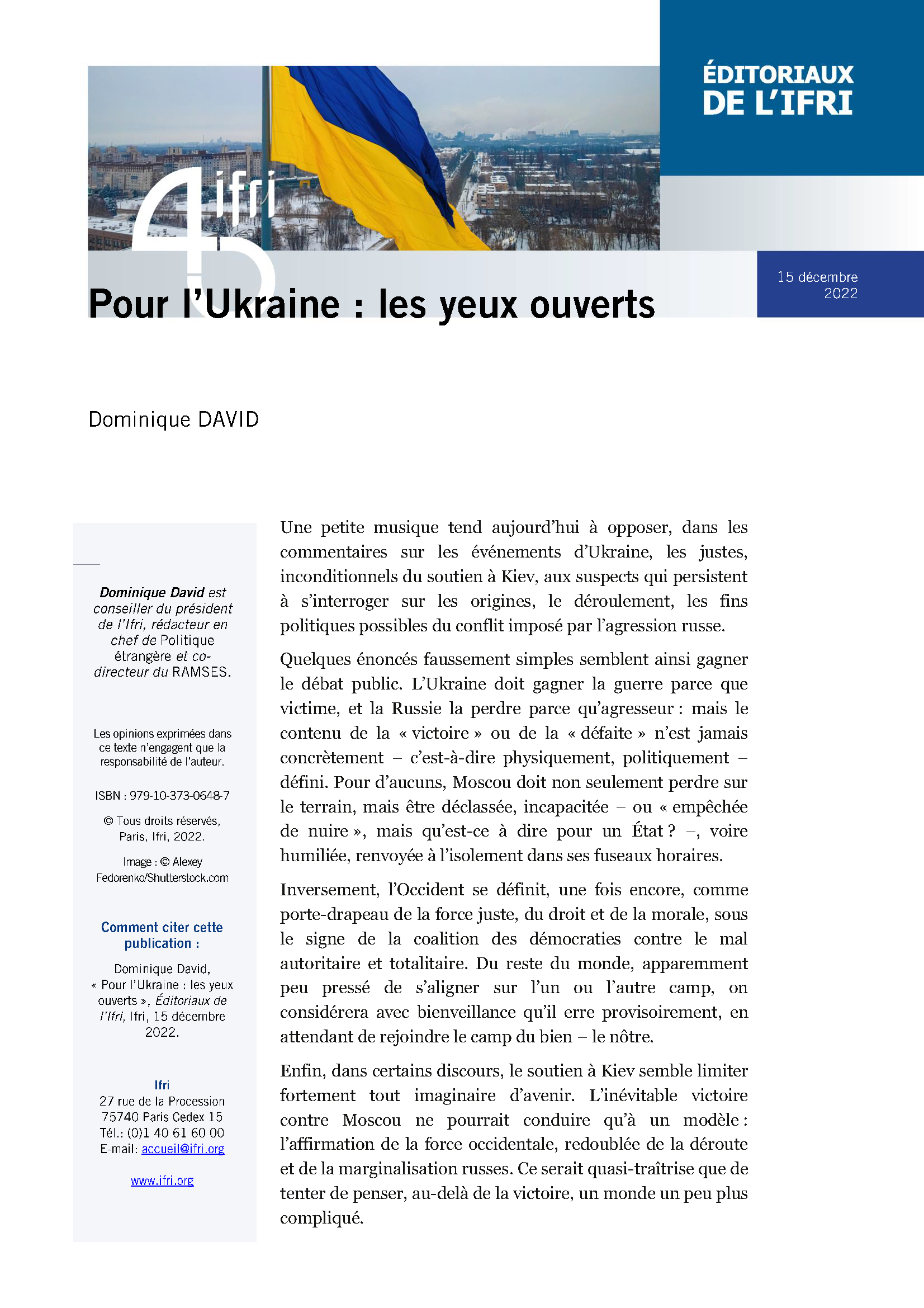
Une petite musique tend aujourd’hui à opposer, dans les commentaires sur les événements d’Ukraine, les justes, inconditionnels du soutien à Kiev, aux suspects qui persistent à s’interroger sur les origines, le déroulement, les fins politiques possibles du conflit imposé par l’agression russe.

Quelques énoncés faussement simples semblent ainsi gagner le débat public. L’Ukraine doit gagner la guerre parce que victime, et la Russie la perdre parce qu’agresseur : mais le contenu de la « victoire » ou de la « défaite » n’est jamais concrètement – c’est-à-dire physiquement, politiquement – défini. Pour d’aucuns, Moscou doit non seulement perdre sur le terrain, mais être déclassée, incapacitée – ou « empêchée de nuire », mais qu’est-ce à dire pour un État ? –, voire humiliée, renvoyée à l’isolement dans ses fuseaux horaires.
Inversement, l’Occident se définit, une fois encore, comme porte-drapeau de la force juste, du droit et de la morale, sous le signe de la coalition des démocraties contre le mal autoritaire et totalitaire. Du reste du monde, apparemment peu pressé de s’aligner sur l’un ou l’autre camp, on considérera avec bienveillance qu’il erre provisoirement, en attendant de rejoindre le camp du bien – le nôtre.
Enfin, dans certains discours, le soutien à Kiev semble limiter fortement tout imaginaire d’avenir. L’inévitable victoire contre Moscou ne pourrait conduire qu’à un modèle : l’affirmation de la force occidentale, redoublée de la déroute et de la marginalisation russes. Ce serait quasi-traîtrise que de tenter de penser, au-delà de la victoire, un monde un peu plus compliqué.
On peut entendre ici, dans cette pensée anti-politique – attente de la victoire sans définition, ignorance de la diversité du monde, auto-intoxication sur ses propres vertus, dominance des énoncés idéologiques sur l’analyse patiente du passé… – comme un écho des faiblesses occidentales des trente dernières années.
Nous, démocraties occidentales, avons échoué depuis trente ans à construire un monde neuf pour succéder à la bipolarité, justement parce que nous avons pensé que nous étions ce monde, que ce dernier se réduirait bientôt à ce que nous voulions, pour nous ressembler. Au nombre de nos résultats : nous n’avons rien compris à la Russie, nous n’avons pas prévu le 24 février. Un engagement myope aujourd’hui paierait-il l’aveuglement d’hier ?
***
Et pourtant. Il devrait être possible de dire que la situation actuelle est aussi le fruit de l’arrogance, des erreurs d’un Occident rêvant à la conversion démocratique instantanée du monde russe, même si c’est bien la dérive réactionnaire et grand-russienne du régime de Vladimir Poutine qui a précipité le pays dans l’actuelle tragédie.
On peut aussi dire que la Russie est l’agresseur – et qu’il faut donc la combattre, sans nulle hésitation –, et en même temps que nous n’avons rien compris aux raisons de cette agression. Refuser de comprendre rationnellement, c’est se condamner à revivre le malheur, demain.
On peut légitimement, alors que l’on soutient et aide sans aucune ambiguïté le peuple ukrainien, réfléchir sur le type d’armements à transférer, sur leur utilisation actuelle et future, en Ukraine même ou au-delà, bref sur notre propre stratégie et notre sécurité, qui ne sauraient se réduire à celles des autres – fussent-ils ukrainiens.
On a le droit de penser qu’il faut, au profit de tous les acteurs sans exception, maîtriser au maximum le conflit, brider l’escalade. Notre sécurité est certainement en cause à Kiev, mais elle ne se joue pas totalement, exclusivement, dans la seule Ukraine.
On peut également hasarder que l’avenir de l’Europe comme continent se fera avec l’Ukraine mais aussi avec la Russie, quel que soit l’avenir de l’actuel régime russe, que nous n’avons guère les moyens de changer.
***
Que les Ukrainiens, plongés dans l’enfer de la guerre, raccourcissent certains raisonnements en faveur de la mobilisation est compréhensible – c’est la règle de la montée aux extrêmes de l’affrontement. Mais hors du champ de bataille, la tenace tentation de simplifier, et par exemple de rabattre – sans trop le dire encore – l’actuel conflit sur le modèle de la Seconde Guerre mondiale (reductio ad hitlerum de l’adversaire, convocation erratique de la notion de génocide, fantasme de la capitulation sans condition…) témoigne d’abord du refus de penser la complexité d’un monde rétif aux modèles idéologiques, ceux de la Russie ou les nôtres.
Il faut en revenir au triste réalisme ; triste parce qu’il se mesure à une réalité qui doit être appréciée de manières diverses et contradictoires, la complexité étant rarement enthousiasmante. La France, parce qu’elle n’est pas en première ligne du conflit, parce qu’elle a tissé dans l’histoire un rapport particulier avec le monde russe, parce qu’elle a une position stratégique particulière dans le camp occidental, serait particulièrement coupable d’abdiquer devant les réalités, de troquer la finesse et la diversité des analyses et expertises contre de dangereux slogans.
Les Ukrainiens ont droit à notre soutien, à notre ferveur, face à l’agression. Et à nos yeux ouverts.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Pour l'Ukraine : les yeux ouverts
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analyses« Deathonomics » : impacts sociaux, politiques et économiques en Russie
Cette note tente de décrire et d'analyser un phénomène véritablement nouveau dans la société russe, baptisé « deathonomics » (économie de la mort) : la création d'une armée mercenaire dans le contexte de la guerre menée par le Kremlin en Ukraine, qui finira par remplacer à la fois l'armée soviétique (conscription) et les premières armées russes (contrats). Il note qu'à la fin de 2023, cette tendance avait fait du service militaire l'une des professions les mieux rémunérées du pays, ce qui n'avait pas été vu en Russie à une telle échelle depuis la fin du XVIIe siècle.
La politique russe de recrutement de combattants et d’ouvrières en Afrique subsaharienne
La guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022, s’est rapidement internationalisée. La Russie et l’Ukraine se sont très vite efforcées de mobiliser leurs alliés afin d’obtenir un soutien politique et diplomatique, ainsi que des ressources militaires et économiques. Mais les deux belligérants ont aussi cherché à recruter des étrangers à titre privé pour soutenir leurs efforts de guerre respectifs. Cette politique est globale et s’étend de l’Amérique latine à l’Extrême-Orient. L’Afrique subsaharienne, dans ce panorama, présente un intérêt particulier car elle constitue un vivier de recrutement vaste et facilement accessible, en raison de taux de pauvreté élevés dans la plupart des pays de la zone conjugués à un important désir d’émigration.
Le Kazakhstan après le double choc de 2022. Conséquences politiques, économiques et militaires
L’année 2022 a été marquée par un double choc pour le Kazakhstan : en janvier, le pays a connu la plus grave crise politique depuis son indépendance, et en février, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine, remettant en question les frontières entre les pays post-soviétiques. Ces événements successifs ont eu un impact profond sur la politique intérieure et extérieure du Kazakhstan.
Russie - [URSS] - Russie
De Nicolas II à Vladimir Poutine, la Russie est passée, au cours du XXᵉ siècle, par bien des métamorphoses. À l'empire tsariste d'avant la Première Guerre mondiale succède l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, dont la vocation révolutionnaire internationaliste exprimée par Lénine cède à l'impérialisme soviétique, continental avec Staline, mondial avec Khrouchtchev et Brejnev. Devenue une superpuissance après 1945, la « patrie du socialisme » ne peut résister à l'éclatement de l'empire qu'annonce la chute du mur de Berlin, en 1989 : en 1991, la Russie renaît donc sur les débris de l'empire, et, avec elle, une nouvelle page de l'histoire russe s'ouvre devant les yeux inquiets du monde. Mais en dépit de ses spécificités et des tensions diverses qui l'ébranlent, entre Nord et Sud, Orient et Occident, christianisme et islam, la Russie fédérale entend bien s'intégrer enfin dans la communauté des grands États et cesser d'être considérée comme un acteur à part des relations internationales.